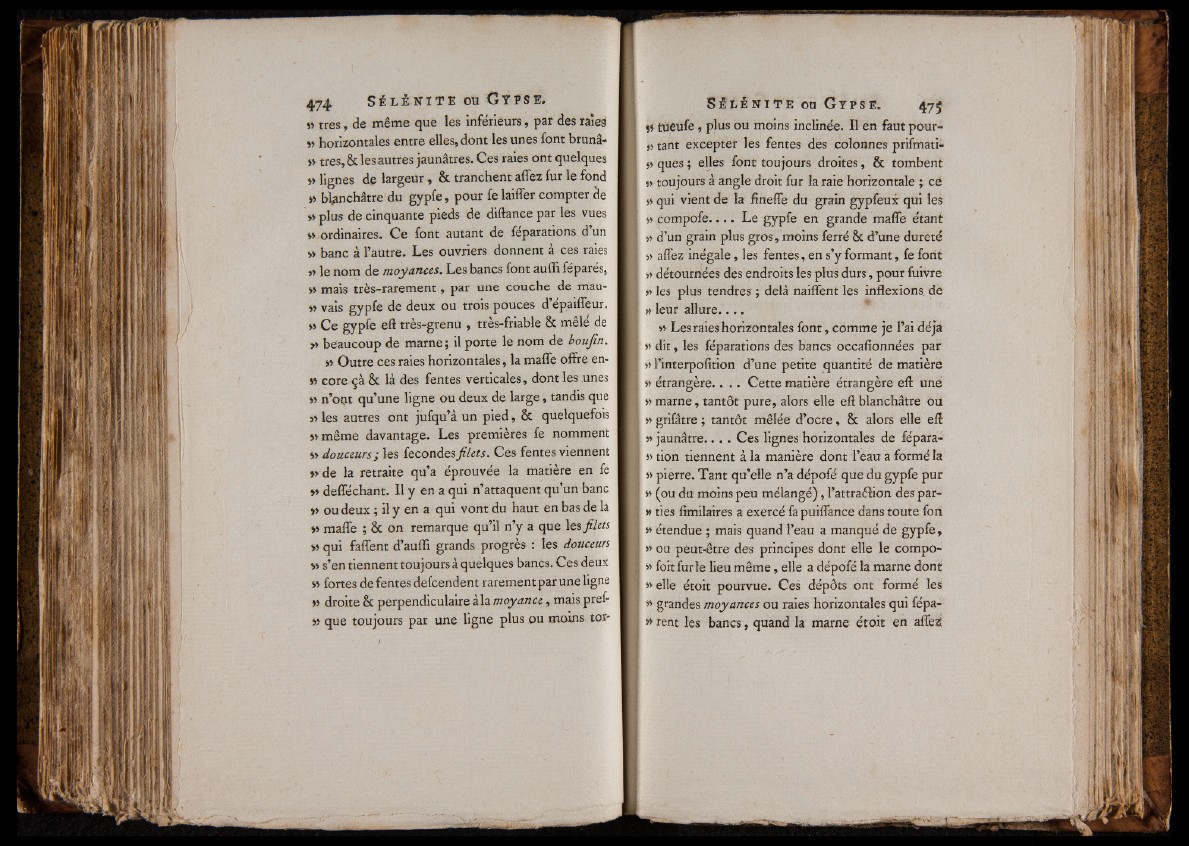
474 S É L é N i T E ou G y p s e .
»» tres, de même que les inférieurs, par des raies
« horizontales entre elles, dont les unes font brunâ-
»» tres, & les autres jaunâtres. Ces raies ont quelques
» lignes de largeur, 8c tranchent affez fur le fond
»» blanchâtre du gypfe, pour felaiffer compter cle
»»plus de cinquante pieds de diftance par les vues
»> ordinaires. Ce font autant de feparations d un
»> banc à l’autre. Les ouvriers donnent à ces raies
>» le nom de moyanees. Les bancs font aufïï fepares,
»> mais très-rarement, par une couche de mau-
»» vais gypfe de deux ou trois pouces d epaiffeur.
» Ce gypfe eft très-grenu , très-friable 8c mêlé de
» beaucoup de marne; il porte le nom de boujiti.
»> Outre ces raies horizontales, la maffe offre en-
»» core çà & là des fentes verticales, dont les unes
»» n’opt qu’une ligne ou deux de large, tandis que
»» les autres ont jufqu’à un pied, 8c quelquefois
»»même davantage. Les premières fe nomment
»» douceurs; les fécondés filets. Ces fentes viennent
»» de la retraite qu’a éprouvée la matière en fe
»> defféchant. Il y en a qui n’attaquent qu’un banc
» ou deux ; il y en a qui vont du haut en bas de la
»» maffe ; 8c on remarque qu’il n’y a que les filets
»» qui faffent d’auffi grands progrès : les douceun
»» s’en tiennent toujours à quelques bancs. Ces deux
»» fortes de fentes defeendent rarement par une ligne
»> droite 8c perpendiculaire à la moyance, mais pref-
» que toujours par une ligne plus ou moins tor*
S é l è n ï t e ou G y p s e . 475
I» tueufe, plus ou moins inclinée. Il en faut pour-
» tant excepter les fentes des colonnes prifmati-
»» ques ; elles font toujours droites, 8c tombent
»> toujours à angle droit fur la raie horizontale ; ce
»» qui vient de la fineffe du grain gypfeux qui les
a compofe.. . . Le gypfe en grande maffe étant
» d’un grain plus gros, moins ferré 8c d’une dureté
» affez inégale, les fentes, en s’y formant, fe font
>» détournées des endroits les plus durs, pour fuivre
m les plus tendres ; delà naiffent les inflexions de
» leur allure.. . .
»» Les raies horizontales font, comme je l’ai déjà
»> dit, les féparations des bancs occafionnées par
>> l’interpofition d’une petite quantité de matière
»» étrangère.. . . Cette matière étrangère eft une
»» marne, tantôt pure, alors elle eft blanchâtre ou
»» grifâtre ; tantôt mêlée d’ocre, 8c alors elle eft
«jaunâtre... . Ces lignes horizontales de fépara-
v> tion tiennent à la manière dont l’eau a formé la
» pierre. Tant qu’elle n’a dépofé que du gypfe pur
»» (ou du moins peu mélangé), l’attraélion des par-
» ties limilaires a exercé fa puiffance dans toute fon
4 étendue ; mais quand l’eau a manqué de gypfe,
>» ou peut-être des principes dont elle le compo-
« foit furie lieu même, elle a dépofé la marne dont
« elle étoit pourvue. Ces dépôts ont formé les
m grandes moy anees ou raies horizontales qui fépa-
«rent les bancs, quand la marne étoit en affezl