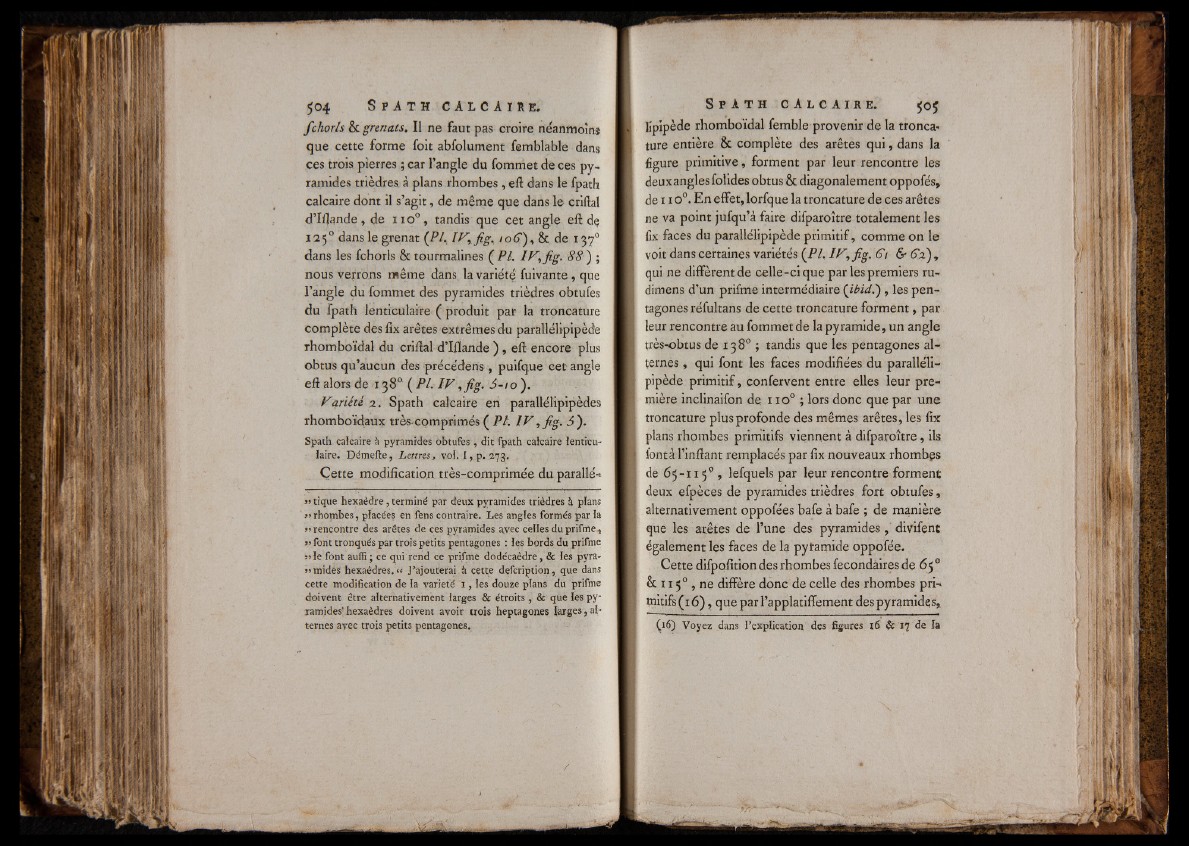
fchorls & grenats. Il ne faut pas croire néanmoins
que cette forme foit abfolument femblable dans
ces trois pierres ; car l’angle du fommet de ces pyramides
trièdres à plans rhombes , eft dans le fpath
calcaire dont il s’agit, de même que dans le criftal
d’Ifiande , de i x 0° , tandis que cet angle eft dç
12 50 dans le grenat (PL IV, fig, /o(T), & de 1370
dans les fchorls & tourmalines ( Pl. IV, fig. 88 ) ;
nous verrons même dans, la variété fuivante , que
l’angle du fommet des pyramides trièdres obtufes
du fpath lenticulaire ( produit par la troncature
complète des iîx arêtes extrêmes du parallélipipède
rhomboïdal du criftal d’Iilande ) , eft encore plus
obtus qu’aucun des précédens, puifque cet angle
eft alors de 138® ( Pl. I V , fig. 5 -to ).
Variété z . Spath calcaire en parallélipipèdes
rhomboïdaux très-comprimés ( PL IV , fig. 5 ).
Spath calcaire à pyramides obtufes, dit fpath calcaire lenticulaire.
Démefte, Lettres, vol. I , p. 273.
Cette modification très-comprimée du parallé--
» tique hexaèdre, terminé par deux pyramides trièdres à plans
» rhombes, placée? en fens contraire. Les angles formés par la
»rencontre des arêtes de ces pyramides ayec celles du prifme,,
» font tronqués par trois petits pentagones : les bords du prifme
5)le font auffi; ce qui rend ce prifme dodécaèdre, & les pyra-
»mides hexaèdres.« J’ ajouterai à cette defcription, que dans
cette modification de la variété 1 , les douze plans du prifme
doivent être alternativement larges & étroits , & que les p y
ramides-hexaèdres doivent avoir trois heptagones la r g e s ,a lternes
avec trois petits pentagones.
lipipède rhomboïdal femble provenir de la troncature
entière & complète des arêtes qui, dans la
figure primitive, forment par leur rencontre les
deuxanglesfolides obtus & diagonalement oppofés,
de x xo°. En effet, lorfque la troncature de ces arêtes
ne va point jufqu’à faire difparoître totalement les
fix faces du parallélipipède primitif, comme on le
voit dans certaines variétés (PL IV, fig. £T/ 6- 62) ,
qui ne diffèrent de celle-ci que par les premiers ru-
dimens d’un prifme intermédiaire (ibidé) , les pentagones
réfultans de cette troncature forment, par
leur rencontre au fommet de la pyramide, un angle
très-obtus de 138o ; tandis que les pentagones alternes
, qui font les faces modifiées du parallélipipède
primitif, confervent entre elles leur première
inclinaifon de 1 io° ; lors donc que par une
troncature plus profonde des mêmes arêtes, les fix
plans rhombes primitifs viennent à difparoître, ils
font à l’inftant remplacés par fix nouveaux rhombçs
de 65-115° , lefquels par leur rencontre forment
deux efpèces de pyramides trièdres fort obtufes,
alternativement oppofées bafe à bafe ; de manière
que les arêtes de l’une des pyramides, divifent
également les faces de la pytamide oppofée.
Cette difpofition des rhombes fecondàires de 65o
& i l 5° , ne diffère donc de celle des rhombes pri-
tnitifs (16 ), que par l’applatiffement des pyramides,
Ç16) Voyez dans l ’explication des figures 16 & 17 de la