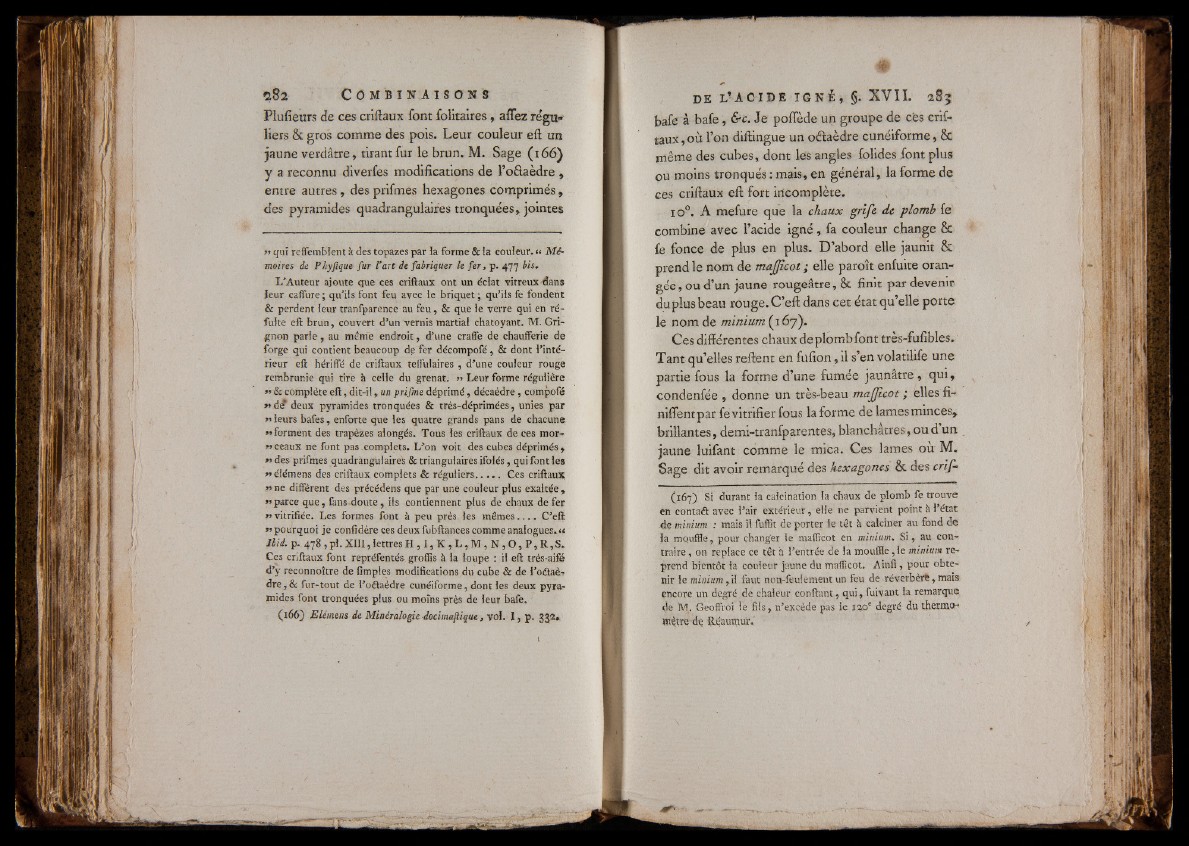
Plufieurs de ces criftaux font folitaires, aflez réguliers
& gros comme des pois. Leur couleur eft un
jaune verdâtre, tirant fur le brun. M. Sage (166)
y a reconnu diverfes modifications de l’oâaèdre ,
entre autres, des prifmes hexagones comprimés ,
des pyramides quadrangulaires tronquées, jointes
»> qui reffemblent à des topazes par la forme & la couleur. « Mémoires
de Phyjique fur l’ art de fabriquer le fe r , p. 477 bis.
L'Auteur ajoute que ces criftaux ont un éclat vitreux dans
leur caffure ; qu'ils font feu avec le briquet ; qu'ils fe fondent
& perdent leur tranfparence au fe u , & que le verre qui en ré-
fulte eft brun, couvert d’un vernis martial chatoyant. M. Gri-
gnon p a r le , au même endroit, d’une craffe de chaufferie de
forge qui contient beaucoup de fèr décompofé, & dont l’ intérieur
eft hériffé de criftaux teffulaires , d’ une couleur rouge
rembrunie qui tire à celle du grenat. « Leur forme régulière
» & complète e ft , dit-il, un prifme déprimé, décaèdre, compofé
« d e deux pyramides tronquées & très-déprimées, unies par
» leurs bafes, enforte que les quatre grands pans de chacune
»»forment des trapèzes alongés. Tous les criftaux de ces mor-
«ceau x ne font pas.complets. L ’ on voit des cubes déprimés,
»> des prifmes quadrangulaires & triangulaires ifolés , qui font les
«élémens des criftaux. complets & réguliers Ces criftaux
« ne diffèrent des précédens que par une couleur plus exaltée ,
»»parce q u e , fans.doute, ils contiennent plus de chaux de fer
«vitrifiée. Les formes font à peu près, les m êm e s .... C’eit:
»»pourquoi je confîdère ces deux fubftances comme analogues.«
lbid. p. 478 , p l. X III, lettres H , I , K , L , M , N , 0 , P , R , S .
Ces criftaux font repréfentés groffis à la loupe : il eft très-aile
d’y reconnoître de fimples modifications du cube & de i’oétaè-
d re , & fur-tout de l’ oétaèdre cunéiforme, dont les deux pyramides
font tronquées plus ou moins près de leur bafe.
(166) Elémens de Minéralogie docimaflique , vol. I , p. 332«
D E L ’ A C I D E I G N É , §. XVI I . 2 8 5
bafe à bafe, &c. Je poflede un groupe de ces criftaux
, où l’on diftingue un oélaèdre cunéiforme, &
même des cubes, dont les angles folides font plus
ou moins tronqués : mais, en général, la forme de
ces criftaux eft fort incomplète.
io°. A mefure que la chaux grife de plomb fe
combine avec l’acide igné, fa couleur change &
fe fonce de plus en plus. D ’abord elle jaunit &
prend le nom de majjîcot ; elle paroît enfuite orangée,
ou d’un jaune rougeâtre, & finit par devenir
du plus beau rouge. C ’eft dans cet état qu’elle porte
le nom de minium (167).
Ces différentes chaux de plomb font très-fufibles.
Tant qu’elles reftent en füfion, il s’en volatilife une
partie fous la forme d’une fumée jaunâtre, qui,
condenfée , donne un très-beau majjîcot ; elles fi-
niffentpar fe vitrifier fous la forme de lames minces,
brillantes, demi-tranfparentes, blanchâtres, ou d un
jaune luifant comme le mica. Ces lames ou M.
Sage dit avoir remarqué des hexagones & des crif-
(16 7) Si durant ia calcination la chaux de plomb fe trouve
en contait avec l’ air extérieur, elle ne parvient point à l’ état
rie minium : mais il fuffiit de porter le têt à calciner au fond de
la mouffle, pour changer le tnaffîcot en minium. S i , au contraire
, on replace ce têt à l’ entrée de la mouffle, le minium reprend
bientôt ia couleur jaune du mailicot. A in fi, pour obtenir
le minium, il faut non-feulement un feu de réverbère, mais
encore un degré de chaleur confiant, qui, fuivant la remarque
de M. Geoffroi le fils , n’excède pas le 12.0e degré du thermomètre
de Réaumur,