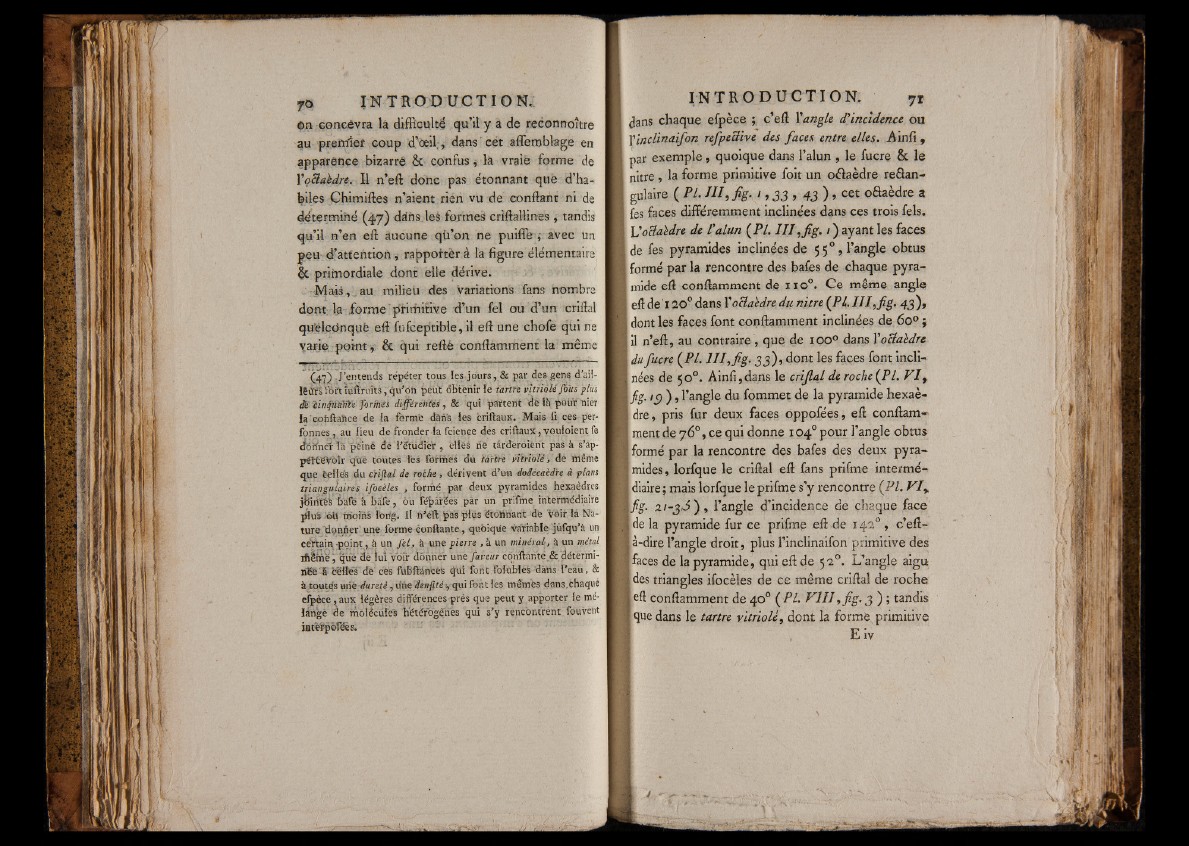
On concevra la difficulté qu’il y a de reconnoître
ciu premier coup d’oeil;, dans cet afferoblage en
apparence bizarre & confus, là vraie forme de
Y octaèdre. Il n’eft donc pas étonnant que d’habiles
Chimiftes n’aient rien vu de confiant ni de
déterminé (47) dàns les formes criftallines , tandis
qu’il n’en eft aucune qü’on ne puiflb ; avec un
peu d’attention, ra^poftèr à la figure élémentaire
prirnordiale donc elle dérive.
Maiâ,.au milieu des Variations fans nombre
dont fe- forme primitive d’un fel ou d’un criftal
qu'elcOnquè eft fufceptibie, il eft une chofe qüi ne
yarie point , & qui refté conftamment la même
( 4 7 ) .J’entends répéter tous les jou rs , & par des gens d’aif-
lêiYrifert i&fi'ruîts', qu’on peut dbteiîir le tarife vitriolé fous plus
de iinfiüiïîtê forihès différentes, & qui partent dè Ih pour 'nier
la cofiftance de la fèrmë dàn's les criftaux. Mais fi ces p’er-
fonnes, au lieu de fronder la feienee des criftaux , vouloient fe
cfôrineT îa peiné dé l’etudier , eues riè târderôiènt pas à s’ âp-
péttêVôîr que toutes les fdrrfiës dû ïàftre vitriole, de îrlême
que telles du criftal de roche , dérivent d’un dodécaèdre à plans
triangulaires ijoeeks . formé par deux pyramides hexaèdres
jo i i f lP ^ a le a B a ie . ou fépâréés par un prifme intermédiaire
pluS .611 niofhs Ibrtg. Il n’ éft pàs plus ëtohnant de vôir la Nature
"donéer’ une forme confiante, quoique variable jùfqu’ ïi un
ceVtain -point , ii un Jel, à une pierre , !a un minéral, h nn métal
rfiirnë', qûefdè ju î Voir donner une faveur cônftaffté.& détermi-
n t è ’ï cæîfës de ces fùbftântes qui font foiùbles dàWs l ’eau, &
à toutqs ttriè dureté, une denfité ■, qui font les mêmes dans,chaque
efpèce, aux légères différences près que peut y apporter le mélangé
c e molécules hétérogènes qui s’ y rencontrent fouvent
iaterpôféès.
I N T R O D U C T ION . 7 r
¿ans chaque efpèce ; c’eft Y angle d'incidence ou
\inclinaifon refpective des faces entre elles. Ainii ,
par exemple, quoique dans l’alun , le fucre & le
nitre, la forme primitive foit un oétaèdre rectangulaire
( PL I I I, fig. 1 , 2)3 , 4 3 ) » cet oâaèdre a
fes faces différemment inclinées dans ces trois fels.
L’octaèdre de l'alun (P l. I I I , fig, 1 ) ayant les faces
de fes pyramides inclinées de 5 5 ° , l’angle obtus
formé par la rencontre des bafes de chaque pyramide
eft conftamment de n o ° . Ce même angle
eft d e i 20° dans Y octaèdre du nitre (PL I I I, fig. 43),
dont les faces font conftamment inclinées de 6o° ;
| il n’eft, au contraire, que de ioo° dans Y octaèdre
| du fucre (PL I I I , fig, 33), dont les faces font incli-
jnées de 50°. Ainfi,dans le crifial de roche (PL V I ,
fig. tÿ ) , l’angle du fommet de la pyramide hexaè-
fdre, pris fur deux faces oppofées, eft conftamment
de 76°, ce qui donne 104° pour l’angle obtus
Iformé par la rencontre des bafes des deux pyra-
Imides, lorfque le criftal eft fans prifme intermédiaire;
mais lorfque le prifme s’y rencontre (Pl. V I ,
Jfig. 2/-3J ) , l’angle d’incidence dé chaque face
¡de la pyramide fur ce prifme eft de 14 2 0 , c’eft-
I à-dire l’angle droit, plus l’inclinaifon primitive des
Sfaces de la pyramide, qui eft de 520. L’angle aigu
des triangles ifocèles de ce même criftal de roche
¡eft conftamment de 40° (Pl. VI I I , fig. 3 ) ; tandis
[que dans le tartre vitriole, dont la forme primitive
E iv