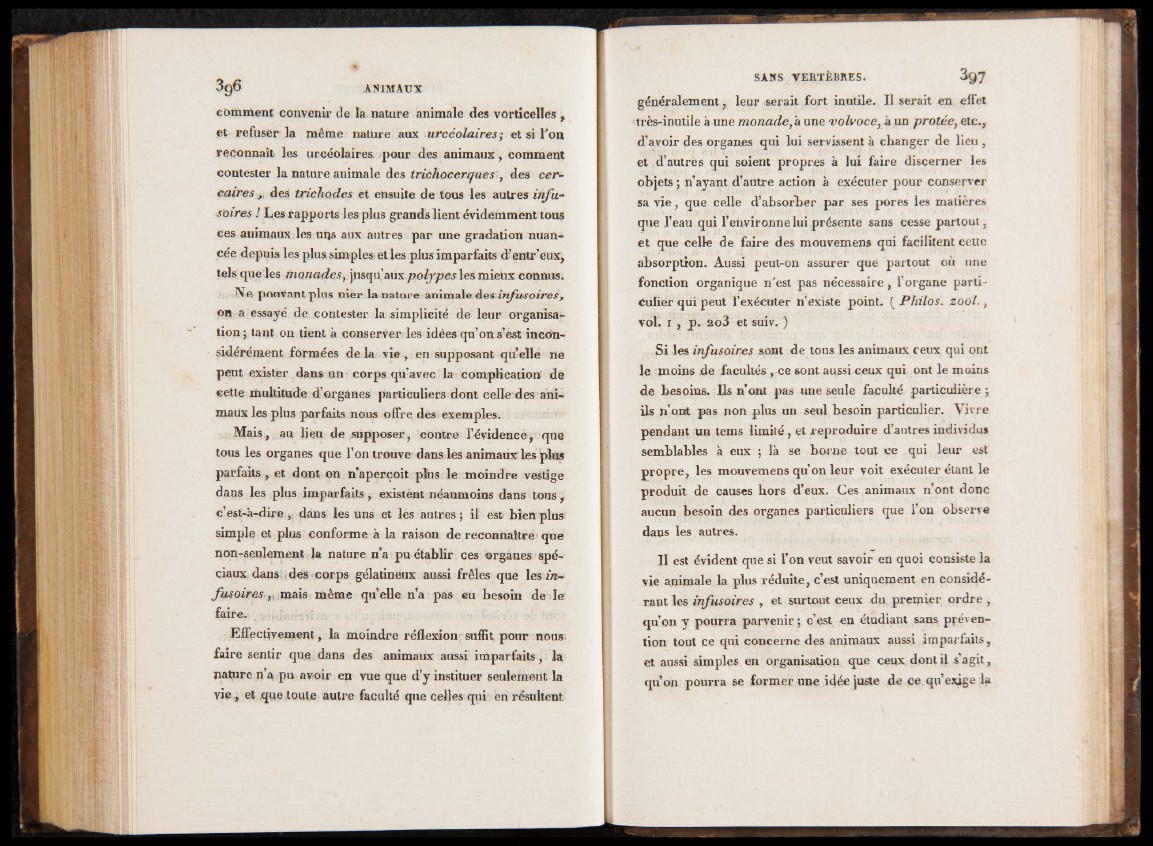
comment convenir de la. nature animale des vorticelles ,
et refuser la même nature aux u r c éo la ir e s ; et si Ton
reconnaît, les urcéolaires. .pour des animaux, comment
contester la nature animale des tvichocerques , des c e r -
caire s j, des tr ich od e s et ensuite de tous les autres in fu soires
! Les rapports les plus grands lient évidemment tous
ces auimaux les uijs aux autres par une gradation nuancée
depuis les plus simples» et les plus imparfaits d’entr’eux,
tels que les m o n a d e s , jusqu’aux p o ly p e s les mieux connus.
Ne pouvant plus nier la nature animale des in fu so ire s ,
on a essayé de contester la simplicité de leur organisation;
tant on tient à conserver» les idées qu’on s’est inconsidérément
formées de là vie , en supposant qu’elle ne
peut exister dans un corps qu’avec la complication; de
cette multitude d’organes particuliers dont celle des animaux
les plus parfaits nous offre des exemples.
Mais, au lieu de supposer, contre l’évidence, que
tous les organes que l’on trouve dans les animaux?les plus
parfaits , et dont on n’aperçoit plus le moindre vestige
dans les plus imparfaits, existent néanmoins dans tous,
c’est-à-dire, dans les uns et les autres; il est bien plus
simple et plus conforme à la raison de reconnaître'que
non-seulement la nature n’a pu établir ces organes spéciaux
dans des corps gélatineux aussi frêles que les infu
so ir e s . mais même qu’elle n’a pas eu besoin de le
faire.
Effectivement, la moindre réflexion suffit; pour nous»
faire sentir qu.e dans des animaux aussi imparfaits, la
nature n’a pu avoir en vue que d’y instituer seulement la
yie, et que toute autre faculté que celles qui en résultent
généralement, leur serait fort inutile. Il serait en effet
très-inutile à une monade, à une volvoce, à un protée, etc.,
d’avoir des organes qui lui servissent à changer de lieu ,
et d’autres qui soient propres à lui faire discerner les
objets ; n’ayant d’autre action à exécuter pour conserver
sa vie, que celle d’absorber par ses pores les matières
que l’eau qui l’environne lui présente sans cesse partout,
et que celle de faire des mouvemens qui facilitent cette
absorption. Aussi peut-on assurer que partout où une
fonction organique n'est pas nécessaire, l’organe particulier
qui peut l’exécuter n’existe point. ( Philos, zool. ,
vol. 1 , p. 2 o 3 et suiv. )
Si les infusoires sont de tous les animaux ceux qui ont
le moins de facultés , ce sont aussi ceux qui ont le moins
de besoins. Ils n’ont pas une seule faculté particulière ;
ils n’ont pas non plus un seul besoin particulier. Vivre
pendant un tems limité , et reproduire d’autres individus
semblables à eux ; là se borne tout ce qui leur est
propre, les mouvemens qu’on leur voit exécuter étant le
produit de causes hors d’eux. Ces animaux n’ont donc
aucun besoin des organes particuliers que l’on observe
dans les autres.
II est évident que si l’on veut savoir en quoi consiste la
vie animale la plus réduite, c’est uniquement en considérant
les infusoires , et surtout ceux du premier ordre ,
qu’on y pourra parvenir ; c’est en étudiant sans pyév en-
tion tout ce qui concerne des animaux aussi imparfaits,
et aussi simples en organisation que ceux dont il s’agit,
qu’on pourra se former une idée juste de ce qu’exige la