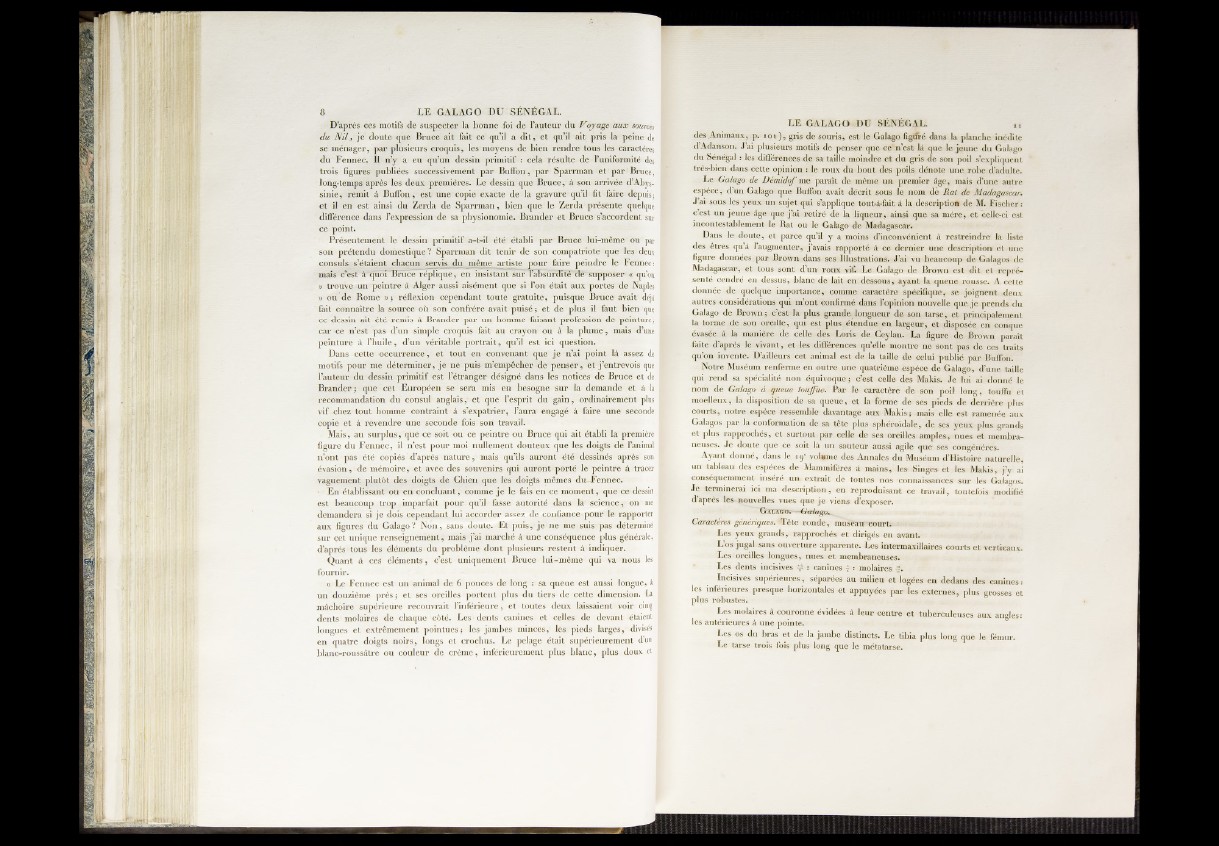
D’après ces motifs de suspecter la bonne foi de l’auteur du Voyage aux sources
du N ilj je doute que Bruce ait fait ce qu’il a dit, et qu’il ait pris la peine de
sé ménager, par plusieurs croquis, les moyens de bien rendre tous les caractères
du Fennec. Il n’y a eu qu’un dessin primitif : cela résulte de l’uniformité des
trois figures publiées successivement par Buffon, par Sparrman et par Bruce,
long-temps après les deux premières. Le dessin que Bruce, à son arrivée d’Abys-
sinie, remit à Buffon, est une copie exacte de la gravure qu’il fit faire depuis 5
et il en est ainsi du Zerda de Sparrman, bien que le Zerda présente quelque
différence dans l’expression de sa physionomie. Brander et Bruce s’accordent sur
ce point.
Présentement le dessin primitif a-t-il été établi par Bruce lui-même ou par
son prétendu domestique? Sparrman dit tenir de son compatriote que les deux
consuls s’étaient chacun servis du même artiste pour faire peindre le Fennec:
mais c’est à tjïïoi"Bruce réplique, en insistant sur l’absurdité dé supposer « qu’on
» trouve un peintre à Alger aussi aisément que si l’on était aux portes de Naples
» ou de Borne » j réflexion cependant toute gratuite, puisque Bruce avait déjà
fait connaître la source où son confrère avait puisé j et de plus il faut bien quç
ce dessin ait été remis à Brander par un homme faisant profession de peinture ;
car ce n’est pas d’un simple croquis fait au crayon ou à la plume, mais d’une
peinture à l’huile, d’un véritable portrait, qu’il est ici question.
Dans cette occurrence, et tout en convenant que je n’ai point là assez de
motifs pour me déterminer, je ne puis m’empêcher de penser, et j ’entrevois que
l’auteur du dessin primitif est l’étranger désigné dans les notices de Bruce et de
Brander 5 que cet Européen se sera mis en besogne sur la demande et à la
recommandation du consul anglais, et que l’esprit du gain, ordinairement plus
vif chez tout homme contraint à s’expatrier, l’aura engagé à faire une seconde
copie et à revendre une seconde fois son travail.
Mais, au surplus, que ce soit ou ce peintre ou Bruce qui ait établi la première
figure du Fennec, il n’est pour moi nullement douteux que les doigts de l’animal
n’ont pas été copiés d’après nature, mais qu’ils auront été dessinés après son
évasion, de mémoire, et avec des souvenirs qui auront porté le peintre à tracer
vaguement plutôt des doigts de Chien que les doigts mêmes du-Fennec.
En établissant ou en concluant, comme je le fais en ce moment, que ce dessin
est beaucoup trop imparfait pour qu’il fasse autorité dans la science, on me
demandera si je dois cependant lui accorder assez de confiance pour le rapporter
aux figures du Galago? Non, sans doute. Et puis, je ne me suis pas déterminé
sur cet unique renseignement, mais j ’ai marché à une conséquence plus générale,
d’après tous les éléments du problème dont plusieurs restent à indiquer.
Quant à ces éléments, c’est uniquement Bruce lui-même qui va nous les
fournir.
« Le Fennec est un animal de 6 pouces de long : sa queue est aussi longue, à
un douzième près -, et ses oreilles portent plus du tiers de cette dimension. La
mâchoire supérieure recouvrait l’inférieure, et toutes deux laissaient voir cinq
dents molaires de chaque côté. Les dents canines et celles de devant étaient
longues et extrêmement pointues5 les jambes minces, les pieds larges, divisés
en quatre doigts noirs, longs et crochus. Le pelage était supérieurement d’un
blanc-roussâtre ou couleur de crème, inférieurement plus blanc, plus doux et
LE GALAGO DU SÉNÉGAL. lt
des.Animaux, p. 101), gris de souris, est le Galago figuré dans la planche inédite
d’Adanson. J’ai plusieurs motifs de penser que ce'n’est là que le jeune du Galago
du Sénégal : les différences de sa taille moindre et du gris de son poil s’expliquent
très-bien dans cette opinion : le roux du bout des poils dénote une robe d’adulte.
Le Galago de Dèmidof me paraît de même un premier âge, mais d’une autre
espèce, d’un Galago que Buffon avait décrit sous le nom de Rat de Madagascar.
J’ai sous les yeux un sujet qui s’applique tout-à-fait à la description de M. Fischer :
c’est un jeune âge que j ’ai retiré de la liqueur, ainsi que sa mère, et celle-ci est
incontestablement le Rat ou le Galago de Madagascar.
Dans le doute, et parce qu’il y a moins d’inconvénient à restreindre la liste
des êtres qu’à l’augmenter, j ’avais rapporté à ce dernier une description* et une
figure données par Brown dans ses Illustrations. J’ai vu beaucoup de Galagos de
Madagascar, et tous sont d’un roux vifi Le Galago de Brown est dit et représenté
cendré en dessus, blanc de lait en dessous, ayant la queue rousse. A cette
donnée de quelque importance, comme caractère spécifique, se joignent deux
autres considérations qui m’ont confirmé dans l’opinion nouvelle que je prends du
Galago de Brown 5 c’est la plus grande longueur de son tarse, et principalement
la forme de son oreille, qui est plus étendue en largeur, et disposée en conque
évasée à la manière de celle des Loris de Geylan. La figure de Brown paraît
faite d’après le vivant, et les différences qu’élle montre ne sont pas de ces traits
qu’on invente. D’ailleurs cet animal est de la taille de celui publié par Buffon.
Notre Muséum renferme en outre une quatrième espèce de Galago, d’une taille
qui rend sa spécialité non équivoque y c’est celle des Makis. Je lui ai donné le
nom de Galago à queue touffue. Par le caractère de son poil long , touffu et
moelleux, la disposition de sa queue, et la forme de ses pieds de derrière plus
courts, notre espèce ressemble davantage aux Makis-, mais elle est ramenée aux
Galagos par la conformation de sa tête plus sphéroïdale, de ses yeux plus grands
et plus rapprochés, et surtout par celle de ses oreilles amples, nues et membraneuses.
Je doute que ce soit là un sauteur aussi agile que ses congénères.
Ayant donné, dans le 19e volume des Annales du Muséum d’Histoire naturelle,
un tableau des espèces de Mammifères à mains, les Singes et les Makis, j’y ai
conséquemment inséré un extrait de toutes nos connaissances sur les Galagos.
Je terminerai ici ma description, en reproduisant ce travail, toutefois modifié
d’après les nouvelles vues que je viens d’exposer.
Gàkcg to v— Galago
Caractères génériques. Tête ronde, museau? court.
Les yeux grands, rapprochés et dirigés en avant.
L’os jugal sans ouverture apparente. Les intermaxillaires courts et verticaux.
Les oreilles longues, nues et membraneuses.
Les dents incisives £ •' canines 7 : molaires ~.
Incisives supérieures, séparées au milieu et logées en dedans des canines:
les inférieures presque horizontales et appuyées par les externes, plus grosses et
plus robustes.
Les molaires à couronne évidées à leur centre et tuberculeuses aux angles:
les antérieures à une pointe.
Les os du bras et de la jambe distincts. Le tibia plus long que le fémur.
Le tarse trois fois plus long que le métatarse.