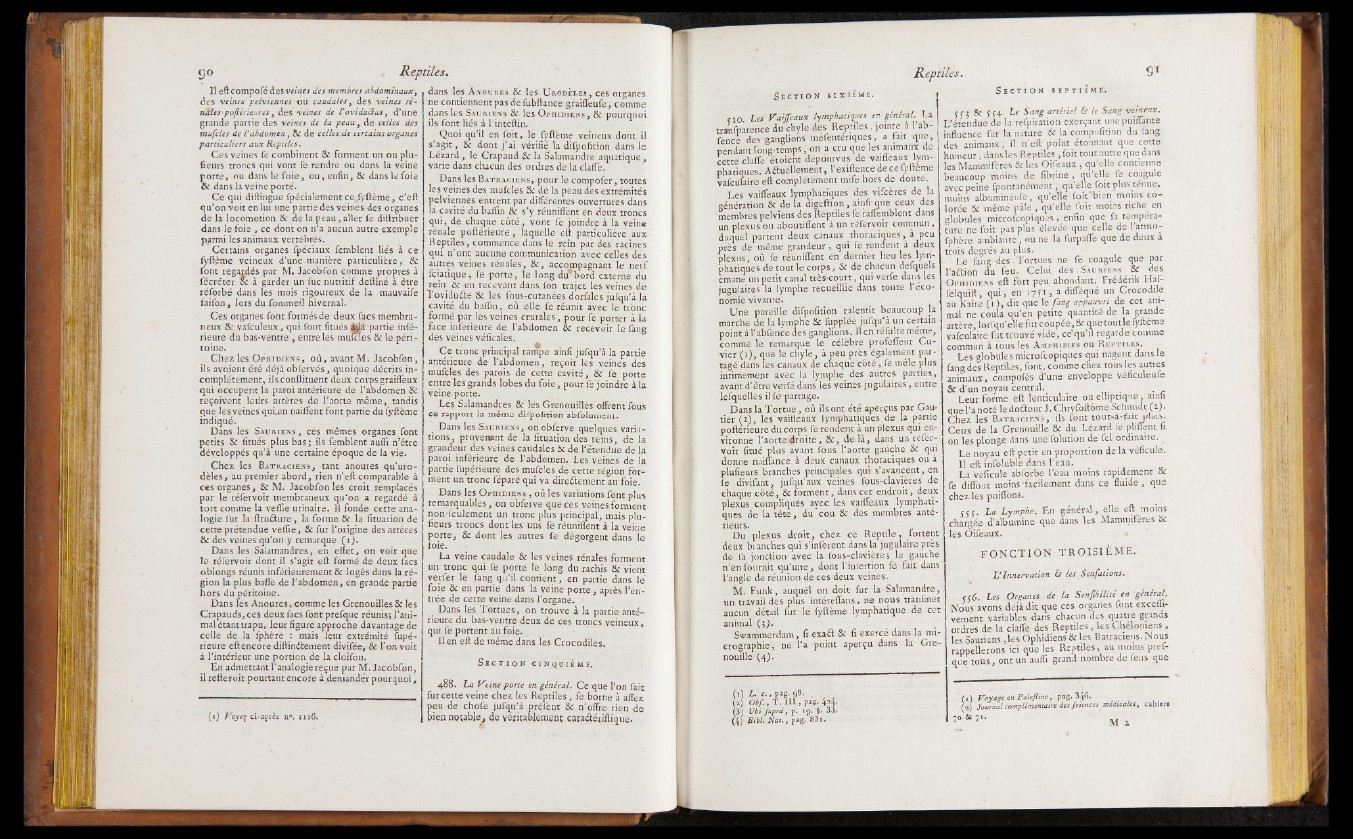
Il eftcompofé des veines des membres abdominaux,
des veines pelviennes ou caudales3 des veines ré-
nâles'poftérieures3 des veines de l'oviduftus3 d’une
grande partie des veines de la peauy de celles des
mufcles de l'abdomen 3 & de celles.de certains organes
particuliers aux Reptiles. ,
Ces veines fe combinent & forment un ou plu-
fieurs troncs qui vont fe rendre ou dans la veine
porte, ou dans le foie, ou, enfin, & dans le foie
& dans la veine porté.
Ce qui diftingue fpécialement ce^fyftème, c’eft
qu’ on voit en lui une partie des veines des organes
de la locomotion & de la peau, aller fe diftribuer
dans le foie , ce dont on n’a aucun autre exemple
parmi les animaux vertébrés.
Certains organes fpéciaux femblent liés à ce
lyffème veineux d’une manière particulière, &
font regardés par M. Jacobfon comme propres à
fécrétèr oc à garder un fuc nutritif deftiné à être
réforbé dans les mois rigoureux de la mauvaife
faifon, lors du fommeil hivernal. '
Ces organes font formés de deux facs membraneux
& vafculeux, qui font litués f|fô partie inférieure
du bas-ventre , entre les mulcles & le péritoine.
Chez les O ph id ien s , où, avant M. Jacobfon,
ils avoient été déjà obfervés, quoique décrits incomplètement,
ilsconftituent deux corps graifleux
qui occupent la paroi antérieure de l’abdomen &
reçoivent leurs artères de l’aorte même, tandis
que les veines qui,en nailfent font partie du fyftème
indiqué.
Dans les Sauriens , ces mêmes organes font
petits & fitués plus bas; ils femblent aufli n’être
développés qu’à une certaine époque de la vie.
Chez les Batraciens, tant anoures qu’uro-
dèlesi au premier abord, rien n’eft comparable à
ces organes, & M. Jacobfon les croit, remplacés
par le réfervoir membraneux qu’on a regardé à
tort comme la veflîe urinaire. 11 fonde cette analogie
fur la ftruêture, la forme & la fituacion de
cette prétendue veflie, & fur l’origine des artères
& des veines qu’on y remarque ( i) .
Dans les,Salamandres, en effet, on voit que
le réfervoir dont il s’agit eft formé de deux facs
oblongs réunis inférieurement & logés dans la région
la plus baffe de l’abdomen, en grande partie
hors du péritoine.
Dans les Anoures, comme les Grenouilles & les
Crapauds, ces deux facs font prefque réunis; l’animal
étant trapu, leur figure approche davantage de
celle de la fphère : mais leur extrémité fupé-
rieure eft encore diftin&ement divifée, & l’on, voit
à l’intérieur une portion de la cloifon.
En admettant l’analogie reçue par M. Jacobfon,
il refteroit pourtant encore à demander pourquoi,
( i) Voye\ ci-après n°. m 6 .
dans les A noures & les U rodèles, ces organes
ne contiennent pas de fubftance graiffeufe, comme
dans les Sauriens & les O phidiens, & pourquoi
ils font liés à Tinteftin.
Quoi qu’il en foit, le fyftème veineux dont il
s’agit, & dont .j’ai vérifié la difpofition dans le
Lézard, le Crapaud & la Salamandre aquatique,
varie dans chacun des ordres de la claffe.
Dans les Batraciens, pour le compofer, toutes
les veines des mufcles & de la peau des extrémités
pelviennes entrent par différentes ouvertures dans
la cavité dubaflin & s’y réunifient en deux troncs
qui, de chacjue côté, vont fe joindre à la veine
rénale poftérieure, laquelle eft particulière aux-
Reptiles, commence dans le rein par des racines
qui n’ont aucune communication avec celles des
autres veines, rénales, & , accompagnant le nerf
fciatique, fe porte, le long du*’bord externe du
rein & en recevant dans fon trajet les veines de
Toviduéte & les fous-cutanées dorfales jufqu’à la
cavité du baffin, où elle fe réunit avec le tronc
formé par les veines,crurales, pour fe porter à la
face inférieure de l'abdomen & recevoir le fang
des veines véficales.
Ce tronc principal rampe ainfi jufqu’à la partie
antérieure de l’abdomen, reçoit les veines des
mufcles des parois de cette cavité, & fe porte
entre les grands lobes du foie, pour fe joindre à la
veine porte.
Les, Salamandres & lés Grenouilles offrent fous
ce rapport la même difpofition abfolument.
Dans les Sauriens, onobferve quelques variations,
provenant de la fituation des reins, de la
grandeur des veines caudales & de l’etendue de la
paroi inférieure de l’abdomen. Les veines de la
partie fupérieure des.mufcles de cette région forment
un tronc féparé qui va dire&ement au foie.
Dans les O phid iens , où les variations font plus
remarquables, on obferve que ces veines forment
non-feulement Un tronc plus principal, mais plu-
fieurs troncs dont les uns fe réunifient à la veine
porte, & dont les autres fe dégorgent dans le
foie.
La veine caudale & les veines rénales forment
un tronc qui fe porte le long du rachis & vient
verfer le fang qu’il contient, en partie dans le
foie & en partie dans la veine porte , après l’entrée
de cette veine dans l’organe.
Dans les Tortues, on trouve à la partie antérieure
du bas-ventre deux de ces troncs veineux,
qui fe portent au foie.
lien eft de même dans les Crocodiles.
S e c t i o n c i n q u i è m e .
488. La Veine porte en général. Ce que l’on fait
fur cette veine chez les Reptiles , fe borne à allez
peu de chofe jufqu’ à préfent & n’offre rien de
bien notable, de véritablement caraélériftique. -
S e c t i o n s i x i è m e . S e c t i o n s e p t i è m e .
cio Les Vaijfeaux lymphatiques en général. La
trwifpàrence du chyle des Reptiles, jointe à l'ab-
fence des ganglions méfenteriques, a fait que,:
pendant long-temps, on a cru que les animaux de
cette claffe étoient dépourvus de vailïeaux lymphatiques.
Aétuellemeht, l'exiftence de ce fyftème
vafculaire eft complètement mife hors de doute.
Les vaifleaux lymphatiques des vifcères de la
génération 8c de la digeftion, ainfi-que ceux des
membres pelviens des Reptiles fe raffemblent dans
un plexus ou aboutiffent à un réfervoir commun,
duquel partent deux canaux thoraciques,, à peu
près- de même grandeur, qui fe rendent à deux
plexus j où fe réunifient en dernier lieu les lymphatiques
de tout le corps, 3c de chacun defquels
émane un petit canal très'-court, qui verfe dans les
jugulaires la lymphe recueillie dans toute l'économie
vivantê.
Une pareille difpofition ralentit beaucoup la
marche de la lymphe 8c fuppléé jufqu a un certain
point à l'abfence des ganglions. Il en réfulte même,
comme le remarque lé célèbre profefféur Cuvier
( i) , que le chyle, à peu près également partagé
dans les canaux de chaqüe'côté, fé mêle plus
intimement avec la lymphe, des autres parties,
avant d'être verfé dans les veines jugulaires, entre
lefquelles il fè partage.
Dans la Tortue, où ils ont été aperçus par Gautier
(a), les vaifleaux lymphatiques de la partie
poftérieure du corps fe rendent à un plexus qui environne
l’aorte droite, 8c, de-là, dans un réfervoir
fitué plus avant fous l'aorte gauche 8c qui
donne naiffance à deux canaux thoraciques ou à
plufieurs branches principales qui s'avancent, en
fe divifant, jufqu"aux veines fous-davières de
chaque côté, 8c forment, dans cet endroit, deux
plexus compliqués avec les vaifleaux lymphatiques
de la tête,, du'cou 8c des membres antérieurs.
Du plexus droit, chez ce Reptile, Portent
deux branches qui s'infèrent dans la jugulaire.près
de fa jonition- avec la fous-clavière ; le gauche
n’en fournit qu'une, dont l'infertion fe fait dans':
l'angle de réunion de ces deux veines.
M. Funk, auquél on doit fur la Salamandre,
un travail dès plus intéreffans, ne nous tranfmet
aucun détail fur -le fyftème. lymphatique de cet
animal (5).
Swammerdam, fi exaét 8c fi exercé dans la micrographie,
ne l’a point aperçu dans la Grenouille
(4).
(1) L. c . , paj. 98. .
(2) O b f., T. I I I , pas. 424-
(3) Ubi fuprà, p. 19. §. 33.
(4) Bibl. N a t., pag. 831.
8c 5Î4- U Sang artériel & le Sang veineux.
L'étendue de la refpiration exerçant unepuiffante
influence fur la nature 8c la compolîtion du fang
des animaux, il n'eft point étonnant que.cette
humeur, dans les Reptiles, foit tout autre que dans
les Mammifères 8c les Oifeaux , qu'elle contienne
beaucoup moins de fibrine , qu elle fe coagule
avec peine fpontanement, qu elle foit plus tenue,
moins albumineufe, qu'elle foit bien moins colorée
Sc même pâle, qu’elle foit moins riche en
globules microfcopiques, enfin que fa température
ne foit pas plus élévéé que celle de l’atmcr-
fphère ambiante, ou ne la furpàffe que de deux a
trois degrés au plus.
Le fang des.Tortues ne fe coagule que par
l'aftion du feu. Celui des .Sauriens 8c des
-O phidiens eft fbrt peu abondant. Frédérik Haf-
felquift, qui , én 1751, a difféqué un Crocodile
au Kaire (1 ), dit que le fang appauvri de cet am-
mal ne coula qu'en petite quantité de la grande
artère, lorfqu'elle fut coupée, 8c que toutle fyftema
vafculaire fut tr'ouvé vide, çe'qu’il regarde comme
commun à tous les Amphibies o u -Repti-les.
Les globules microfcopiques qui nagent dans le
fang des Reptiles, font, comme chez tous les autres
animaux, compofés d’une enveloppe véiiculeufe
8e d'un noyau central. , . .
Leur forme eft lenticulaire ou elliptique, ainli
quel'anoté ledofteur J. Ehryfoftôme.Schmidt (1).
Chez les Batraciens, ils font tout-a-fait plats.
Ceux de la Grenouille 8c du Lézard fe pliflent fi
on les plonge dans une folution de fel ordinaire. ,
Le noyau eft petit en proportion de la véficule.
11 eft infoluble dans l'eau.
La véficule abforbe l'eau moins rapidement 8c
fe diffout moins-facilement dans ce fluide, que
chez les poiffons.
rcr. La Lymphe. En général, elle eft moins
chargée d’albumine que dans lés Mammifères 8c
lés Oifeaux.
F O N C T IO N T R O IS IÈM E .
L*Innervation & les Senfations.
c<6. Les Organes de la Senfibilité en général.
Nous avons déjà dit que ces organes font excem-
vement vàriables dans chacun des quatre granüs
ordres de la claffe des Reptiles, les Chélomens,
les Sauriens, les Ophidiens 8c les Batraciens. Nous
rappellerons ici que'les Reptiles, au moins prefque
tous, ont un aufli grand nombre de fens que
, (1) Voyage en Paleftiney Ç az .Sfô- , .
(2) Journal complémentaire des fciences m e d ica le scajizcrs
70 U 71 . M z