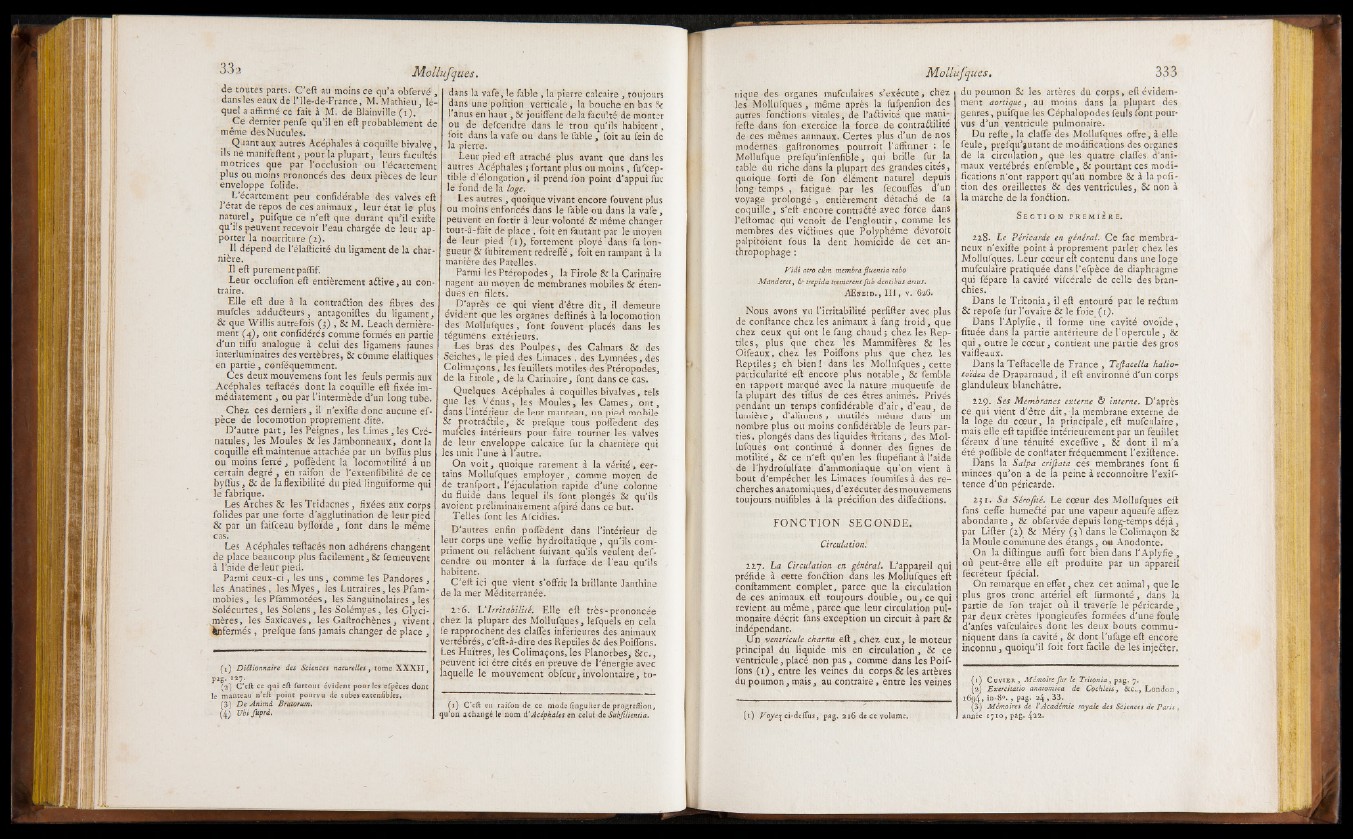
de toutes parts. C ’eft au moins ce qu’a obfervë,
dans les eaux de l’ Ile-de-France, M. Mathieu, lequel
a affirmé ce fait à M. de Blainville ( i) .
Ce dernier penfe qu’il en eft probablement de
même desNucules.
Quant aux autres Acéphales à coquille bivalve,
ils ne manifeftent, pour la plupart, leurs facultés
motrices que par l’occlusion ou l’écartement
plus ou moins prononcés des deux pièces de leur
enveloppe folide.
L’écartement peu confidérable des valves eft
l’état de repos de ces animaux, leur état le' plus
naturel, puifque ce n’eft que durant qu’il exifte
qu’ils peuvent recevoir l’ eau chargée de leur apporter
la nourriture (2).
Il dépend de l’élafticité du ligament de la charnière.
Il eft purement paflif.
Leur occlufîon eft entièrement aélive, au contraire.
Elle eft due à la contraction des fibres des
mufcles adduCteurs, antagoniftes du ligament,
& que Willis autrefois (3) , & M. Leach dernièrement
(4), ont confédérés comme formés en partie
d’un tiffu analogue à celui des ligamens jaunes
interluminaires des vertèbres, & cômme élaftiques :
en partie, conféquemment.
Ces deux mouvemens font les feuls permis aux
Acéphales teftacés dont la coquille eft fixée immédiatement
, ou par l’intermède d’un long tube.
Chez ces derniers , il n’exifte donc aucune ef-
pèce de locomotion proprement dite.
D’ autre part, les Peignes, les Limes, les Cré-
natules, les Moules & les Jambonneaux, dont la
coquille eft maintenue attachée par un byflus plus
ou moins ferré, pofîèdënt la locomotilité a un
certain degré, en raifon de l’extenfibilité de ce
byflus, & de la flexibilité du pied linguiforme qui
le fabrique.
Les Arches & les Tridacnes, fixées aux corps
folides par une forte d’agglutination de leur pied
& par un faifceau byfïoïde, font dans le même
cas. ~~
Les Acéphales teftaçés non adhérens changent
de place beaucoup plus facilement, & femeuvent
à l’aide de leur pied.
Parmi ceux-ci, les uns, comme les Pandores ,
les Anatines, lesMyes, les Lutraires, les Pfam-
mobies, les Pfammotées, les Sanguinolaires , les
Solécurtes, les Solens, les Solémyes, les Glyci-
mères, les Saxicaves, les Gaftrochènes, vivent
Enfermés , prefque fans jamais changer de place ,
(1 ) Dictionnaire des Sciences naturelles, /tome X X X I I ,
pagt.f )1 2C7’.eft ce qui eft furtouc évident pour les efpèces dont
le manteau n’eft point pourvu de tubes extenfibles,
(3 ) D e Animâ Brutorum.
- (4) Ubifuprà.
dans la vafe, le fable , la pierre calcaire, toujours
dans une pofition verticale, la bouche en bas Éfe
1 anus en haut, & jouiflent delà faculté de monter
ou de defcendre dans le trou qu’ ils habitent,
foit dans la vafe ou dans le fable, foit au fein de
la pierre.
Leur pied eft attaché plus avant que dans les
autres Acéphales > fortant plus ou moins , furcep-
tible d'élongation, il prend fon point d’appui fuc
le fond de la loge.
Les autres, quoique vivant encore fouvent plus
ou moins enfoncés dans le fable ou dans la vafe,
peuvent en fortir à leur volonté & même changer
tout-à-fait de place , foit en fautant par le moyen
de leur pied (1), fortement ployé dans fa longueur
Qc i'ubitement redreffé, foit en rampant à la
manière des Patelles.
Parmi les Ptéropodes, la Firole & la Carinaire
nagent au moyen de membranes mobiles & étendues
en filets.
D’après ce qui vient d’être dit, il demeure
évident que les organes deftinés à la locomotion
des Mollufques, font fouvent placés dans les
tégumens extérieurs.
Les bras des Poulpes, des Calmars & des
Seiches, le pied des Limaces, des Lymnées, des
Colimaçons, les feuillets motiles des Ptéropodes,
de la Firole, de la Carinaire, font dans ce cas.
Quelques Acéphales à coquilles bivalves, tels
que les Vénus, les Moules, les Cames, ont,
dans l’intérieur de leur manteau, un pied mobile
& protràéiile, & prefque tous pofledent des
mufcles intérieurs pour faire tourner les valves
de leur enveloppe calcaire fur la charnière qui
les unit l’une à l’autre.
On voit, quoique rarement à la vérité, certains
Mollufques employer, comme moyen de
de tranfport, l’éjaculation rapide d’une colonne
du fluide dans lequel ils font plongés & qu’ils
avoient préliminairement afpiré dans ce but.
Telles font les Afcidies.
D’autres enfin pofledent dans l’intérieur de
leur corps une veflie hydrofiatique , qu’ils compriment
ou relâchent fuivant qu’ils veulent defcendre
ou monter à la furface de l’eau .qu’ils
habitent.
Ç ’eft ici que vient s’offrir la brillante Janthine
de la mer Méditerranée.
1:6. U Irritabilité. Elle eft très-prononcée
chez la plupart des Mollufques, lefquels en cela
fe rapprochent des clafles inférieures des animaux
vertébrés, c’eft-à-dire des Reptiles & desPoifîons.
Les Huîtres, les Colimaçons, les Planorbes, &c<,
peuvent ici être cités en preuve de l’énergie avec
laquelle le mouvement obfcur,involontaire, to-
(1) C’eft en raifon de ce triode fîngulier de progrelïion,
qu’on a changé le nom à’Acéphales en celui de Subfilientia.
nique des organes mufculaires s’exécute, chez
les Mollufques , même après la fufpenfion des
autres fonctions vitales, ae l'aâivité que mani-
fefte dans fon exercice la force de contraélilité
de ces mêmes animaux. Certes plus d’un de nos
modernes gaflronomes pourroit l’affirmer : le
Mollufque prefqu’infenfible, qui brille fur la
table du riche dans la plupart des grandes cités,
quoique forti de fon élément naturel depuis
long temps , fatigué par les fecouffes a’un
voyage prolongé , entièrement détaché de la
coquille, s’eft encore contracté avec force dans
l’eftomac qui venoit de l’engloutir, comme les
membres des victimes que Polyphême dévoroit
palpitoient fous la dent homicide de cet anthropophage
:
Vidi atro cù.m membra fluentia tabo
Mandcret, 6* trépida tremerent fub dentibus anus.
A E neid. , I I I , v. 626.
Nous avons vu l’irritabilité perfifter avec plus
de confiance chez les anifriaux à fang froid, que
chez ceux qui ont le fang chaud ; chez les Reptiles,
plus que chez les Mammifères & les
Oifeaux, chez les Poiffons plus que chez les
Reptiles 5 eh bien ! dans les Mollufques, cette
particularité eft encore plus notable, & femble
en rapport marqué avec la nature muqueufe de
la plupart des tiflus de ces êtres animés. Privés
pendant un temps confidérable d’air, d’eau, de
lumière, d’alimens, mutilés même dans* un
nombre plus ou moins confidéràble de leurs parties,
plongés dans des liquides ftritans, des Mollufques
ont continué à donner des lignes de
motilité, & ce n'eft qu’en les ftupéfiant à l’aide
de Thydrofulfate d’ammoniaque qu’on vient à
bout d’empêcher les Limaces foumifes à des recherches
anatomiques, d’exécuter des mouvemens
toujours nuifibles à la précifion des différions.
F O N C T IO N S E C O N D E .
Circulation’.
227. La Circulation en général. L’appareil qui
préfide à cette fonction dans les Mollufques eft
conftamment complet, parce que la circulation
de ces animaux ell toujours double, ou, ce qui
revient au même, parce que leur circulation pulmonaire
décrit fans exception un circuit à part &
indépendant.
Un ventricule charnu eft, chez eux, le moteur
principal du liquide mis en circulation, & ce
ventricule, placé non pas, comme dans les Poiffons
( 1 ) , entre les veines du corps & les artères
du poumon, mais, au contraire, entre les veines
(1) Voye^ ci-dcffus, pag. 216 de ce volume.
du poumon &: les artères dû corps, eft évidemment
aortique, au moins dans la plupart des
genres, puifque les Céphalopodes feuls font pourvus
d’un ventricule pulmonaire.
Du refte, la clafle des Mollufques offre, à elle
feule, prefqu’autant de modifications des organes
de la circulation, que les quatre clafles d’ animaux
vertébrés enfemble, & pourtant ces modifications
n’ont rapport qu’au nombre & à la pofition
des oreillettes & des ventricules, & non à
la marche de la fonction.
S e c t i o n p rem i è r e .
228. Le Péricarde en général. Ce fac membraneux
n’exifte point à proprement parler chez les
Mollufques. Leur coeur eft contenu dans une loge
mufculaire pratiquée dans l’ efpèce de diaphragme
qui fépare la cavité vifcérale de celle des branchies.
Dans le Tritonia, il eft entouré par le reétum
& repofe fur l’ovaire & le foie (1).
Dans l’Aplyfie, il forme une cavité ovoïde,
fituée dans la partie antérieure de l ’opercule, &
qui1 outre le coeur, contient une partie des gros
vaifl’eaux.
Dans la Teftacelle de France , Tefiacella halio-
toïdea de Draparnaud, il eft environné d’un corps
glanduleux blanchâtre.
229. Ses Membranes externe & interne. D’après
ce qui vient d’être dit, • la membrane externe de
la loge du coeur, la principale, eft mufculaire,
mais elle eft tapiflee intérieurement par un feuillet
féreux d’une ténuité exceffive, & dont il m’a
été poflible de conftater fréquemment l’exiftence.
Dans la Salpa criftata ces membranes font fi
minces qu’on a de la peine à reconnoître l’ exiftence
d’un péricarde.
231. Sa Sérofité. Le coeur des Mollufques eft
fans celle humeété par une vapeur aqueufe affez
abondante, & obfervée depuis long-temps déjà,
par Lifter (2) & Méry (3^ dans le Colimaçon &
la Moule commune des étangs, 0« Anodonte.
On la diftingue auffi fort bien dans l’Aplyfie ,
où peut-être elle eft produite par un appareil
fécréteur fpécial.
On remarque en effet, chez cet animal, que le
plus gros tronc artériel eft furmonté, dans la
partie de fon trajet où il traverfe le péricarde,
par deux crêtes fpo.ngieufes formées d’une foule
d’anfes vafculaires dont les deux bouts communiquent
dans fa cavité , & dont l’ufage eft encore
inconnu, quoiqu’il foit fort facile de les injeéter.
(1) C uvier , Mémoire fur le 'Tritonia, pag. 7.
(2) Exercitatio anatomica de Cochleis, &c„, London ,
1694, in-8°., pag. 2 4 , 33.
(3) Mémoires de CAcadémie royale des Sciences de Paris,
année 1710, pag. 422.