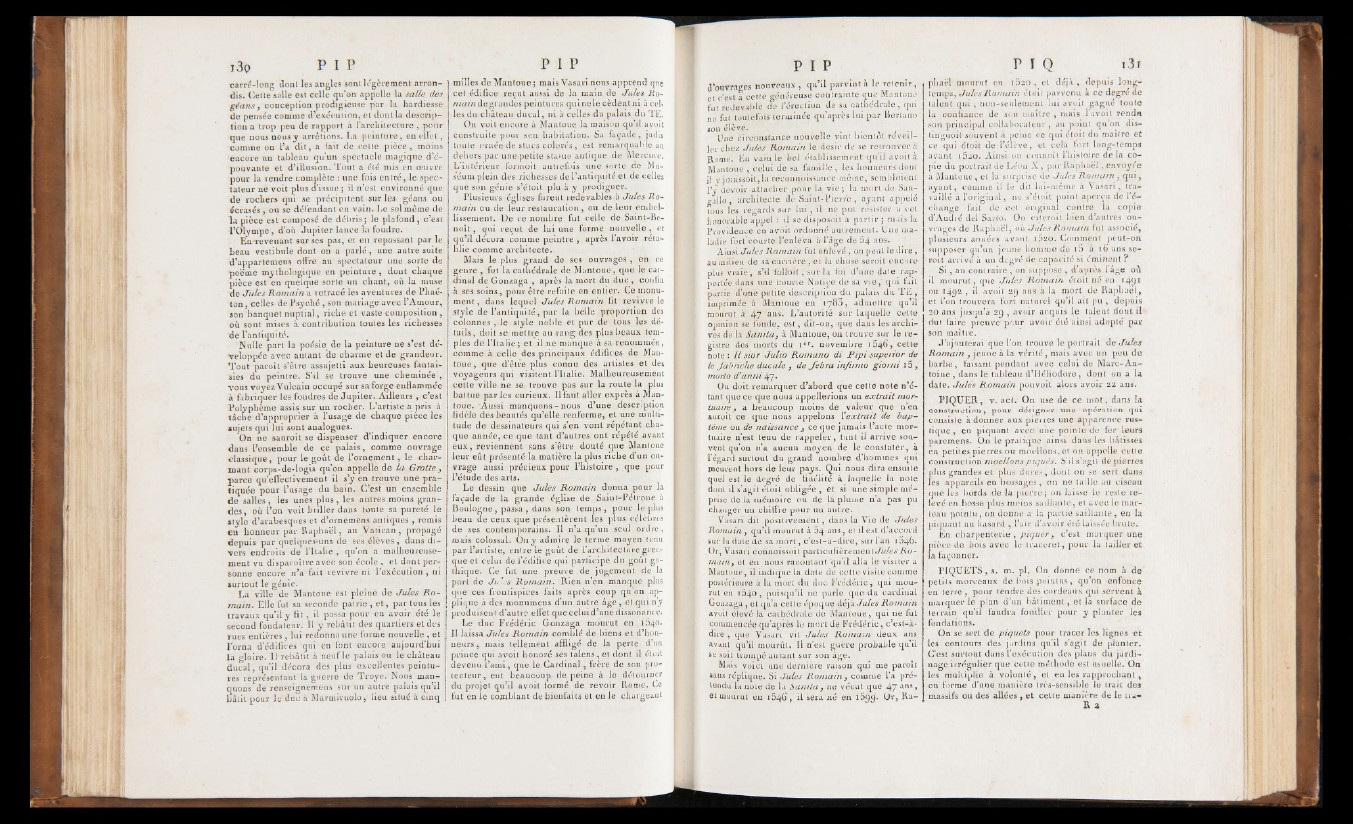
carré-long dont les angles sont légèrement arrondis.
Celle salle est celle qu’on appelle la salle des
géans, conception prodigieuse par la hardiesse
de pensée comme d’exécution, et dont la description
a trop peu de rapport à l'architecture , pour
que nous nous y arrêtions. La peinture, en effet,
comme on l’a d it, a fait de cette p ièce, moins
encore un tableau qu’un spectacle magique d’épouvante
et d’illusion. Tout a été mis en oeuvre
pour la rendre complète : une fois entré,-le spectateur
ne voit plus d’issue ; il n’est environné que
de rochers qui se précipitent sur les géans ou
écrasés , ou se défendant en vain. Le sol même de
la pièce est composé de débris; le plafond, c ’est
l ’Olympe, d’où Jupiter lance la foudre.
Enrrevenant sur ses pas, et en repassant par le
beau vestibule dont on a parlé, une autre suite
d’apparteniens offre au spectateur une sorte de
poëme mythologique en peinture, dont chaque
pièce est en quelque sorte un chant, où la muse
de Jules Romain a retracé les aventures de Phaé-
ton, celles de Psyché, son mariage avec l’Amour,
son banquet nuptial, riche et vaste composition ,
où sont mises à contribution toutes les richesses
de l’antiquité.
Nulle part la poésie de la peinture ne s’est développée
avec autant cle charme et de grandeur.
Tout paroit s’être assujetti aux heureuses fantaisies
du peintre. S’il se trouve une cheminée',
vous voyezVulcain occupé sur sa forge enflammée
à fabriquer les foudres de Jupiter. Ailleurs , c ’est
Polyphème assis sur un rocher. L’artiste a pris à
tâche d’approprier à l’usage de chaque pièce lés
sujets qui lui sont analogues.
On ne sauroit se dispenser d’indiquer encore
dans l ’ensemble de ce palais, comme ouvrage
classique, pour le goût de l’ornement, le charmant
corps-de-logis qu’on appelle de la Grotte
parce qu’effectivement il s’y en trouve une pratiquée
pour l’usage du bain. C’est un ensemble
de salles, les unes plus, les autres moins grandes,
où l’on voit briller dans toute sa pureté le
style d’arabesques et d’ornemens antiques , remis
en honneur par Raphaël, au Vatican, propage
depuis par quelques-uns de ses élèves , dans divers
endroits de lTlalie , qu’on a malheureusement
vu disparoîlre avec son école , et dont personne
encore n’a' fait revivre ni l ’execution , ni
surtout le génie.
La ville de Mantoue est pleiné de Jules Ro main.
Elle fut sa seconde patrie , e t , par tous les
travaux qu’il y f i t , il passa pour en avoir été le
second fondateur. Il y rebâtit des quartiers et des
rues entières , lui redonna une formé nouvelle , et
l ’orna d’édifices qui en font encore, aujourd’hui
la gloire. Il rebâtit à neuf le palais ou le château
ducal, qu’il décora dès plus excellentes peintures
représentant la guerre de Troye. Nous manquons
de renseignemens sur un autre palais qu’il
bâtit pour le duc à Marmiruolo, lieu situé à cinq
milles de Mantoue; mais Vasari nous apprend que
cet édifice reçut aussi de la main de Jules Romain
de grandes peintures qui ne le cèdent ni à celles
du château ducal, ni à celles du palais du TE.
On voit encore à Mantoue la maison qu’il avoit
construite pour son habitation. Sa façade, jadis
toute ornée de stucs colorés, est remarquable au
dehors par une petite s laine antique de Mercure.
.L’intérieur formoit autrefois une sorte de Muséum
plein des richesses de l’antiquité et de celles
que son génie s’étoit plu à y prodiguer.
Plusieurs églises furent redevables à Jules Romain
ou de leur restauration , ou de leur embellissement.
De ce nombre fut celle de Saint-Ben
o ît, qui reçut de lui une forme nouvelle, et
qu’il décora comme peintre , après l ’avoir rétablie
comme architecte.
Mais le plus grand de ses ouvrages , en ce
genre , fut la cathédrale de Mantoue , que le car-
diual de Gonzaga , après la mort du duc, confia
à ses soins, pour être refaite en entier. Ce monument,
dans lequel Jules Romain fit revivre le
style de l ’antiquité, par la belle proportion des
colonnes , le style noble et pur de tous les détails,
doit se mettre au rang des plus beaux temples
de l’Italie; et il ne manque à sa renommée,
comme à celle des principaux édifices de Mantoue,
que d’être plus connu des artistes et des
voyageurs qui visitent l’Italie. Malheureusement
cette ville ne se trouve pas sur la route la plus
battue par les curieux. Il faut aller exprès à Mantoue.
'Aussi manquons - nous d’une description
fidèle des beautés qu’elle renferme, et une multitude
de dessinateurs qui s’en vont répétant,chaque
année, ce que tant d’autres ont répété avant
eux, reviennent sans s’être douté que Mantoue
leur eût présenté la matière la plus riche d’un ouvrage
aussi précieux pour l’histoire , que pour
l’étude des arts.
Le dessin que Jules Romain donna pour la
façade de la grande église de Saint-Pétrone à
Boulogne, passa , dans son temps, pour le plus
beau de ceux que présentèrent les plus célèbres
de ses contemporains. Il n’a qu’un seul ordre;,
mais colossal. On y admire le terme moyen tenu
par l’artiste, entre le goût de Pareililecture grecque
et celui de l’édifice qui participe du goût gothique.
Ce fut une preuve de jugement de la
part de Jules Romain. Rien n’en manque plus
que ces froutispices faits après coup qu’on applique
à des monumens d’un autre â g e , et qui n’y
produisent d’autre effet que celuid’ une dissonance.
Le duc Frédéric Gonzaga mourut en i 54°*
Il laissa Jules Romain comblé de biens et d’honneurs,
mais tellement affligé de la perle d’un
prince qui avoit honoré ses talens, et dont il étoit
devenu l’ami, que le Cardinal, frère de son protecteur,
eut beaucoup de peine à le détourner
du projet qu’il avoit formé de revoir Rome. Ce
fut en le comblant de bienfaits et en le chargeant
d’ouvrages nouveaux , qu’il parvint à le velenir,
et c’est à cette généreuse contrainte que Mantoue.
fut redevable de l’érection de sa cathédrale, qui
ne fat toutefois terminée qu’après lui par Berlaûo
son élève. , . A ,
Une circonstance nouvelle vint bientôt réveiller
chez Jules Romain le désir de se retrouver à.
Rome. Lu vain le bel établissement qu’il avoit à
Mantoue , celui de sa famille , les honneurs dont
il y jouissoit, la rëcoiinoissaiice même, sembloient
Py devoir attacher pour la vie ; la mort de-San-
gallo , architecte de Saint-Pierre , ayant appelé
tous les regards sur lu i, il ne put résister a cet
honorable appel : il se disposoit à partir ; mais la
Providence en avoit ordonné autrement. Une maladie
fort courte l’enleva à l’âge de 54 uns.
Ainsi Jules Romain fat enlevé, on peut le dire,
au milieu de sa carrière , et la chose seroit encore
plus Vraie, s’il falloit, sur la foi d’une date rapportée
dans une courte Notice de sa vie ,~ qui luit
partie d’une petite description du palais du T E ,
imprimée à Mantoue en 1783, admettre qu’il
mourut à 47 aus* L ’autorité sur laquelle cette
opinion se fonde, es t, dit-on, que dans les archives
de la Sanita, à Mantoue, ou trouve sur le registre
des morts ,du 1er. novembre 1546, celle
note : I l sior Julio Romano di P ip i superior de
le Jabiiche ducale , de Jèbra infinno giorni 15 ,
morto d’anni 47«
On doit remarquer d’abord que cettd note n’étant
que ce que nous appellerions un extrait mortuaire
y a beaucoup moins de valeur que n’en
auroit ce que nous appelons l’extrait de baptême
ou de naissance i ce que jamais l’acte mortuaire
n’est tenu de rappeler, tant il arrive souvent
qu’on n’a aucun moyen de le constater, à
l’égard surtout du grand nombre d’hommes qui
meurent hors de leur pays. Qui nous dira ensuite
quel est le degré de fidélité à laquelle la note
dont il s’agit étoit obligée , et si une simple méprise
de la mémoire ou de là plume n’a pas pu
changer un chiffre pour un autre.
Vasari dit positivement, dans la Vie de Jules
Romainy qu’ il mourut à 54 ans, ei il est d’accord
sur la date de sa mort, c ’est-à-dire, sur l’an 1 546.
Or, Vasari corinoissoit particulièremenl«7b/<?.? Ro-
rnainy et eu nous racontant qu’il alla le visiter a
Mantoue, il indique la date de cette visite comme
postérieure à la mort du duc Frédéric, qui mourut
en i 540, puisqu’il ne parle que du cardinal
Gouzaga , et qu’à cette époque déjà Jules Romain
avoit élevé la cathédrale de Mautoue, qui ne fut
commencée qxraprès le mort de Frédéric, c’est-à-
dire , que Vasari vit Jules Romain deux ans
avant qu’il mourût. Il n’est guère probable qu’il
se soit trompé autant sur son âge.
Mais voici une dernière raison qui me paroît
sans réplique. Si Jules Romainy comme l’a prétendu
la noie de la Sanita, ne vécut que 47 ans>
et mourut en 1546 , il sera né en 1599b Or, Rapîiaël
mourut en i 520, et d éjà , depuis longtemps,
Jules Romain étoit parvenu à ce degré de
talent qui , non-seulement lui avoit gagné toute
la confiance de son maître , mais l’avoil rendu
son principal collaborateur , au point qu’on dis-
linguoit souvent à peine ce qui étoit du maître et
ce qui étoit de l’élève, et cela fort long-temps
avant 1520. Ainsi.on connoîl l’histoire de la copie
du portrait de Léon X , par Raphaël", envoyée
à Mantoue, et la surprise de Jules Romain , qui,
ayant, comine il le dit lui-même à Vasari , travaillé
à l’original, ne s’éloit point aperçu de l’échange
fait de cet original contre la copie
d’André del Sarlo. On eileroit bien d’autres ouvrages
de Raphaël,.où Jules Romain lut associé,
plusieurs années avant i 5ao. Comment peut-on
supposer qu’ un jeune homme de i 5 à 16 ans seroit
arrivé à un degré de capacité si éminent?
S i , au contraire , on suppose , d’après l’âge où
il mourut, que Jules Romain étoit né en 149*
ou 1492 , il avoit 29 ans à la mort de Raphaël,
et l’on trouvera fort naturel qu’il ait pu , depuis
20 ans jusqu’à 29 , avoir acquis le talent dontiL
dut faire preuve'pour avoir été ainsi adopté par
son maître. ■
J ’ajouterai que l’on trouve le portrait de Jules
Romain , jeune à la vérité, mais avec un peu de
barbe, faisant pendant avec celui de Marc-Antoine
, dans le tableau d’Iléliodore, dont on a la
date. Jules Romain pouvoit alors avoir 22 ans.
PIQUER, v. act. On use de ce mot, dans la
Construction, pour désigner une opération qui
consiste à donner aux pierres une apparence rustique
, en piquant avec une pointe de 1er leurs
paremens. On le pratique ainsi dans les bâtisses
en petites pierres ou moellons, et on appelle cette
construction moellxmspiqués. S’il s’agit de pierres
p lus grandes et plus dures, dont on se sert dans
les appareils en bossages, on ne (aille au ciseau
que les bords de la pierre; on laisse le reste relevé
en bosse plus moins saillante, ei avec le marteau
pointu, on donne à la partie saillante , en la
piquant au hasard , l ’air d’avoir été laissée brute.
En charpenterie , piquer, c’est marquer une
pièce de bois avec le traCerel, pour la tailler et
la façonner.
PIQUETS, s. m. pl. On donne ce nom à de
petits morceaux de bois pointus, qu’on enfonce
en terre , pour tendre des cordeaux qui servent à
marquer le plan d’un bâtiment, et la surface de
terrain qu’il faudra fouiller pour y planter les
fondations.
On se sert de piquets pour tracer les lignes -et
les contours des jardins qu’il s’agit de planter.
C’est surtout dans l’exécution des plans du jardinage
irrégulier que cette méthode est usuelle. On
les multiplie à volonté, et en les rapprochant,
on forme d’une manière très-sensible le trait des
massifs ou des allées , et cette manière de le ira*
R 3