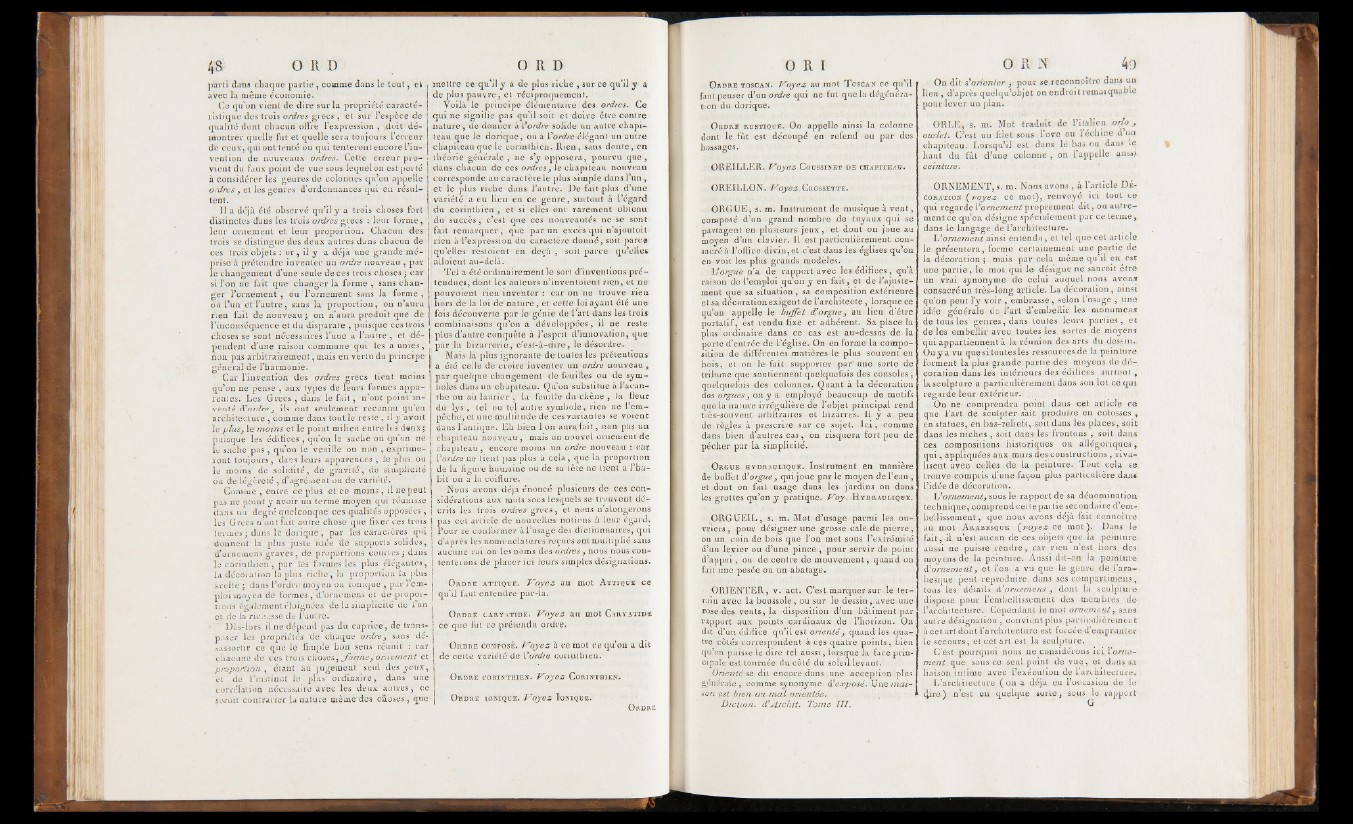
parti dans chaque partie , comme dans le tout, et i
avec la même économie.
Ce qu’on vient de dire sur la propriété caractéristique
des trois ordres grecs , et sur l’espèce de
qualité dont chacun oïl ire l’expression , .doit démontrer
quelle fut et quelle sera toujours l’erreur
de ceux, qui ont tenté ou qui tenteront encore l’invention
de nouveaux ordres■ Cette erreur provient
du faux poiul de vue sous lequel on est porté
à considérer les genres de colonnes qu’on appelle
ordres , et les genres d’ordonuances qui en résultent.
11 a déjà été observé qu’il y a trois choses fort
distinctes dans les trois ordres grecs : leur forme,,
leur ornement et leur proportion. Chacun des
trois se distingue des deux autres dans chacun de
ces trois objets : o r , il y a déjà une grande méprise'à
prétendre inventer un ordre nouveau , par
le changement d’une seule de ces trois choses 5 car
si l’on ne fait que changer la forme , sans changer
l ’ornement, ou l ’ornement sans la forme ,
ou i’un etTautre, sans la proportion, on n’aura
rien fait de nouveau $ on n’aura produit que de
l'inconséquence et du disparate , puisque cés trois
choses se sont nécessaires l’une à l’autre, et dépendent
d’une raison commune qui les a unies,
rion pas arbitrairement , mais en vertu du principe
général de l’harmonie.
Car l’invention des ’ ordres grecs tient moins
qu’on ne pense , aux types de leurs formes apparentes.
Les Grecs , dans le fait , n’ont point inventé
d'ordre } ils ont seulement reconnu qu’en
architecture., comme dans tout le reste , ily 'avoit
ïe plus y le moins et le point milieu entre les deux ;
puisque les édifices , qu’on le sache ou qu’on ne
le sache pas , qu’on le veuille ou non , exprimeront
toujours, daus leurs apparences , le plus, ou
le moins de solidité, de gravité, de simplicité
ou de légèreté , d’agrément ou de variété.
Comme , entre ce plus et ce moins , il ne peut
pas ne point y avoir un terme moyen qui réunisse
clans un degré quelconque ces qualités opposées ,
les Grecs n’ûut l’ail autre chose que fixer ces trois
termes j dans le dorique, par les caractères qui
donnent la plus juste idée de supports solides,
d’ornemens graves, de proportions courtes j dans
le corinthien, par les formes les plus élégantes,
la décoration la plus riche , la proportion la plus
svelte j dans l’ordre moyen ou ionique , par remploi
moyeu de formes d’urnernéns et de proportions
également éloignées- de la simplicité de l’un
et de la richesse de l’autre.
Dès-lors il ne dépend pas du caprice, de transposer
les propriétés de chaque ordres sans désassortir
ce que le (impie bon sens réunit : car
chacune de ces trois choses, forme, ornement et
proportion , étant au jugement seul des yeux,
et de l'instinct le plus ordinaire, dans une
corrélation nécessaire avec les deux autres, ce
§oroit contrarier la nature même des choses -, que
mettre ce qu’il y a de plus riche , sur ce qu’il y à
de plus p a u v re , et réciproquement.
Voilà le principe élémentaire des ordres. Ce
qui ne signilie pas qu’il soit et doive être contre
nature , de donner à Ÿordre solide un autre chapiteau
que le dorique, ou à 1 -ordre élégant un autre
chapiteau que le corinthien. Rien, sans doute, en
théorie générale, ne s’y opposera, pourvu que,
dans chacun de ees ordres, le chapiteau nouveau
corresponde au caractère le plus simple dans l’un,
et le plus riche dans, l’autre. De fait plus d’une
variété a en lieu en ce genre, surtout à 1 égard
du corinthien , et si elles ont rarement obtenu
du succès, c ’est que ces nouveautés ne se sont
fait remarquer, que par un excès qui n’aj ou toit
rien à l’expression du caractère donné, soit parc®
qu’elles resloient en deçà , soit parce qu’elles
ailoient au-delà.
Te l a été ordinairement le sort d’inventions prétendues,
dont les auteurs n’inventoient rien, et ne
pouvoieut rien inventer : car on ne trouve rien
hors dé‘la loi de nature, et cette loi ayant été une
fois découverte par le génie de 1 art dans les trois
combinaisons qu’on a développées, il ne reste
plus d’autre conquête à l’esprit d’innovation, que
par ,1a bizarrerie:, c’est-à-dire, le désordre.
Mais la plus ignorante de toutes les prétentions
! a été celle de croire inventer un ordre nouveau ,
par. quelque changement de feuilles ou de sym-
: boles dans un chapiteau. Qu’on substitue à> l’acan-
! the ou au laurier y la feuille du chêne , la fleur
du lys., tel ou tel autre symbole, rien ne l’empêche,
ei une multitude de ces variantes se voient
dans l’antique. Eh bien 1 011 aura fait, non pa§ un
chapiteau nouveau, mais un nouvel ornement de
chapiteau, encore moins un ordre nouveau ; car
Vordre ne tient pas plus à cela-, que la proportion
de la ligure humaine ou de sa tête ne lient a l’habit
ou a la coi Hure,
Nous avons déjà énoncé plusieurs de ees considérations
aux mots sous lesquels se trouvent dé-
| crûs les trois ordres grecs, et nous n’a longerons
pas cet article de nouvelles notions- à leur égard.
Pour se conformer à l’usagé des dictionnaires, qui
d’après les nomenclatures reçues ont multiplié sans
aucune rai .on les noms des ordres , nous nous con-
tenteions de placer ici leurs simples désignations»
Ordre att iqu e. Voyez au mot A ttiqve ce
qu’il faut entendre par-la.
Ordre ca rya t id e. Voyez au mot Caryatid e
c e que fut ce prétendu ordre.
Ordre coiïposé. Voyez à ce mot ce qu’on a dit
de c e lle variété de Vordre corinthien.
O rdre' corinthien. Voyez Corinthien.
Ordre ionique. Voyez Ionique.
<iu
Ordre
Ordre toscan. Voyez au mot T oscan ce qu’il
faut penser d’un ordre qui ne fut que la dégénéra-*
tion du dorique.
Ordre rustique. On appelle ainsi la colonne
dont le fût est découpé en refend ou par des
bossages.
OREILLER. Voyez C oussinet de chapiteau.
OREILLON. Voyez Crossette.
ORGUE, s. m. Instrument de musique à vent,
composé d’nn grand nombre de tuyaux qui se
pavtagent en plusieurs jeux* et dont on joue au
moyen d’un clavier. Il est particulièrement consacré
à l ’office divin,et c’est dans les églises qu’on
en voit les plus grands modèles.
L’orgue n’a de rapport avec les édifices, qu’à
raison de l’emploi qu’on y en fait, et de l’ajustement
que sa situation, sa composition extérieure
et sa décoration exigent de l’architecte, lorsque ce
qu’011 appelle le biiffet d'orgue, au lieu d’être
portatif, est rendu fixe et adhérent. Sa place la
plus ■ ordinaire dans ce cas est au-dessus de la
porte d’entrée de l ’église. On en forme la composition
de différentes matières le plus souvent en
bois, et on le fait supporter par* une sorte de
tribune que soutiennent quelquefois des consoles,
quelquefois des colonnes. Quant à la décoration
des orgues y on y a employé beaucoup de motifs
que la nature irrégulière de l’objet principal rend
tiès^-souveut arbitraires et bizarres. Il y a peu
de règles à prescrire sur ce sujet. I c i , comme
dans bien d’autres cas, on risquera fort peu de
pécher par la simplicité.
Orgue hydraulique. Instrument en manière
de buffet d'orguey quijoue par le moyen de l’eau ,
et dont on fait usage dans, les jardins on dans
les grottes qu’on y pratique. Voy- H ydraulique.
ORGUEIL, s. m. Mot d’usage parmi les ouvriers
, pour désigner une grosse cale de pierre,
ou un coin de bois que l ’on met sous l ’extrémité
d’un levier ou d’une pince , pour servir de point
d’appui, ou de centre de mouvement, quand on
fuit une pesée ou un abatage,
- ORIENTER, v. act. C’est marquer sur le terrain
avec la boussole, ou sur le dessin, avec une
rosé des vents, la disposition d’un bâtiment par
rapport aux points cardinaux de l’horizôn. On
dit d’un édifice qu’il est orienté 9 quand les qoa-;
tre côtés correspondent à cçs quatre points, bien
qu’on puisse le dire tel aussi, lorsque la face principale
est tournée du côté du soleil levant.
Orienté se dit encore dans une acception plus
générale, comme synonyme d'exposé. U ne maison
çst bien ou mal orientée. . . . . • >
Diction, d’Ajch.it. Tonie III.
On dit s’orienter , pour se reconnoilre dans un
lieu, d’après quelqu’objet on endroit remarquable
pour lever un plan.
. ORLE, s. m. Mot traduit de l ’italien orlo >
ourlet. C’est un filet sous l’ove ou 1 échine d uu
chapiteau. Lorsqu’il est. dans le bas ou dans le
haut du fût d’une colonne , on l’appelle aussi
ceinture.
ORNEMENT, s. m. Nous avons , à-l’article Déc
o r a t io n (voyez ce mot), renvoyé ici tout ce
qui regarde l’ornement proprement dit, ou autrement
ce qu’on désigne spécialement par ce terme,
dans le langage de l ’architecture.
ornement ainsi entendu , et tel que cet article
le présentera, forme certainement une partie de
la décoration j mais par cela même qu’il en est
une partie, le mot qui le désigne ne sauroit être
un vrai synonyme de celui auquel nous avons
consacré un très-long article. La décoration, ainsi
qu’on peut l’y voir , embrasse, selon 1 usage , une
idée générale dt l’art d’embellir les monumens
de tous les genres, dans toutes leurs pariies, et
de les embellir avec toutes les sortes de moyens
qui-appartiennent à la réunion des arts du dessin.
On y a vu que si toutes les ressources de la peinture
forment la plus grande pariie des moyens de décoration
dans les intérieurs des édifices surtout ,
la sculpture a particulièrement dans son lot ce qui
regarde leur extérieur. .
On ne comprendra point dans cet article ce
que l ’art de sculpter sait produire en colosses ,
en statues, en bas-reliefs, soit dans les places, soit
dans les niches , soit dans les frontons , soit dans
ces compositions historiques ou allégoriques,
qui, appliquées aux murs des constructions , rivalisent
avec celles de la peinture. Tout cela se.
trouve compris d’une façon plus particulière dan*
l ’idée de décoration.
ornement, sous le rapport de sa dénomination
technique, comprend cette partie secondaire d’em-
: bel lisse ment, que nous avons déjà fait connoi tre
au mot A r a b e s q u e (voyez ce mot). Dans le
fait, il. n’est aucun-de ces objets que la peiulure
aussi ne.puisse rendre, car rien n’est hors des
moyens de la peinture. Aussi dit-on la peinture
à?ornement, et l’on a vu: que le genre de l'arabesque
peut reproduire dans ses corn parti mens,
toijis les détails à’ or/iemens , dont la sculpture
dispose pour l’embellissement des membres de
l’aic.hilecture. Cependant le mot o rn em en tsans
autre désignation, convient plus particulièrement
à cefc art dont l’architecture est forcée d’emprunter
le secours, et cet art est la sculpture.
C’est pourquoi nous ne considérons îci.Yorne-
ment que sous ce seul point de vue, et dans sa
liaison intime avec l’exécution de l'architecture.
L’architecture (on a déjà eu l’occasion de le
4ire) n’esL en quelque sorte, sems le rapport
G