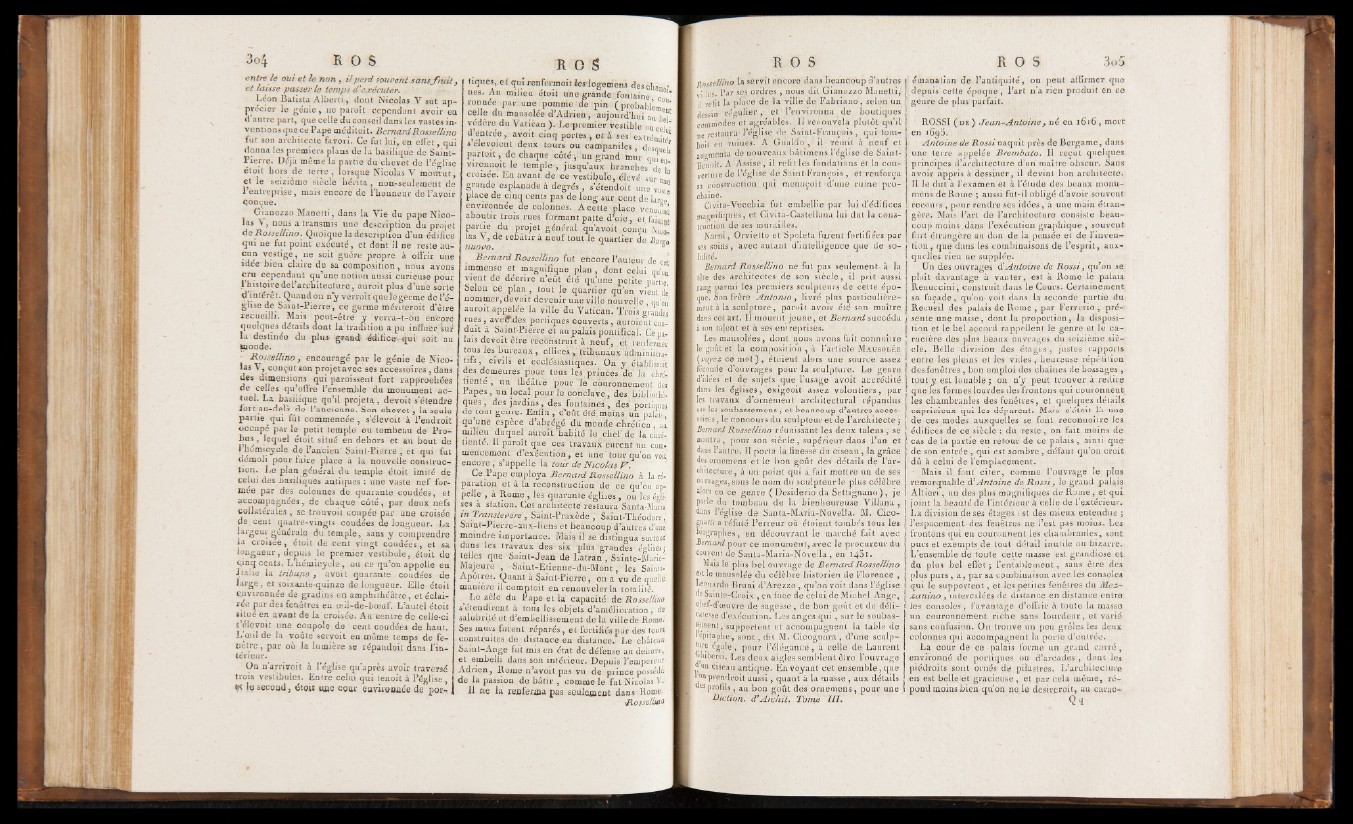
3o4 H O S
entre le oui et le non , i l perd souvent sans fr u it ,
et laisse passer le temps d’exécuter.
Léon Batista Alberti, dont Nicolas V sut apprécier
le génie, ne paraît cependant avoir eu
d’autre part, que celle du conseil dans les vastes inventions
que ce Pape méditoit. BernardRossellino
fut son architecte favori. Ce fut lui, en effet, qui
donna les premiers plans de la basilique de Saint-
Pierre. Déjà même la partie du chevet de l’église
étoit hors de terre , lorsque Nicolas V mourut,
et le seizième siècle hérita, non-seulement de
l ’entreprise, mais encore de l'honneur de l ’avoir
qonçue.
Çianozzo Manelti , dans la Vie du pape Nicolas
\ , nons a transmis une description du projet
de Rossellino. Quoique la description d’un édifice
qui ne fut point exécuté, et dont il ne reste aucun
vestige, ne soit guère propre à offrir une
idée bien claire de sa composition, nous avons
cru cependant qu’une notion aussi curieuse pour
1 histoire del’architecture, auroit plus d’une sorte
d intérêt. Quand on n y verroit quelégerme de l’église
de Saint-Pierre, ce germe mérileroit d’être
recueilli. Mais peut-être y verra—t-on encore
quelques détails dont la tradition a pu infîuër lu r
la destinée du plus* grand1 -édifice-^ùi' soit -au
monde.
Rossellino, encouragé par le génie de Nicolas
V , conçut son projet avec ses accessoires, dans
des dimensions qui paroissent fort rapprochées
de celles qu’offre l’ensemble du monument actuel.
La basilique qu’il projeta, devoit s’étendre
iort au-delà de l’ancienne. Son chevet , la seule
partie qui fût commencée, s’-éleyoit à l ’endroit
occupe par le petit temple ou tombeau de Prob
u s , lequel étoit situé en dehors et au bout de
l’hémicycle dé l’ancien' Saint-Pierre , et qui fut
démoli pour faire place à la nouvelle cons truc-
lion. Le plan général du temple étoit imité de
celui des basiliques antiques : une vaste nef formée
par des colonnes de quarante coudées, et
accompagnées, de chaque côté, par deux nefs
collatérales , se trou voit coupée par une croisée
de cent quatre-vingts coudées de longueur. La
largeur générale du temple, sans y comprendre
la croisée, étoit de cent vingt coudées;, et sa
longueur, depuis le premier vestibule, étoit de
Cinq cents. L'hémicycle, ou ce qu’on appelle en
Italie la tribune, avait quarante coudées de
la rg e , et soixante-quinze de longueur. Elle étoit
environnée de gradins en amphithéâtre, et éclairée
par des fenêtres eu oeil-de-boeuf. L’autel étoit
situé en avant de la croisée. Au centre de celle-ci
s’élevoit une coupole de cent coudées de haut.
L ’oeil de la voûte servoit en même temps de fenêtre
, par où la lumière se répandoit dans l'intérieur.
On n’arrivoit à l ’église qu’après avoir traversé
trois vestibules. Entre celui qui tenoit à l’église, I
w le second, étoit une cour environnée de por- J
R O S
tiques, e£ qui renfermoit ies'logemens d e s c liw
nés. Au milieu étoit une grande, fontaine c
ronnée par une pomme de Jn»*(ÿjtfbÿ! l Q
celle du mausolée d’Adrien, aujourd'hui au bP|
védère du Vatican ). Le-premier Vestible ou ce] '
dentrée, avoir cinq portes , et à ses : extuSuJ!
s elevoieut deux tours ou campaniles , desane]
partait, de chaque côté, un grand mur qujj.1
vironnoit le temple , jusqu’aux branches de il
croisée. En avant de ce vestibule, élevé sur „ne
grande esplanade à degrés , s’étendoit une vasie
place de cinq cents pas de long ,sur cent de la»,
environnée de colonnes. , A cette place venoisot
aboutir trois rues formant patte d’pie, et, faisant
partie du projet général qu’avoit conçu .NiCfJr
las V , de rebâtir à neuf tout le quartier de Bonn
nUQPO. ■ •;( - j ,• „ . f ? '• ü '
Bernard Rossellino fut encore l’auteur de c,et
immense et magnifique plan , dont celui qu’on
vient de décrire n’eût été qu’une petite partie.
Selon ce plan, tout le quartier qu’on vient de
nommer, devoit devenir une ville nouvelle , cniou
auroit appelée la ville du Vatican. Trôis grandes
rues, avefffies portiques couverts , auroient conduit
à Saint-Pierre et au palais pontifical. Ce palais
devoit être reconstruit à neuf, é,t renfermer
tous les bureaux, offices tribtunâux administra- I
tifs, civils et ‘ecclesiastiques. On y établîssoit
des demeures pour tous les.princès de la chrétienté
, un théâtre pour le couronnement des
Papes, un local pour le conclave, des, bibliothè-
ques, des jardins, des fontaines , des' portiques
de tout genre. Enfin, c’eût été.moins un palais, I
qu’une espèce d’abrégé du monde chrétien , aù
milieu duquel auroit habité le chef de la clfçffi
tien té.- Il paroît que ces travaux eurent uu comrj
mericement d’exécùtion, et une touy qu’on voit
encore , s’appelle la tour de Nicolas P'.
Ce Pape employa Bernard Rossellino à la réparation
et à la reconstruction de ce qu’on appelle
, à Rome , lès quarante églises , ou les églises
à station. Cet architecte' restaura Santa-Maru
in Transteveré, Sàinl-Praxède , Saint-Théodore,'
Saint-Pierfe-aùx-liens et beaucoup d’autres d’une J
moindre importance. Mais il se distingua surtout
dans les travaux des six plus grandes églisesj
telles que Saint-Jean de Latran , Sainte-lVlarie-
Majeurq , -Saint-Etiênne-du-Mont, les Saints-
Apôtres. Quant à Saint-Pierre, on a vu fie quelle'
manière il comptoit en renouveler la totalité.
Le zèle du Pape et là capacité de Rossellino
s étendirent à tous les objets d’amélioration, de
salubrité et d’embellissement de la ville de Rome.'
Ses murs furent réparés, et fortifiés par des tours;
construites de distance en distance. Le château'
Saint-Ange fut mis en état de défense au dehors,
et embelli dans son intérieur. Depuis l’empereur
Adrien, Rome n’avoit pas vu de prince possédé
de ia passion de bâtir , comme le fut Nicolas V*
Xi ne la renferma pas seulement dans Rome.
Rossellino
R O S
Rossellîho la servit encore dans beaucoup d’autres
| Par ses ordres , nous dit Gianozzo Manetii,
i j refit la place de la ville de Fabriano, selon un
f dessin régulier ,- e t : [’environna de boutiques
commodes et agréables. Il renouvela plutôt qu’il
ne restaura l’église de Sai'nl-François, qui tom-
j)0ii en r uimes. A Gitâldôy il ré mil à neuf et
augmenta de nôuveaiixbâtimens l’église de Saint-
Benoît. A Assise, il refit lés fondations et la cou-
i verture de l’église de Saint-François , et renforça
'sa construction, qui menaçoit d’une ruine pro-
cbaine. ..
I Civita-Vecchia fut embellie par lui d’édifices
magnifiques, et Civita-Castellana lui dut la construction
de ses murailles.
j Narni, Orvietto et Spoleta furent fortifiées par
[ses soins, avec autant d’intelligence que de solidité.
- , ;
j Bernard Rossellino ne fut pas seulement- à la
I tête des architectes de son siècle, il prit aussi
[rang parmi les premiers sculpteurs de cette époque.
Son frère Antonio, livré plus particulièrement
à la sculpture, paroît avoir été son maître
[ dans cet art. Il mourut jeune, et Bernard succéda
à son talent «t à ses eni reprises-.
| Les mausolées, dont nous avons fait connoîlïe
lie goût et la composition , à l’article Mausolée
\ (voyez ce m ot), éloient alors une source assez 1 féconde d’ouvrages pour la sculpture. Le genre
I d’idées et de sujets que l’usage avoit accrédité
[dans les églises, exigeoit assez volontiers, pailles
travaux d’ornemeut architectural répandus
[ sur les soubàsseraens, et beaucoup d’autres acces-
[ soires , le concours du sculpteur et de l’architecte 3
Bernard Rossellino réunissant les deux talens ,"se
[ montra, pour son siècle, supérieur dans l’un et
| dans l’antre. Il porta la finesse-du ciseau, la grâce
[ des ornemens et le bon goût des détails de l ’ar-
jehitecture, à un point qui à fait mettre un de ses
ouvrages., sous le nom du sculpteurle plus célèbre
alors en ce genre ( Desiderio da Settignano), je
parle du tombeau de la bienheureuse Villana ,
I dans l’église de Santa-Maria-Novella. M. Cico-
gnarà a réfuté l ’erreur où étoienl tombés tous les
c biographes, en découvrant le marché fait avec
■ Bernard pour ce monument, avec le procureur du
[couvent de Santa-Maria-Novella , en 14-51
Mais le plus bel ouvrage de Bernard Rossellino
1 est le mausolée du célèbre historien de Florence ,
I Leonardo Bruni d’Arezzo , qu’on voit dans l ’église
de Sainte-Croix , en face de celui de Michel Ange,
clief-d?oeuvre de sagesse, de bon goût et de déli-
i Cdiesse d’exécution. Les anges q u i, sur le soubas-
! sernent, supportent et accompagnent la table de 1 épitaphe, sont, dit M. Cicognara , d’une sculp-
p'r? ^ga^e 1 pour l’élégance, à celle de. Laurent
hdibeni. Les deux aigles semblent être l’ouvrage
d un ciseau antique. En voyant cet ensemble, que
F°apvendroit aussi , quant à la masse , aux détails
ûes profils, au bon goût des ornemens, pour une
Diction, d’Aichit. Tomp III.
R O S 3 o 5
émanation de l’antiquité, on peut affirmer que
depuis cette époque, l ’art n’a rien produit en ce
genre de plus parfait.
ROSSI ( d e ) Jean-Antoiney né en 16 16, mort
en i6q5. ;
Antoine de Rossi naquit près de Bergame, dans
une terre appelée Brembato. Il reçut quelques
.' principes d’architecture d’un maître obscur. Sans
avoir appris à dessiner, il devint bon architecte.
S le dut à l’examen et à l’élude des beaux inonû-
mens de Rome j aussi fut-il obligé d’avoir souvent
recours , pour rendre ses idées, à une main étrangère.
Mais l’art de l’architecture consiste beaucoup
moins dans l ’exécution graphique , souvent
fort étrangère au don de la pensée et de l’invention.,
que dans les combinaisons de l’esprit, auxquelles
rien ne supplée.
Un des ouvrages d'Antoine de Rossi, qu’on se
plaît davantage à vanter, est à Rome le palais
Renuccini, construit dans le Cours. Certainement
sa façade, qu’on voit dans la seconde partie du
Recueil des palais de Rome , par Ferrerio , présente
une masse, dont la proportion, la disposi-
(ion et le bel accord rappellent le genre et lè caractère
des plus beaux ouvrages du seizième sic-
1' cle. Belle division des étages , justes rapports
entre les pleins et les vides, heureuse répétition
desienêlres , bon emploi des chaînes de bossages ,
tput y est louable 3 on n y peut trouver à redire
que les formes lourdes des frontons qui couronnent
les chambranles des fenêtres, et quelques détails
capricieux qui les déparent. Mais c’étoit là une
de ces modes auxquelles se font reconnoîire les
édifices de ce siècle : dn reste, on fait moins de
cas de ia partie en retour de, ce palais, ainsi que
de son entrée , qui est sombre, défaut qu’on croit
dû à celui fie remplacement. -
- Mais il faut' citer, comme l’ouvrage le plus
remarquable d'Antoine de Rossi, le grand palais
A ltie r i, un des plus magnifiques de Rome, et qui
joint la beauté de l’intérieur à celle de l’extérieur.
La division de ses étages 1 st des mieux entendue 3
l’espacement-des fenêtres ne l’est pas moins. Les
frontons qui en couronnent les chambranles;, sont
purs et exempts de tout détail inutile ou bizarre.
L’ensemble de toute cette masse est grandiose et
du plus bel effet 3 l’entablemeut, sans être des
plus purs , a, par sa combinaison avec les consoles
qui le supportent, et les petites fenêtres du Mez-
zanino , intercalées de distance en distance entre
les consoles, l’avantage d’offiir à toute la masse
un couronnement riche sans lourdeur, et varié
sans confusion. On trouve un peu grêles les deux
colonnes qui accompagnent la porte d’entrée.
La cour de ce palais forme un grand carré,
environné de portiques ou d’arcades , dont les
piédroits sont ornés-de pilastres. L ’architecture
en est belle'et gracieuse , et par cela même, ré-
I pond moins bien quon ne le desireroit, au carao-
Q ’i