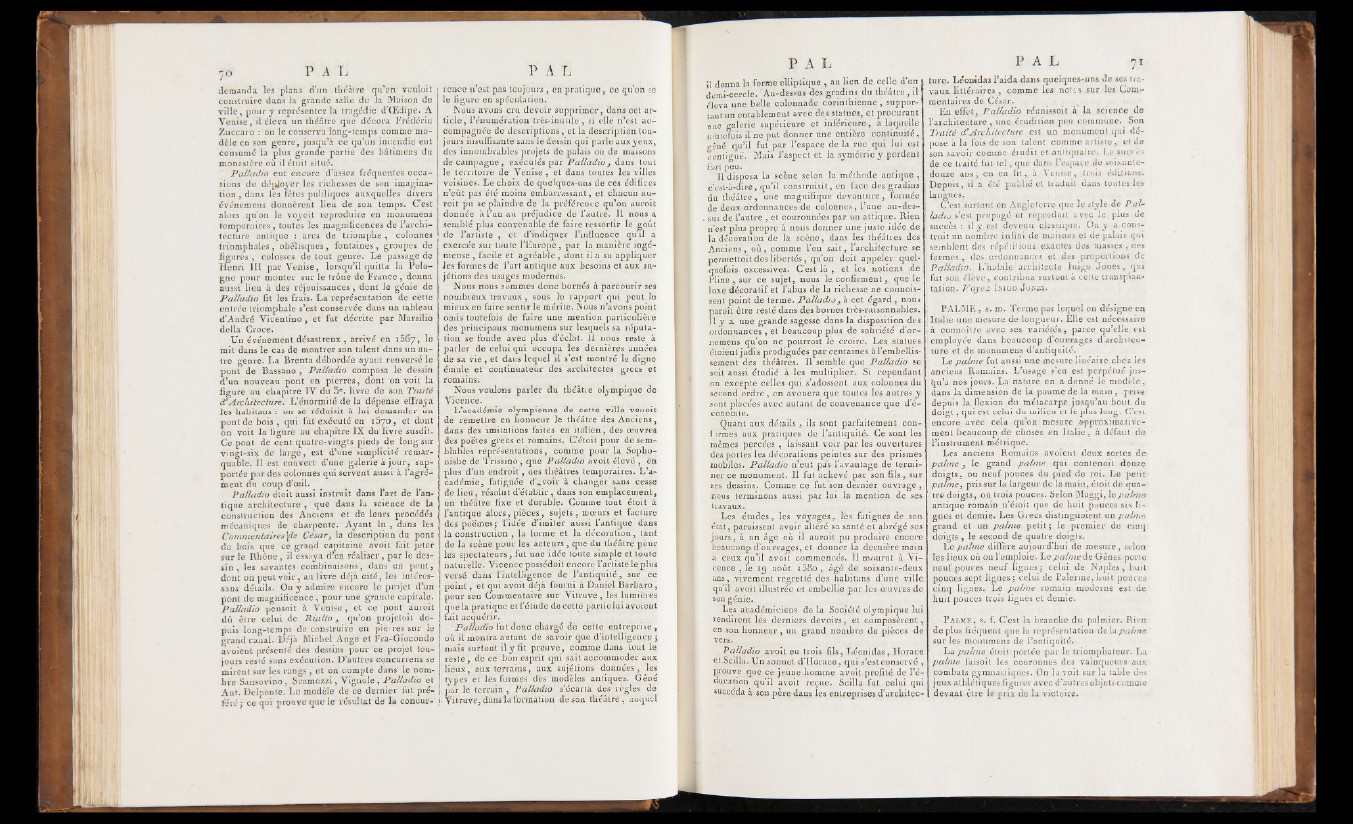
7 o P A L
demanda les plans d’un théâtre qu’on vouloit
construire dans la grande salle de la Maison de
v ille , pour y représenter la tragédie d’OEdipe. A
Venise, il éleva un théâtre que décora Frédéric
Zuccaro : on le conserva long-temps comme modèle
en son genre, jusqu’à ce qu’un incendie eut
consumé la plus grande partie des bâlimens du
monastère où il étoit situé.
Palladio eut encore d’assez fréquentes occasions
de déployer les richesses de son imagination
, dans les fêtes publiques auxquelles divers
événemens donnèrent lieu de son temps. C’est
alors qu’on le voyoit reproduire en monumens
temporaires, toutes les magnificences de l ’architecture
antique : arcs de triomphe , colonnes
triomphales , obélisques , fontaines , groupes de
figures , colosses de tout genre. Le passage de
Henri III par Venise, lorsqu’il quitta là Pologne
pour monter sur le trône de France, donna
aussi lieu à des réjouissances , dont le génie de
Palladio fit les frais, La représentation de cette
entrée triomphale s’est conservée dans un tableau
d’André Vicenlmo, et fut décrite par Marsilio
délia Croce.
Un événement désastreux, arrivé en i 56y , le
mit dans le cas de montrer son talent dans un autre
genre. La Bretfta débordée ayant renversé le
pont de Bassano , Palladio composa le dessin
d’un nouveau pont en piei*res, dont on voit la
figure au chapitre IV du 5°. livre de son Traité
(TArchitecture. L’énormité de la dépense effraya
les habitons : on se réduisit à lui demander un
pont de bois , qui fut exécuté en iS y o , et dont
6n voit la figuré au chapitre IX du livre susdit.
Ce pont de cent qualrervingts pieds de long §ux
vingt-six de large, est d’une simplicité remarquable.
Il est couvert d’une galerie à jour, supportée
par des colonnes qui servent aussi à l’agréa
ment du coup d’oeil.
Palladio étoit aussi instruit dans l’art de l’antique
architecture , que dans la science de la
construction des Anciens et de leurs procédés
mécaniques de charpente. Ayant lu , dans les
Commentaires \de César, la description du pont
de bois que ce grand capitaine avoit fait jeter
sur le Rhône, il essaya d’en réaliser , par le dessin
, les savantes combinaisons, dans un pont,
dont on peut v o ir , au livre déjà Gîté, les intérès-
sans détails. On y admire encore le projet d’un
pont de magnificence , pour une grande capitale,
Palladio pènsoit à Venise, et ce pont auroit
du être celui de Ria lto , qu’on projetoit depuis
long-temps de construire en pierres sur le
grand canal. Déjà Michel Ange et Fito-Giocondô
à voient présenté des dessins pour ce projet toujours
resté sans exécution. D’autres concunens se
mirent sur les rangs , et on compte dans le nombre
Sansovino, Scamozzi, Vignole , Palladio et
Ant. Delponte. Le modèle de ce dernier fut pré-;
féré: ce qui prouve que lé résultat dé la concur-
P A L
ren-ce n’est pas toujours , en pratique, ce qu’on se
le figure en spéculation.
Nous avons cru devoir supprimer, dans cet artic
le , l’énumération très-inutile , si elle n’est accompagnée
de descriptions, et la description toujours
insuffisante Sâns le dessin qui parle aux yeux,
des innombrables projets de palais ou de maisons
de campagne, exécutés par Palladio3 dans tout
le territoire de Venise , et dans toutes les villes
voisines. Le choix de quelques-uns de ces édifices
n’eût pas été moins embarrassant, ët chacun au*-
roit pu se plaihdre de la préférence qu’on auroit
donnée à l’ un au préjudice de l’autre. Il nous a
semblé plus convenable de faire ressortir le goût
de l ’artiste , et d’indiquer l’influence qu’il a
exercée sur toute l’Europe, par là manière ingénieuse
, facile et agréable, dont il a su appliquer
les formes de l ’art antique aux besoins et aux sujétions
des usages modernes.
Nous nous sommes donc bornés à parcourir ses
nombreux travaux, sous le rapport qui peut le
mieux en faire sentir le mérite. Nous n’avons point
omis toutefois de faire une mention particulière
des principaux, monumens sur lesquels sa réputation
se fonde avec plus d’ëciat. Il nous reste à
parler de celui qùi occupa les dernières années
de sa v ie , et dans lequel il s’est montré le digne
émule et continuateur des architectes grecs et
romains.
Nous voulons parler du théâtre olympique de
Vicence.~
1/académie olympienne de cette ville venoit
de remettre en honneur le théâtre des Anciens,
dans des imitations faites en italien, des oeuvres
des poetes grecs et romains. C’é'toit pour de semblables
représentations, comme poiir la Sopho-
nisbe de Trisàino, que Palladio avoit élevé , è'n
plus d’un endroit, des théâtres temporaires. L’académie,
fatiguée d’avoir à changèr sans cesse
de lieu, résolut d’é tablir, dans son emplacement,
un théâtre fixe et durable, Comme tout étoit à
l’antique alors, pièces, sujets moeurs et facture
des poèmes5' l’idée d’imiter aussi l’antique dans
la construction , Ja lorme et la décoration, tant
de la scène pour les acteurs , que du théâtre pour
les spectateurs, fut une idée toute simple et toute
naturelle. VicenCe possédoit encore l’artiste le plus
versé dans l’in-telligence de l ’antiquité , sur ce
point, et qui avoit déjà fourni à Daniel Barbaro,
pour son Commentaire sur Vitruve , les lumières
quela pratique et l’étude de cette partie lui avoieut
fait acquérir,
Palladio fût donc chargé dë cette entreprise ,
où il montra autant de savoir que d’intelligence :
niais surtout il y fit preuve, comme dans tout le.
resté , de ce bon esprit qui sait accommoder aux
lieux, aux terrains, aux sujétions données , les
types et les formes des modèles antiques. Gêné
par le terrain , Palladio s’écarta des règles de
YitfUve, dàns’là fbrinàtiôn de son théâtre, auquel
il donna la forme elliptique , au lien de celle d’un
demi-cercle. 'Au-dessus des gradins du théâtre , il
éleva une belle colonnade corinthienne , supportant
un entablement avec des statues, et procurant
une galerie supérieure et inférieure, à laquelle
toutefois il ne put donner une entière continuité, ;
gêné qu’il fut par l ’espace de la rue qui lui est |
contiguë. Mais l ’aspect et la symétrie y perdent !
fort peu.
Il disposa la scène, selon la méthode antique ,. j
c’est-à-dire, qu’il construisit, en face des gradins •
du théâtre, une magnifique devanture, formée !
de deux-ordonnances de colonnes , l’une au-des- j
. sas de l’autre , et couronnées par un attique. Rien 1
n’est plus propre à nous donner une juste idée de
la décoration de la scène , dans les théâtres des
Anciens, où, comme l’on sait, l'architecture se,
permettait dès libertés, qu’on doit appeler quelquefois
. excessives. C’est là , et les, notions sde
Pline ,, sur ce sujet, nous le, confirment, que le
luxe décoratif et l’abus de la richesse ne connaissent
point de terme. Palladio cet égard, nous
paroît être resté dans des bprnes trèsTraisonnables»
Il y a une grande sagesse dans la disposition des
ordonnances , et beaucoup plus de sobriété d’or-
nemens qu’on ne pourvoit le croire. Les statues
étaient jadis prodiguées par centaines à l’embellis-
sement des théâtres. Il semble que Palladio se
soit aussi étudié à les multiplier. Si cependant
on excepte celles qui s’adossent aux colonnes du
second ordre, on avouera que toutes les autres y.
«ont placées avec autant de convenance que d’économie.
Quant aux détails , ils sont parfaitement confirmes
aux pratiques de l’antiquité. Ce sont les
mêmes percées , laissant voir par lès ouvertures-
des portes les décorations peintes sur des prismes
mobiles. Palladio n’eut pà's l’avantage de terminer
ce monument. Il fut achevé par son fils, sur
ses dessins. Comme ce fut*son dernier ouvrage,
nous terminons aussi par lui la mention de ses
travaux.
Les éludes, les voyages, lès fatigues de son
état, paroisseûl avoir altéré sa santé e( abrégé ses
jours , à un âge où il auroit pu produire encore
beaucoup d’ouvrages, et donner la dernière inain
à ceux qu’il avoit commencés. Il maurut à V i-
cence , le 19 août i 5.8o , âgé: de soixante-deux
ans, vivement regretté des habitans d’une ville,
qu’il avoit illustrée et embellie par les oeuvres de
son génie.
Les académiciens de la Société olympique lui
rendirent lès derniers devoirs, et composèrent,
eu son honneur, un grand nombre de pièces de
vers.
Palladio avoit eu trois fils , Léonidas , Horace
et Scilla. Un sonnet d’Horace, qui s’est conservé ,
prouve que ce jeune homme avoit profité de l’éducation
qu’il avoit reçue. Scilla fut celui qui
succéda à son père dans les entreprises d’architecture.
Léonidas l’aida dans quelques-uns de ses travaux
littéraires , comme les noies sur les Commentaires,
de. César.
En effet, Palladio réunis?oit à la science de
l’architecture , une érudition peu commune. Son
Traité d*Architecture est un monument qui dépose
à la fois de son talent comme artiste , et de
son savoir comme- érudit et antiquaire'.. Le succès
de ce traité fut te l, que dans l’espace de sôixanie-
douze ans j on en fit, à Venise, trois éditions;
Depuis, il a été publié et traduit dans toutes les
langues, .
C’est surtout en Angle,(erre que le style de P a lla
d io s’esl propage et reproduit avec le plus de
succès : il y est devenu classique. On y a construit
un nombre infini de maisons et de palais qui
j semblent des répétitions exactes des masses , des
1 formes , des ordonnances et des proportions de
: Palladio. L’habile architecte 1 nigo Jones, qui
j fat son élève-, contribua surtout à celle trânsplau-»
; talion. Voyez Inigo Jones.
’ PALME, s. m. Terme par lequel ou désigne en
; Italie une mesure de-longueur. Elle est nécessaire
là connoître avec ses variétés, parce qu’elle est
I employée dans beaucoup d’ouvrages d’a rchilec-
lure et de monumens d’antiquité.
Le palme fut aussi une mesure linéaire chez les
! anciens Romains. L’usage s’en est perpétué jusqu’à
nos jours. La nature en a donné le modèle,
/dans la dimension de la paume de la main , prise
; depuis la flexion du métacarpe jusqu’au bout du
| d oigt, qui est celui du milieu et le plus long. C’est
encore avec cela qu’on mesure .approximative-
menlbeaucoup.de choses en Italie, à défaut de
l ’instrument métrique.
Les anciens Romains avoient deux sortes de
palme y le grand palme qui conlenoit douze
doigts, ou neuf pouces du pied de roi. Le petit
palme, pris sur la largeur de la main, étoit de quatre
doigts, ou trois pouces. Selon Maggi, le palme
iantique romain n’étoit que de huit pouces six h-
ignes et demie* Les Grecs d-istingûoient un palme
grand et un palme petit; le premier de cinq
doigts , le second de quatre doigts.
Le palme diflère aujourd’hui de mesure, selon
les lieux où on l’emploie. L q palme de Gênes porte
neuf pouces neuf lignes:; celui de Naples, huit
pouces sept lignes; celui de Païenne, huit pouces
cinq: lignes*, Le palme romain, moderne est de
huit pouces trois lignes et demie.
P alme , s. f. G’est la branche du palmier. Rien
de plus fréquent que la représentation de là palme
sur les monumens de l’antiquité.
La palme étoit portée par le triomphateur. La
palme faisoit les couronnes des vainqueurs'aux
combats gymnastiques. On la voit sur la table des
jeux athlétiques figurer avec d’autres objets comme
devant être le prix de la victoire.