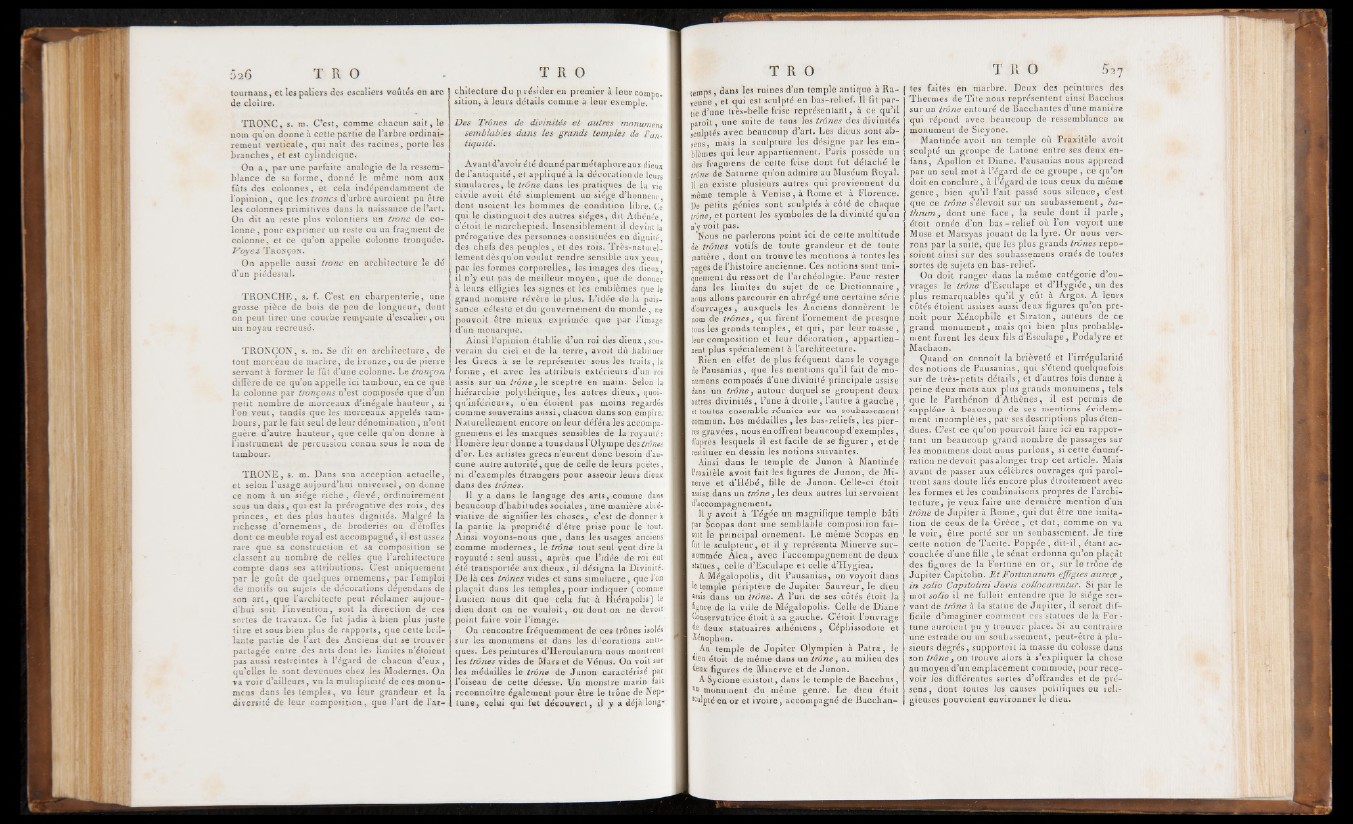
tournans, et les paliers des escaliers voûtés en arc
de cloître.
TRONC, s. m. C’est, comme chacun sait, le
nom qu’on donne à cette partie de l’arbre ordinairement
verticale, qui naît des racines, porte les
branches, et est cylindrique.
On a , par une parfaite analogie de la ressemblance
de sa forme, donné le même nom aux
fûts des colonnes , et cela indépendamment de
l ’opinion, que les troncs d’arbre aqroient pu être
les colonnes primitives dans la naissance de l’art.
On dit au reste plus volontiers un tronc de colonne,
pour exprimer un reste ou un fragment de
colonne, et ce qu’on appelle colonne tronquée.
T^oyez T ronçon.
On appelle aussi tronc en architecture le dé
d’un piédestal.
TRONCHE, s. f. C’est en charpenterie, tine
grosse pièce de bois de peu de longueur, dont
on peut tirer une courbe rempanle d’escalier, ou
un noyau recreusé.
TRONÇON, s. m. Se dit en architecture, de
tout morceau de marbre, de bronze, ou de pierre
servant à former le fût d’une colonne. Le tronçon
diffère de ce qu’on appelle ici tambour, en ce que
la colonne par tronçons n’est composée que d’un
petit nombre de morceaux d-inégale hauteur, si
l ’on veut, tandis que les morceaux appelés tambours
, par le fait seul de-leur dénomination', n’ont
guère, d’autre hauteur, que celle qu’on donne à
l’instrument de percussion connu sous le nom de
tambour.
TRO NE , s. m. Dans son acception actuelle,
et selon l’usage aujourd’hui universel, on donne
ce nom à un siège riche, élevé, ordinairement
sous un dais, qui est la prérogative des rois, des
princes, et des plus hautes dignités. Malgré la
richesse d’ornemens, de broderies ou d’étoffes
dont ce meuble royal est accompagné , il est assez
rare que sa construction et sa composition se-
classent au nombre de celles que l’architecture
compte dans ses attributions. C’est uniquement
par le goût de quelques ornemens ,-par l’emploi
de motifs ou sujets de décorations dépendans de
son art, que l’architecte peut réclamer aujourd’hui
soit l ’invention, soit la direction de ces
sortes de travaux. Ce fut jadis à bien plus juste
titre et sous bien plus de rapports, que cette brillante
partie de l’art des Anciens dut se trouver
partagée entre des arts dont les limites n’étoient
pas anssi restreintes à l’égard de chacun d’eux,
qu’elles le sont devenues chez les Modernes. On
va voir d’ailleurs, vu la multiplicité de ces monu-
mens dans les temples, vu leur grandeur et la
diversité de leur composition, que l’art de l’architecture
du p résider en premier à leur composition,
à leurs détails comme à leur exemple.
Des J'rônes de divinités et- autres monumens
semblables dans les grands temples de l'antiquité.
Avant d’avoir été donné par métaphore aux dieux
de l’antiquité , et appliqué à la décoration de leurs
simulacres, le trône dans les pratiques de la vie
civile avoit été simplement un siège d’honneur,
dont usoient les hommes de condition libre. Ce
qui le distinguoit des autres sièges, dit Athénée
c’étoil le marchepied. Insensiblement il devint U
prérogative des personnes constituées en dignité
des chefs des peuples, et des rois. Très-naturellement
dès qu’on voulut rendre sensible aux yeux
par les formes corporelles , les images, des dieux,
il n’y eut pas de meilleur moyen, que de donner
à leurs effigies les signes et lès emblèmes que le
grand nombre révère le plus. L ’idée de la puissance
céleste et du gouvernement du monde.,.ne
pouvoit être mieux exprimée que par l’image
d’un monarque.
Ainsi l’opinion établie d’un roi des dieux, souverain
du ciel et de la terre, avoit dû habituer
les Grecs à se le représenter sous, les traits, la
forme, et avec les attributs extérieurs d’un roi
assis sur un trône, le sceptre en main. Selon la
hiérarchie polythéique, les autres dieux, quoi-
qn’inférieurs, n’eu éloient pas moins regardés
comme souverains aussi, chacun dans son empire.'
Naturellement encore on leur déféra les accompa-
gnemens e lle s marques sensibles de la royauté:
Homère leur donne à tous dans l'Olympe des trônes
d’or. Les artistes grecs n’eurent donc besoin d’aucune
autre autorité, que de celle de leurs poètes,
ni d’exemples étrangers pour asseoir leurs dieux
dans des trônes.
Il y a dans le langage des arts, comme dans
beaucoup d’habitudes sociales, une manière abréviative
de signifier les choses, c’est de donner à
la partie la propriété d’être prise pour le tout.
Ainsi voyons-nous que, dans les usages anciens
comme modernes, le trône tout seul veut dire la
royauté : seul aussi, après que l’idée de roi eut'
été transportée aux dieux, il désigna la Divinité.
De là ces trônes vides et sans simulacre, que l’on
plaçoit dans les temples, pour indiquer (comme
Lucien nous dit que cela fut à Hiérapolis ) le
dieu dont on ne vouloit, ou dont on ne dev.oit'
point faire voir l’image.
On rencontre fréquemment de ces trônes isolés
sur les monumens et dans les décorations antiques.
Les peintures d’Herculanum nous montrent
les trônes vides de Mars et de Vénus. On voit sur
les médailles le trône de Junon caractérisé par
l’oiseau de cette déesse. Un monstre marin fait
reconnoître également pour être le trône de Neptune,
celui qui fut découvert, il y a déjà longtemps
j dans les ruines d’un temple antique à Ra- (
yenne , et qui est sculpté en bas-relief. Il fit partie
d’une très-belle frise représentait, à ce qu’il
paroît , une suite de tous les trônes des divinités
sculptés avec beaucoup d’art. Les dieux sont ab-
sens, mais la sculpture les désigne par les emblèmes
qui leur appartiennent. Paris possède un
des fragmens de cette frise dont fut détaché le
trône de Saturne qu’on admire au Muséum Royal.
Il en existe plusieurs autres qui proviennent du
même temple à Venise, à Rome et à Florence.
De petits génies sont sculptés à côté de chaque
trône, et portent les symboles de la divinité qu’on
n’y voit pas.
Nous ne parlerons point ic i de cette multitude
de ttônes votifs de toute grandeur et de toute
matière , dont on trouve les mentions à toutes les
pages de l’histoire ancienne. Ces notions sont uniquement
du ressort de l’archéologie. Pour rester
dans les limites du sujet de ce Dictionnaire,
nous allons parcourir en abrégé une certaine série
d’ouvrages, auxquels les Anciens donnèrent le
nom de trônes> qui firent l’ornement de presque
tous les grands temples, et qui, par leur masse ,
leur composition et leur décoration, appartiennent
plus spécialement à l’architecture.
Rien en effet de plus fréquent dans le voyage
de Pausanias, que les mentions qu’il fait de mo-
numens composés d’une divinité principale assise
dans un trône, autour duquel se groupent deux
autres divinités, l’une à droite, l’autre à gauche,
et toutes ensemble réunies sur un soubassement
commun. Les médailles , les bas-reliefs, les pierres
gravées, nous en offrent beaucoup d’exemples,
d’après lesquels il est facile de se figurer , et de
restituer en dessin les notions suivantes.
Ainsi dans le temple de Junon à Manlinée
Praxitèle avoit fait les figures de Junon, de Minerve
et d’Hébé, fille de Junon. Ce’le-ci étoit
assise dans un trône, les deux autres lui servoient
d’accompagne men t •
Il y avoit à Tégée nn magnifique temple bâti
par Scopas dont une semblable composition fai-
soit le principal ornement. Le même Scopas en
fut le sculpteur, et il y représenta Minerve surnommée
Âlea , avec l’accompagnement de deux
statues , celle d’Esculape et celle d’H ygiea.
A Mégalopolis, dit Pausanias, on voyoit dans
le temple périptère de Jupiter Sauveur, le dieu
assis dans un trône. A l’un de ses côtés étoit la
figure de la ville de Mégalopolis. Celle de Diane
Conservatrice étoit à sa gauche. C’étoil l’ouvrage
de deux statuaires athéniens , Céphissodote et
, Xénophon.
Au temple de Jupiter Olympien à Patra, le
fiieu étoit de même dans un trône, au milieu des
fieux figures de Minerve et de Junon.
A Sycione existoit, dans le temple de Bacchus, '
monument du même genre. Le dieu étoit
sculpté en or et ivoire, accompagné de Bacchantes
faites en marbre. Deux des peintures des
Thermes de Tite nous représentent ainsi Bacchus
sur un trône entouré de Bacchantes d’une manière
qui répond avec beaucoup de ressemblance au
monument de Sicyone.
Mantinée avoit un temple où Praxitèle avoit
sculpté un groupe de Latone entre ses deux en-
fans, Apollon et Diane. Pausanias nous apprend
par un seul mot à l’égard de ce groupe, ce qu’on
doit en conclure, à l’égard de tous ceux du même
genre, bien qu’il l’ait passé sous silence, c’est
que ce trône s’élevoil sur un soubassement, ba-
thrum} dont une fa c e , la seule dont il p arle,
éToit ornée d’un b a s -re lie f où l’on voyoit une
Muse et Marsyas jouant de la lyre. Or nous verrons
par la suite, que les plus grands trônes repo-
soient ainsi sur des soubassemens ornés de toutes
sortes de sujets en bas-relief.
On doit ranger dans la même catégorie d’ouvrages
le trône d’Esculape et d’Hygiée, un des
plus remarquables qu’il y eût à Argos. A leurs
côtés étoient assises aussi deux figures qu’on pï*e-
noit pour Xénophile et Slraton, auteurs de ce
grand monument, mais qui bien plus probablement
furent les deux fils d’Esculape, Podalyre et
Machaon.
Quand on connoît la brièveté et l ’irrégularité
des notions de Pausanias, qui s’étend quelquefois
sur de très-petits détails, et d’autres fois donne à
peine deux mots aux plus grands monumens, tels
que le Parthénon d’Athènes, il est permis de
suppléer à beaucoup de ses mentions évidemment
incomplètes, par ses descriptions plus étendues.
C’est ce qu’on pourroit faire ici en rapportant
un beaucoup grand nombre de passages sur
les monumens dont nous parlons, si cette énumération
nedevoit pasalonger trop cet article. Mais
avant de passer aux célèbres ouvrages qui paroî-
tront sans doute liés encore plus étroitement avec
les formes et les combinaisons propres de l’architecture,
je veux faire une dernière mention d’un
trône de Jupiter à Rome, qui dut être Une imitation
de ceux de la G rè c e , et dut, comme on va
le voir, être porté sur un soubassement. Je tire
cette notion de Tacite. Poppée , dit-il, étant accouchée
d’une fille , le sénat ordonna qu’on plaçât
des figures de la Fortune en or, sur le trône de
Jupiter. Capitolin. E t Fortunarum effigies aureoe,
in solio Capitolini Jovis collocarentur. Si par le
mot solio il ne falloit entendre que le siège servant
de trône à la statue de Jupiter, il serôit difficile
d’imaginer comment ces statues de la Fortune
auroieut pu y trouver place. Si au contraire
une estrade ou un soubassement, peut-être à plusieurs
degrés, supportoit la masse du colosse dans
son trône, on trouve alors à s’expliquer la chose
au moyen d’un emplacement commode, pour recevoir
les différentes sortes d’offrandes et de présens,
dont toutes les causes politiques ou relir
gieuses pouvoient environner le dieu.