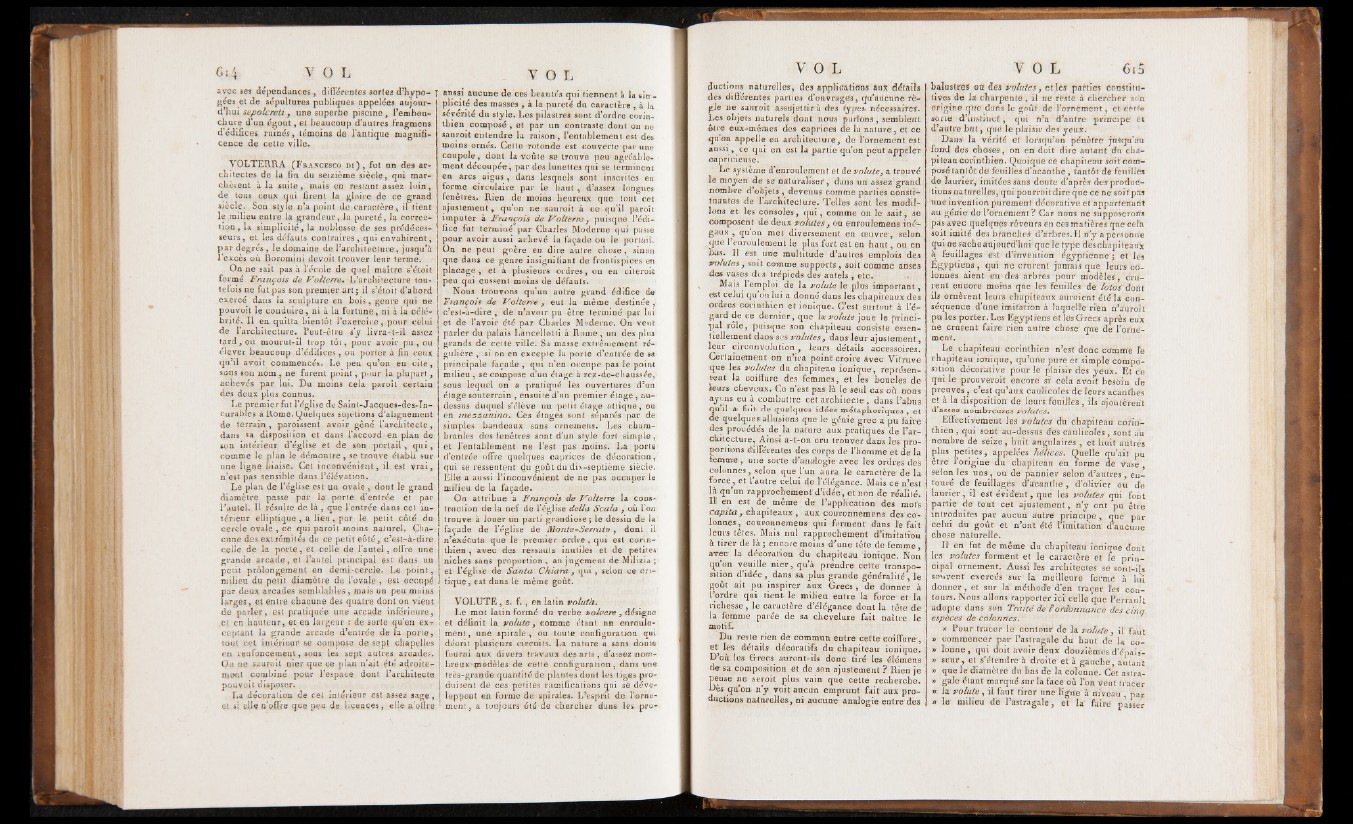
G4 V O L VOL
avec ses dépendances , différentes sortes d’hypo- J
gées et de sépultures publiques appelées aujourd’hui
sepolcreti 3 une superbe piscine, l’embouchure
d’un égou t, et beaucoup d’autres fragmens
d’édifices ruinés, témoins de l’antique magnificence
de cette ville.
VOLTERRA (F eancesco di) , fut un des architectes
de la fin du seizième siècle, qui marchèrent
à la suite, mais en restant assez lo in ,
de tous ceux qui firent la gloire de ce grand
siècle. Son style n’a point de caractère , il tient
le milieu entre la grandeur, la pureté, la correction
, la simplicité, la noblesse de ses prédécesseurs,
et les défauts contraires, qui envahirent,
par degrés , le domaine de l’architeêlure, jusqu’à
l ’excès où Boromini de voit trouver leur terme.
On ne sait pas à l’école de quel maître s’étoit
formé François de Volterre. L’architecture toutefois
ne fut pas son premier art; il s’étoit d’abord
exercé dans la sculpture en bois, genre qui ne
pouvoît le conduire, ni à la fortune , ni à lu célébrité.
Il en quitta bientôt l’ex ercice, pour celui
de 1’ architecture. Peut-être s’y livra-t-il assez I
tard, ou mourut-il trop to i, pour avoir, pu , ou
élever beaucoup d’édifices , ou porter à fin ceux
qu’il avoit commencés. Lé peu qu’on en c ite ,
sous son nom , ne furent point, pour la plupart 3
achevés par lui. Du moins cela pai-oît certain
des deux plus connus.
Le premier fut l’église de Saint-Jacqu.esr-des.-Tn-
curables à Rome. Quelques sujétions d’alignement
de terrain , paroissent avoir gêné l’architecte,
dans sa disposition et dans l’accord en plan de
son intérieur d’église et de son portail, q u i,
comme le plan le démontre, se trouve établi sur
une ligue biaise. Cet inconvénient, il est v rai,
n’est pas sensible dans l’élévation.
Le plan de l’église est un ovale-, dont le grand
diamètre passe par la porte d’entrée et par
l ’ autel. Il résulte de là , que l ’entrée dans cet intérieur
elliptique, a lie u , par le petit côté du
cercle ovale , ce qui paroît moins naturel. Chacune
des extrémités de ce petit eôtéJ; c ’est-àrdire
celle de la porte, et celle de l’autel, offre une
grande arcade, et l'autel principal est dans un
petit prolongement en demi-cercle. Le point,
milieu du petit diamètre de l’ovale , est occupé
par deux arcades semblables, mais un peu moins j
larges, et entre chacune des quatre dont on vient I
de parler, est pratiquée une arcade inférieure, j
.et en hauteur, et en largeur ; de sorte qu’en ex- ,
ceptaut la grande areade d’entrée de la porte, I
tout cet intérieur se compose de sept chapelles
en renfoncement, sojas les sept autres aroades.
Ou ne sauroit nier que ce plan n’ait été adroitement
combiné pour l’espace dqnt l'architecte
pouvoît disposer.
La décoration de cet intérieur est assez sage,
et si e lk u offre que peu de licences, elle n’oiïre ‘
anssi aucune de ces beautés qui tiennent à la simplicité
des masses , à la pureté du caractère , à la
sévérité du style. Les pilastres sont d’ordre corinthien
composé , et par un contraste dont on ne
sauroit entendre la raison, l’entablement est des
moins ornés. Celte rotonde est couverte par une
coupole, dont la-voûte se trouve peu agréablement
découpée, par des lunettes qui se terminent
en arcs aigus, dans lesquels sont inscrites en
forme circulaire par le hau t, d’assez longues
fenêtres. Rien de moins heureux que tout cet
ajustement, qu’on ne sauroit à ce qu'il paroît
imputer à François de Volterre } puisque l’édifice
fut terminé par Charles Moderne qui passe
pour avoir aussi aehevé la façade ou le portail.
On ne peut guère en dire autre chose , sinon
que dans ce genre insignifiant de frontispices en
placage , et à plusieurs ordres, on en citer oit
peu qui eussent moins de défauts.
Nous trouvons qu’un autre grand édifice de
François de Volterre3 eut la même destinée ,
c’est-à-dire , de n’avoir pu être terminé par lui
et de l’avoir été par Charles Moderne. On veut
parler du palais Làncellolti à Rome, un des plus
grands de cette ville. Sa masse extrêmement régulière
, si on en excepte la porte d’entrée de sa
principale façade , qui n’en occupe pas le point
milieu , se compose d’un étage à rez-de-chaussée,
sous lequel on a pratiqué les ouvertures d’uu
étage souterrain , ensuiied’nn premier étage , au-
dessus duquel s’élève un petit étage atliqne, ou
en mezzanino. Ces étages sont séparés par de
simples bandeaux sans ornemens. Les chambranles
des fenêtres sont d’un style fort simple,
et ]’enta.blement ne l’est pas moins. La porte
d’entrée offre quelques caprices de décoration,
qui se ressentent du goût du dix-septième siècle.
Elle a aussi l’inconvénient de ne pas occuper le
milieu de la façade.
On attribue à François de Volterre la construction
de la nef de l’église délia Scala , où Ton
trouve à louer un parti grandiose 5 le dessin de la
façade de l’église de Monte-Serrato , dont p
n’exécuta que le premier ordre, qui est corinthien
, avec des -ressauts inutiles et de petite*
niches sans proportion , au jugement de Milizia ;
et l’église de Santa Chiara 3 qui , selon ce critique
, est dans te même goût.
VO LU TE , s. f. , en latin volutà.
Le mot latin formé du verbe volvere3 désigne
et définit la volute 3 comme étant un enroulement,
une spirale, ou toute configuration qui
décrit plusieurs circuits. La nature a sans doute
fourni aux divers travaux des arts, d’assez nom*
h.r e u x - pi© dè 1 e s de cette configuration , dans une
très-grande quantité de plantes dont les tiges produisent
de ces petites ramifications qui se développent
en forme de spirales. L’esprit de l’ornement
, a toujours été de chercher dans les. pro-
1 m æ sw S h w h »
VOL
ducrions naturelles, des applications au* détails
des différentes parties d’ouvrages', qii’aitctuïé règle
ne sauroit assujettir à des types- nécessaires.
Les objets naturels dont nous parlons, sembleat
être eux>mênae$ des caprices de la nature, et ce
qu on appelle en architecture, de l’ornement est
aussi, ce qui en est la partie qu’oni peut appeler
oapricieuse.
Le système d’enroulement et de volute3 a trouvé
le moyen de se naturaliser, dans un' assez grand
nombre d’objets, devenus comme parties constituantes
de l cM-chifecture.-Telles sont les modifiions
et les consoles, q u i, comme on le sait, se
composent d© deux volutes 3 Où enroulemeus iné-
gaux , qu on met diversement en oeuvre, selon
que l’enroulement le plus fort est en hau t, ou en
bas. Il es^ une multitude d’autres emplois des
volutes3 soit comme supports , soi t Comme anses
des vases des trépieds des- autels , etc.
Mais l’emploi de la volute le plus important,
esst celui qu’on lui a donné dans les chapiteaux des
ordres eoriffithiert et ionique. C’est surtout à l’égard
de ce dernier, que la volute joue le principal
rôle, puisque son chapiteau consiste essentiellement
dans ses; volutes, dans leur ajustement,
leur circonvolution , leurs détails accessoires.
Certainement on n’ira point croire avec Vitruve
que les volutes du chapiteau ionique, représentent
la coiffure des femmes, et les boucles de
koers cheveux. Ce n’est pas là le seul cas où nous
ayons eu à combattre cet architecte , dans l’abus
qiril a fiait de quelques idées métaphoriques , et
de quelques allusions que le génie grec a pu faire
des procédés de k nature aux pratiques de Far-
chrtecture, Ainsi a-t-on cru trouver dans les provenions
différentes des corps de l’homme et d elà
femme:, une sorte d'analogie avec les ordres d'es
colonnes, selon que l’un aura le caractère de la
force, et l’autre celui de l’élégance. Mais ce n’est
là qu’un rapprochement d’idée, et non de réalité.
IL en est de même de: l’application des mots
capita 3 chapiteaux , aux couronnent en s des- colonnes
, Gonronnemeus qui forment dans le fait
leurs têtes. Mais nul rapprochement d’imitatiou
à tirer de là ; encore moins d'une tête de femme,
avec la décoration du chapiteau ionique. Non
qu’on veuille nier , qu’à prendre celte transposition
didée , dans sa plus grande généralité', le
goût ait pu inspirer aux Grecs , de donner à
l’ordre qui tient le milieu entre la force et la
richesse, le caractère d’élégance dont la tête de
la femme parée de sa chevelure fait naître le
mo tiL
Du reste rien de commun entre celle coiffure,
et les détark décoratifs du chapiteau ionique.
D’où les Grecs auront-ils donc tiré les élémens
de sa composition et de son ajustement ? Rien je
pense ne seroit plus vain que cette recherche.
Dès qu’on n’y voit aucun emprunt fait aux productions
naturelles, ni aucune- analogie entre’ des
V O L 615
b alu sire? où déS volutes 3 etléîf parties Constitutives
de k charpenté , il ne resté à chercher son
origine' qtïë dans le goût dé l’ornement, et cette
sorte d’insti-ncÉ, qui n’a d’autre principe et
d’autre but j que le plaisir des- jeu*.-
Dans 1a vérité et lorsqu’on pénètre jusqu’au
fond des choses, ori en doit dire autant du chapiteau
corinthien. Quoique ce chapiteau Soit Composé
tantôt de feuilles d’acânthe , tantôt de feuilles
de laurier, imitées sans doute d’après des productions
naturelles, qui poufrbitdire que ce ne soit pas
uné invention purement décorative et appartenant
au génie1 de l’ornement? Car nous ne supposerons
pas avec quelques rêveurs en ces matières que’Gela
soit imité des branches d’arbres. Il n’y a personne
qui- ne sache aujourd’hui- que le type des chapi teaux
à. feuillages est d’rtrventiotr égyptienne ; et les
£g.yP^ens > qbi crurent j’aurais que leurs colonnes
aient eu- des arbres pour modèles, crurent
encore moins que les feuilles dé lotos (ïont
ils ornèrent leurs chapiteaux auroient été la conséquence
d’üne imitation à laquelle ri'en n’aüroit
pu les porter. Les Egyptiens et les Grecs après eux
ne crûrent faire rien autre chose que de l’ornement.
L e chapiteau corinthien n’est donc comme Te
chapiteau ionique, qu’une pure et simple composition
décorative pour le'plaisir des yeux. Ét ce
qui le proüveroit encore si’ c é k avoir besoin de
preuves , c ’est qu’aux caulicoles de leurs acanthes
et à la disposition de leurs Feuilles, ils ajoutèrent
d’assez nombreuses volutes.
Effectivement les volutes dix chapiteau corinthien
, qui sont au-dessus des caulicoles , Sont au
nombre de seize, huit angulaires , et huit attirés
plus petites, appelées hélices. Quelle qu’ait pu
être l’origine du chapiteau en forme de Vase
selon les uns , on de pannier selon d’autres',, entouré
de feuillages d’acanthe , d’olivier où' cfe
laurier, il est évid'ent, que les volutes’ qui font
partie- de fout cet ajustement, n’y ont pu être
introduites par aucun autre principe , que par
celui dit goût et n’ont été l’imitation d’aucune
chose naturelle.
Il en fut de même du chapiteau ionique dont
les1 volutes forment et le caractère et le principal
ornement. Aussi lès architectes' se sont-ils
souvent exercés sur 1a meilleure forme à lui
donner, et sur-la méthode d’en tracer les cou-
tours. Nous allons rapporter ici’ celle que Perrault
adopte dans son Traité dé Pordonnance des cinq
espèces de colonnes. 1 ’
» Pour tracer le contour de' 1a Vol'ute 3 il faut
» commencer par l’ astragale du haut de k co-
» lonne, qui doit avoir deux douzièmes d’éuais-
»• seur, et s’étendre à droite et à gauche, autant
» que le diataètre du bas de 1a colonne. Get astra-
» gale étant marqué sur la face dû l’on veut trac'ér
» la volute, il faut tirer une ligne à niveau , par
» le milieu de l’astragale, et la faite passer
■ Pw *