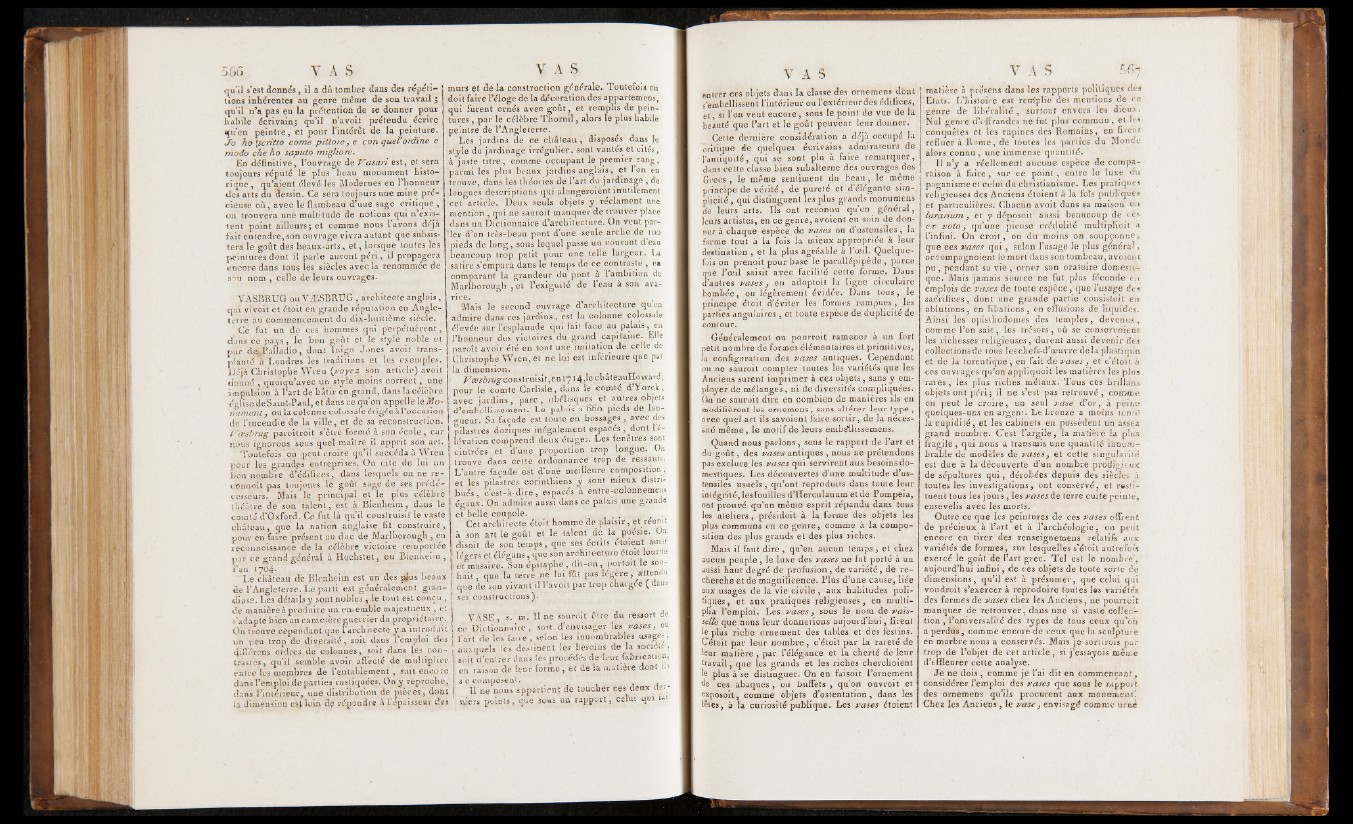
566 -VAS
qu’il s’est donnés, il a dû tomber dans des répétitions
inhérentes au genre même de son travail ;
qu’il n’a pas eu la prétention de se donner pour
habile écrivain 5 qu’il n’a voit prétendu écrire
qu’en peintre, et pour l’intérêt de la peinture.
Jo ho \scritto corne pittote , e con quel'*ordine e
modo che ho saputo migliore.
En définitive, l ’ouvrage de Vciscnï est, et sera
toujours réputé le plus beau monument historique
, qu’aient élevé les Modernes en l’honneur
des arts du dessin. Ce sera toujours une mine précieuse
où., avec le flambeau d’uue sage critique ,
on trouvera une multitude de notions qui n’exis-
teut point ailleurs; et comme nous l’avons déjà
fait entendre, son ouvrage vivra autant que subsistera
le goût des beaux-arts, e t , lorsque toutes les
peintures dont il parle auront p éri, il propagera
encore dans tous les siècles avec la renommée de
sou nom , celle de leurs ouvrages.
YASBRUG ou YÆSBRUG, architecte anglais,
qui vivoit et étoit en grande réputation en Angleterre
au commencement du dix-huitième siecle.
Ce fut un de ces hommes qui perpétuèrent,
dans ce pays , le bon goût et le style noble et
pur deivPaîladio, dont Inigo Jones avoit transplanté
a Londres les traditions et les exemples.
Déjà Christophe Wren {voyez son article) avoit
donné , quoiqu’ayec un style moins corre ct, une
impulsion à l’art de bâtir en grand, dans lacélèbre
église de Saint-Paul, et dans ce qu’on appelle \e Monument,
ou la colonne colossale érigée à l’occasion
de l’incendie de la v ille, et de sa reconstruction.
Vcesbrug paroîtroit s’être formé à son école, car
nous ignorons sous quel maître il apprit son art.
Toutefois on peut croire qu’ il succéda à Wren
pour les grandps entreprises. On cite de lui un
bon nombre d’édifices, dans lesquels on ne re-
connoît pas toujours le goût sage de ses prédécesseurs.
Mais le principal et le plus célèbre
théâtre de son talent, est à Blenheim, dans le
cointé d’Oxford. Ce fut là qu’il construisit le vaste
château, que la nation anglaise fit construire,
pour en faire présent au duc de Marlborough , en
reconnoissance de la célèbre victoire remportée
par ce grand général à Hochslet, ou Blenheim ,
l ’an’ 1764* .
Le château de Blenheim est un des p|us beaux
de l’Angleterre. Le parti est généralement grandiose.
Les détails y sont nobles , le tout est conçu ,
de manière à produire un ensemble majestueux , et
s’adapte bien au caractère guerrier du propriétaire.
On trouve cependant que l’architecte y-a introduit
un peu trop de diversité, soit dans l’emploi des
difi'érens ordres de colonnes, soit dans les contrastes,
qu’il semble avoir affecté de multiplier
entre lès membres de l’entablement, soit encore
dans l’emploi de pariies'rosliquées. On y reproche,
dans l’intérieur, une distribution de pièces, dont
la dimension est loin dp répondre à 1 épaisseur des
V A S
mars et d e là construction générale. Toutefois on
doit faire l’éloge de la décoration des appartenions,
qui furent ornés avec goût, et remplis de peintures
, par le célèbre Thornil, alors le plus habile
peintre de l’Angleterre.
Les jardins de ce château, disposés dans 1«
style du jardinage irrégulier, sont vantés et cités,
à juste titre, comme occupant le premier rang,
parmi les plus beaux jardins anglais, et l’on en
trouve, dans les théories de l’art du jardinage, de
longues descriptions qui alongeroiënt inutilement
cet article. Deux seuls objets y réclament une
mention , qui ne sauroit manquer de trouver place
dans un Dictionnaire d’architecture. On veut parl
e r d’un très-beau pont d’une seule arche.de 100
I pieds de long, sous lequel passe un courant dean
beaucoup trop petit pour une telle largeur. La
satire s’empara dans le temps de ce contraste , ea
comparant la grandeur du pont a 1 ambition de
Marlborough , et l’exiguïté de l’eau à son ava-
rice. H f f l ' B RB b . m ,
Mais le second ouvrage d’architecture qu on
admire dans'ces jardins, est la colonne colossale
élevée sur l’esplanade qui fait face au palais, en
l’honneur des victoires du grand capitaine. Elle
paroît avoir été en tout une imitation de celle de
Christophe Wren, et ne lui est inférieure que par
la dimension.
/''rres3rï/£r construisit,en I7 l 4 >fe chateauHowavd,
pour le comte Carbsle, dans le comté dY orck ,
avec jardins, p arc , obélisques et autres objets
d’embellissement. Le palais a 660 pieds de longueur.
Sa façade est toute en bossages , avec des
pilastres doriques inégalement espacés ,^dont lé-
lévation comprend, deux étages. Les fenelres sont
cintrées et d’uue proportion trop longue. On
trouve dans cette ordonnance trop de ressauts.
L ’autre façade est d’une meilleure composition ,
et les pilastres corinthiens y sont mieux distribués,
c’est-à-dire, espacés à entre-colonnemeus
égaux. On admire aussi dans ce palais une grande
et belle coupole. . . . ...
Cet architecte étoit homme de plaisir, et réunit
à son art le goût et le talent de la poésie. On
disoit de son temps, que ses écrits étoient aussi
légers et élégans, que son architecture étoit lourde
é "massive. Son épitaphe, dit-on, portoit le souhait
, que la terre ne lui fût pas légère, attendu
que de son vivant il l’avoit par trop chargée ( dam
! ses constructions ).
Y A S E , s. m. 11 ne sauroit être du ressort de
ce Dictionnaire, soit d’envisager les vases, ou
l’art de les faire , selon les innombrables usages,
auxquels lés destinent les besoins de la société,
, soit d’entrer dans les procédés dedeur fabrication,
en raison de leur forme, et de la matière dont i>>
i s e composent.
Il ne nous appartient de toucher ces deux der-
nier s points, que sous un rapport, celui qui m*
ftnti-er ces objets dans la classe des ornemens dbnt
s’embellissent l’intérieur ou l’extérieur des édifices,
et, si l’on veut encore, sous le point de vue de la
beauté que l’art et le goût peuvent leur donner.
Cette dernière considération a déjà occupé la
critique de quelques écrivains admirateurs de
l’antiquité, qui se sont plu à faire remarquer,
dans cette classe bien subalterne des ouvrages des
Grecs , le même sentiment du beau , le meme
principe de vérité, de pureté et délégante simplicité
, qui distinguent les plus grands monutnens
de leurs arts. Ils ont reconnu qu’en général,
leurs artistes, en ce genre, avoient eu soin de donner
à chaque espèce de vases ou d’ustensiles , la
forme tout à la fois la mieux appropriée à leur
destination , et la plus agréable à l’oeil. Quelquefois
on prenoit pour base le parallépipede, parce
que l’oeil saisit avec facilité cette forme. Dans
d’autres v a s e s on adoptoit la ligne circulaire
bombée, ou légèrement évidée. Dans tous, le
principe étoit d’éviter les formes rompues, les
parties angulaires , et toute espèce de duplicité de
contour.
Généralement on pourroit ramener à un fort
petit nombre de formes élémentaires et primitives,
la configuration des vases antiques. Cependant
ou ne sauroit compter toutes les variétés que les
Anciens surent imprimer à ces objets , sans y employer
de mélanges, ni de diversités compliquées.
Qu ne sauroit dire en combien de manières ils en
modifièrent les ornemens, sans altérer leur type ,
avéc quel art ils savoient faire sortir, de la nécessité
même, le motif de leurs embe'llissemens.
Quand nous parlons , sous le rapport de l’art et
•du goût, des vases antiques , nous ne prétendons
pas exclure les vases qui servirent aux besoins domestiques.
Les découvertes d’une multitude d’ustensiles
usuels , qu’ont reproduits dans toute leur
intégrité, les fouilles d’Herculanum et de Pompeia,
ont prouvé qu’un même esprit répandu dans tous
les ateliers, présidoit à la forme des objets les
plus communs en ce genre, comme à la composition
des plus grands et des plus riches.
Mais il faut dire , qu’en aucun temps; et chez
aucun peuple, le luxe des vases ne fut porté à un
aussi haut degré de profusion, de variété, de recherche
et de magnificence. Plus d’une cause, liée
aux usages de la vie civile , aux habitudes politiques,
et aux pratiques religieuses, en multiplia
l’emploi. Les vasesy sous le nom de vaisselle
que nous leur donnerions aujourd'hui, firent
je plus riche ornement des tables et des festins. ;
C’étoit par leur nombre, c’étoit par la rareté de
leur matière, par l’élégance et la cherté de leur
travail, que Les grands et les riches cherchoient
le plus à se distinguer. On en faisoit l ’ornement
de ces abaques , ou' buffets , qu’on ouvroit et
exposoit, comme objets d’ostentation, dans les
fêles, à la curiosité publique. Les vases étoieut
matière à présens dans les rapports politiques des
Etats. L’hisloiïe est remplie des mentions de ce
genre de libéralité , surtout envers les dieux.
Nul genre d’offrandes ne fut plus commun, et les
conquêtes et les rapines des Romains, en firent
refluer à Rome, de toutes les parties du Monde
alors connu , une immense quantité.
Il n’y a réellement aucune espèce de comparaison
à faire, sur ce point, entre le luxe d'u
paganisme et celui du christianisme. Les pratiques
religieuses des Anciens étoient à la fols publiques
et particulières. Chacun avoit dans sa maison tra
lararium} et y déposoit aussi beaucoup de ces
e x votoy qu’une pieuse crédulité multiplioil a
l’infini. On c roit, ou du moins on soupçonne,
que ces vases qui , selon l’usage le plus général,
accompagnoient le mort dans son tombeau, avoien t
pu, pendant sa v ie , orner son oratoire domestique.
Mais jamais source ne fut plus féconde èn
emplois de vases de toute espèce, que l’usage des
sacrifices, dont une grande partie consisloit en
ablutions, en libations, en effusions de liquides.
Ainsi les opislhodomes des temples, devenus,
comme l’on sait, les trésors, où se conservôient
les richesses religieuses, durent aussi devenir des
collectionsde tous les chefs-d’oeuvre delà plastique
et de la toreutique , en fait de vases, et c’étoit à
ces ouvrages qu’on appliquoit les matières les plus
•raies, les plus riches métaux. Tous ces brillans
objets ont péri; il ne s’est pas retrouvé, comme
on peut le croire, un seul vase d’or , à peine
quelques-uns en argent. Le bronze a mains tenté
la cupidité, et les cabinets en possèdent un assez
grand nombre. C’est l’argile, la matière la plus
fragile , qui nous a transmis une quantité innombrable
de modèles de vases, et cette singularité
est due à la découverte d’un nombre prodigieux
de sépultures q u i, dérobées depuis des siècles à
toutes les investigations, ont conservé, et restituent
tous les jouis , les vases de terre cuite peinte,
ensevelis avec les morts.
Outre ce que les peintures de ces vases offrent
de précieux à l’art et à l’archéologie, on peut
encore en tirer des renseignemens relatifs aux
variétés de formes, sur lesquelles s’étôit autrefois
exercé le goût de l’art grec. Tel est lè nombre ,
aujourd’hui infini, de ces objets de toute sorte de
dimensions, qu’il est à présumer’ , que celui qui
voudroit s’exercer à reproduire toutes les variétés
des formes de vases chez les Anciens, ne pourvoit
manquer de retrouver, dans une si vaste collection,
l’universalité des types de tous ceux qu’on
a perdus, comme encore de ceux que la sculpture
en marbre nous a conservés. Mais je soi'tirôis par
trop de l ’objet de cet article, si j ’essayois même
d’effleurer cette analyse.
Je ne dois , comme je l’ai dît en commencaàt,
considérer l’emploi des vases que sous le rapport
des ornemens qu’ils procurent aux mouuaens'.
Chez les Anciens, le vase} envisagé comme urné