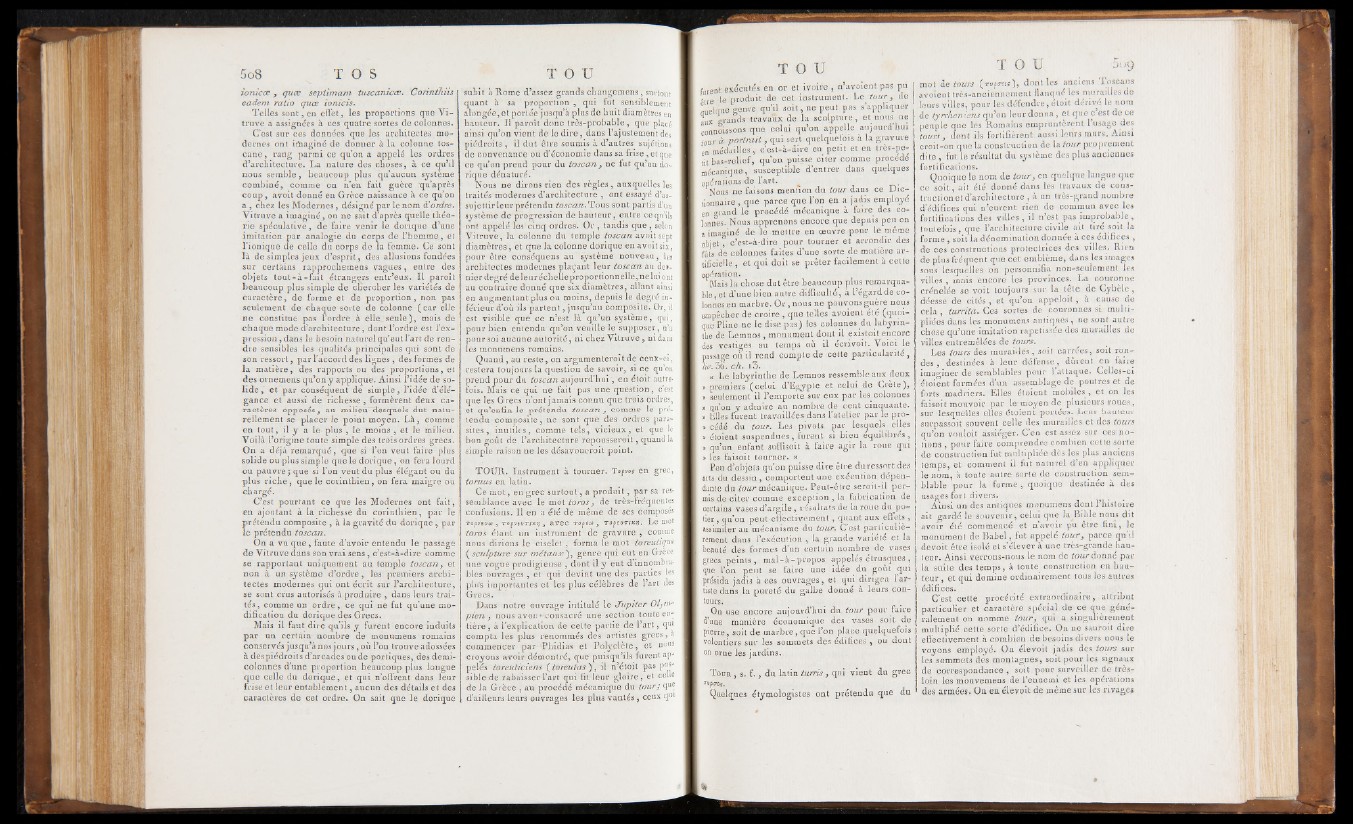
ionicce, quoe septimam tuscanicoe. Cofinthiis
eadem ratio quoe ionicis.
Telles sont, en effet, les proportions que Vi-
truve a assignées à ces quatre sortes de colonnes.
C’est sur ces données que les architectes modernes
ont imaginé de donner à la colonne toscane
, rang parmi ce qu’on a appelé les ordres
d’architecture. La nature des choses, à ce qu’il
nous semble, beaucoup plus qu’aucun système
combiné, comme on n’en fait guère 'qu’après
coup, avoit donné en Grèce naissance à ce qu’on
a , chez les Modernes, désigné par le nom d'ordre.
Vitruve a imaginé, on ne sait d’après quelle théorie
spéculative, de faire venir le dorique d’une
imitation par analogie dû corps de l’homme, et
l’ionique de celle du corps de la femme. Ce sont
là de simples jeux d’esprit, des allusions fondées
sur certàins rapprochemens vagues, entre des
objets tout-à-fait étrangers entr’eux. Il paroît
beaucoup plus simple de chercher les variétés de
caractère, de forme et de proportion, non pas
seulement de chaque sorte de colonne (car elle
ne constitue pas l’ordre à elle_seule), mais de
chaque mode d’architecture, dont l’ordre est l’expression
, dans le besoin naturel qu’eut l’art de rendre
sensibles les qualités principales qui sont de
son ressort, par l’accord des lignes, des formes de
la matière, des rapports ou des proportions, et
des ornemens qu’on y applique. Ainsi l’idée de solide,
et par conséquent de simple, l’idée d’élégance
et aussi de richesse, formèrent deux caractères
opposés j au milieiTllesquels dut naturellement
se placer le point moyen. Là, comme
en tout, il y a le plus , le moins , et le milieu.
Voilà l’origine toute simple des trois ordres grecs.
On a déjà remarqué, que si Fon veut faire plus
solide ou plus simple que le dorique, on fera lourd
ou pauvre 3 que si l’on veut du plus élégant ou du
plus riche, que le corinthien, on fera maigre ou
chargé.
C’est pourtant ce que les Modernes ont fait,
en ajoutant à la richesse du corinthien, par le
Ïirétendu composite , à la gravité du dorique , par
e prétendu toscan.
On a vu que, faute d’avoir entendu le passagé
de Vitruve dans son vrai sens, c’est-à-dire comme
se rapportant uniquement au temple toscan, et
non à un système d’ordre , les premiers architectes
modernes qui ont écrit sur l’architecture,
se sont crus autorisés à produire , dans leurs traités,
comme un ordre, ce qui ne fut qu’une modification
du dprique des Grecs.
Mais il faut dire qu’ils y furent encore induits
par un certain nombre de monumens romains
conservés jusqu’à nos jours, où l’on trouve adossées
à des piédroits d’arcades ou de portiques, des demi-
colonnes d’une proportion beaucoup plus longue
que celle du dorique, et qui n’offrent dans leur
frise et leur entablement, aucun des détails et des
caractères de cet ordre. On sait que le dorique
subit à Rome d’assez grands changemens, surtout
quant à sa proportion , qui fut sensiblement
alongée, et portée jusqu’à plus de huit diamètres en
hauteur. Il paroît donc très-probable, que placé
ainsi qu’on vient de le dire, dans l’ajustement des
piédroits , il dut être soumis à d’autres sujétions
de convenance ou d’économie dans sa frise, et que
ce qu’on prend pour du toscan, ne fut qu’un dorique
dénaturé.
Nous ne dirons rien des règles, auxquelles les
traités modernes d’architecture , ont essayé d’assujettir
leur prétendu toscan.Tous sont partis d’un
système de progression de hauteur, entre ce qu’ils
ont appelé les cinq ordres. Or , tandis que, selon
Vitruve, la colonne du temple toscan avoit sept
diamètres, et que la colonne dorique en avoit six,
pour être conséquens au système nouveau, les
architectes modernes plaçant leur toscan au dernier
degré de leur échelleproportionnelle,nelui ont
au contraire donné què six diamètres, allant ainsi
en augmentant plus ou moins, depuis le degré inférieur
d’où ils partent, jusqu’au composite. Or, il
est visible que ce n’est là qu’un système, qui,
pour bien entendu qu’on veuille le supposer, n’a
pour soi aucune autorité, ni chez Vitruve, ni dans
les monumens romains.
Quand, au reste, on argumenteroit de ceux-ci,
restera toujours la question de savoir, si ce qu’on
prend pour du toscan aujourd’hui , en étoit autrefois.
Mais ce qui ne fait pas une question, c’est
que les Grecs n’ont jamais connu que trois ordres,
et qu’enfin le prétendu toscan , comme le prétendu
composite, ne sont que des ordres parasites,
inutiles, comme tels, vicieux , et que le
bon goût de l’architecture rcpousseroit, quand la
simple raison ne les désavôueroit point.
TOUR. Instrument à tourner. Topvos en grec,
tomus en latin.
Ce mot, en grec surtout, a produit, par sa ressemblance
avec le mot tor'os, de très-fréquentes
confusions. Il en a été de même de ses composés
TOpHva) , TOpytUTt%!)j tlYCC TOpia', TOfiVTIXt). Le UlOt
to r o S éta-ut. un instrument de gravure':, 'comme
nous dirions le ciselel , forma le mot toreutiqus
( sculpture sur métaux ), genre qui eut en Grèce
une vogue prodigieuse , dont il y eut d’innombrables
ouvrages , et qui devint une des parties les
plifs importantes et les plus célèbres de l’art des
Grecs.
Dans notre ouvrage intitulé le Jupiter Olymp
i e n , nous avon»1 consacré une section toute entière
, à l’explication de celte partie de l’art, qul
compta les plus renommés des artistes grecs, a
commencer par'Phidias et Polyclète, et nous
croyons avoir démontré, que puisqu’ils furent appelés
toreuticiens {toreutas ) , il n’étoit pas possible
de rabaisser l’art qui fit leur gloire , et celle
de la Grèce , au procédé mécanique du tour} cju®
d’ailleurs leurs ouvrages les plus vantés, ceux q°l
furent exécutés en or et ivoire , n’a voient pas pu j
*tre le produit de cet instrument. Le tour, de |
auel/iue genre, qu’il soit, ne peut pas s’appliquer
aux grands travaux de la sculpture, et nous ne
connaissons que celui qu’on appelle aujourd’hui
tour à- portrait, qui sert quelquefois à la gravure
en médailles, c’est-à-dire en petit et en très-petit
bas-relief, qu’on puisse citer comme procédé
mécanique, susceptible d’entrer dans quelques
opérations de l’art. #
Nous ne faisons mention du tour dans ce Dictionnaire
, que parce que l’on en a jadis employé
en grand le procédé mécanique à faire des colonnes.
Nous apprenons encore que depuis peu on
a imaginé de le mettre en oeuvre pour le même
objet, c’est-à-dire pour tourner et arrondir des
fûts de colonnes faites d’une sorte de matière artificielle,,
et qui doit se prêter facilement à cette
opération.
Mais la chose dut être beaucoup plus remarquable
y et d’une bien autre difficulté , à l’égard de colonnes
en marbre. O r , nous ne pouvonsguère nous
empêcher de croire, que telles avoient été (quoique
Pline ne le dise pas) les colonnes du labyrinthe
de Lemnos , monument dont il existoit encore
des vestiges au temps où il écrivoit. Voici le 1
passage où il rend compte de cette particularité,
liv. 36'. ch. 13. ,, ;
« Le labyrinthe de Lemnos ressemble aux deux
» premiers (celui d’Egypte et celui de Crète),
» seulement il l ’emporLe sur eux par les colonnes
» cm’on y admire au nombre de cent cinquante.
» Elles furent travaillées dans l’atelier par le pro-
» cédé du tour. Les pivots par lesquels elles
» étoient suspendues, lurent si bien équilibrés,
» qu’un enfant suffisoit à faire agir la roue qui
» les fais oit tourner. »
Peu d’objets qu’011 puisse dire être du ressort des
arts du dessin, comportent une exécution dépendante
du tour mécanique. Peut-être seroil-il permis
de citer comme exception , la fabrication de
certains vases d’argile, résultats de la roue du potier
, qu’on peut effectivement, quant aux effets ,
assimiler an mécanisme du tour. C est particulièrement
dans l’exécution , la grande variété et- la
| beauté des formes d’un certain nombre de yases
grecs peints , mal-à-propos appelés étrusques,
j que l’on peut se faire une idée du goût qui
présjida jadis à ces ouvrages, et qui dirigea 1 artiste
dans la pureté du galbe donné à leurs con-
| tours; ,
On use encore aujourd’hui du, tour pour faire
d’une manière économique des vases soit de
pierre,, soit de marbre, que l’on place quelquefois
volontiers sur les sommets des édifices , ou dont
on orné les jardins.
Tour , s. f . , du latin turris , qui vient du grec
vn.p iras.
Quelques étymologistes ont prétendu que du
mot de tours (rup«iî), dont les anciens Toscans
avoient très-anciennement flanqué les murailles de
leurs villes, pour les défendre, étoit dérivé le nom
de tyrrheniens qu’on leur donna, et que c est de ce
peuple que les Romains empruntèrent l’usage des
tours, dont ils fortifièrent aussi leurs murs. Ainsi
croit-on que la construction de la tour proprement
dite , fut le résultat du système des plus anciennes
fortifications.
Quoique le nom de tour, en quelque langue que
ce soit, ait été donné dans les travaux de construction
et d’architecture , a un très-grand nombre
d’édifices qui n’eurent rien de commun avec les
fortifications des villes , il n’est pas improbable ,
toutefois, que l'architecture civile ait tiré soit la
forme , soit la dénomination donnée à ces édifices ,
de ces'constructions protectrices des villes. Rien
de plus fréquent que cet emblème, dans les images
sous lesquelles on personnifia non-seulement les
villes , mais encore les provinces. La couronne
crénelée se voit toujours sur la tête de Cybèle ,
déesse de cités , et qu’on appeloii, à cause de
cela, turrita. Ces sortes de couronnes si multipliées
dans les monumens antiques, ne sont autre
chose qu’une imitation rapetissée des murailles de
villes entremêlées de tours.
Les tours des murailles, soit carrées ,■ soit rondes
, destinées à leur défense, .durent en faire
imaginer de semblables pour 1 attaque. Celles-ci
étoient formées d’un assemblage de poutres et de
forts madriers. Elles étoient mobiles , et on les
faisoit mouvoir par le'moyen de plusieurs roues,
sur desquelles elles étoient portées. Leur hauteur
surpassoit souvent celle des murailles et des tours
qu’on vouloit assiéger. C’en est assez sur ces notions
, pour faire comprendre combien cette sorte
de construction fut multipliée des les plus anciens
temps, et comment il fut naturel d’en appliquer
le nom, à toute autre sorte de construction semblable
pour la forme , quoique destinée a des
usages fort divers. 1. .. .
Ainsi un des antiques monumens dont l’histoire
ait gardé le souvenir, celui que la^Bible nous dit
avoir été commencé et n’avoir pu être fini, le
monument de Babel, fut appelé tour, parce qu’il
devoit être isolé et s’élever à une très-grande hauteur.
Ainsi verrons-nous le nom de tour donné par
la suite des temps, à toute construction en hauteur,
et qui domine ordinairement tous les autres
édifices. . . ! !
C’est cette procérité extraordinaire, attribut
particulier et caractère spécial de ce que généralement
on nomme tour, qui a singulièrement
multiplié cette sorte d’édifice. On ne sauroit dire
effectivement à combien de besoins divers nous le
voyons employé* On élevovt jadis des tours sur
les sommets des montagnes, soit pour les signaux
de correspondance , soit pour surveiller de très-
loin les mouvemens de l’enuemi et les opérations
des armées. On en élevoit de même sur les rivages