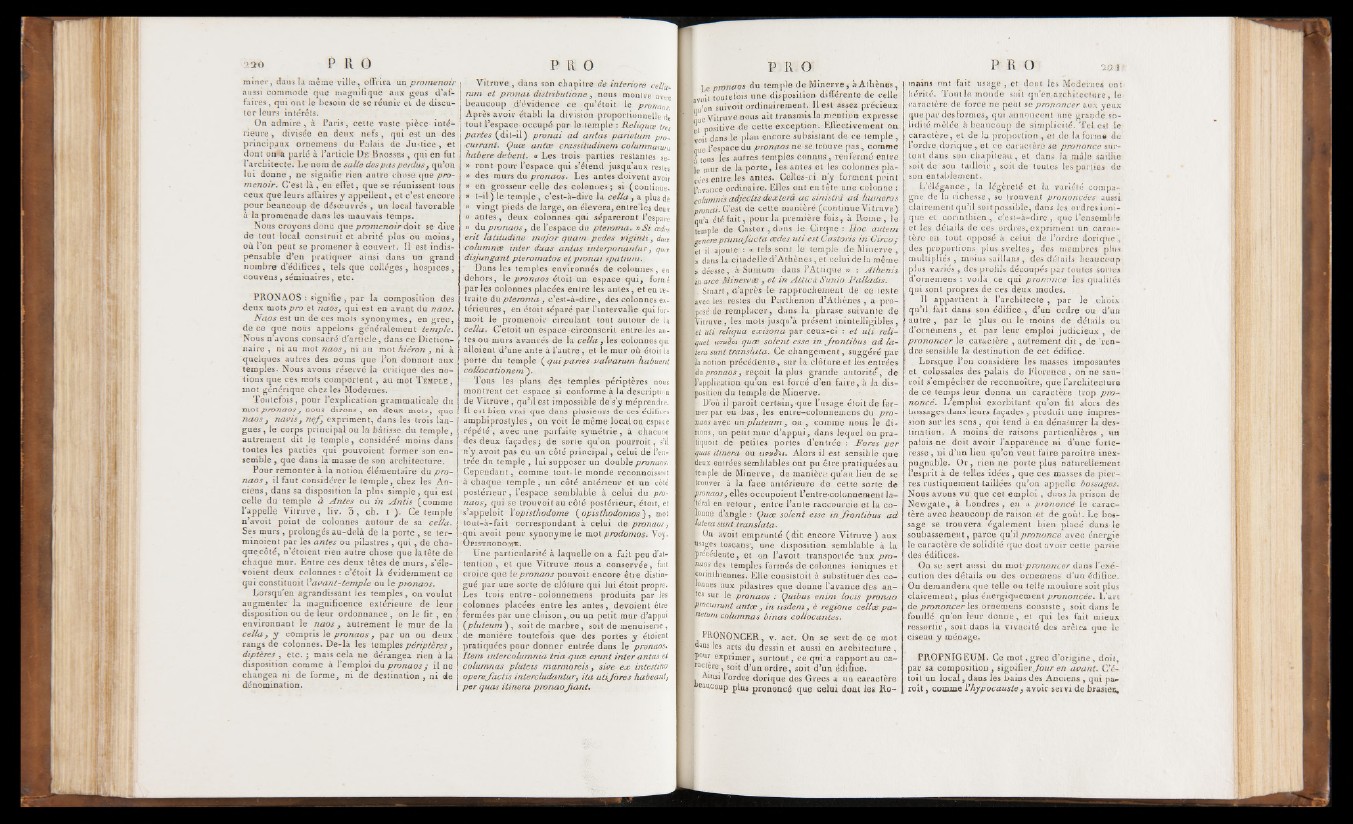
miner, dam la même ville, offrira un promenoir
aussi commode que magniliquè aux gens d’affaires
, qui ont le besoin de se réunir et de discuter
leurs intérêts.
On admire, à Paris, celte vaste pièce intérieure,
divisée en deux nefs, qui est un des
principaux ornemens du Palais de Justice, et
dont on va parlé à l’article De B rosses , qui en fut
l’architecte. Le nom de salle des pas perdus, qu’on
lui donne , ne signifie rien autre chose, que promenoir.
C’est là , en effet, que se réunissent tous
ceux que leurs affaires y appellent, et c’est encore
pour beaucoup de désoeuvrés -, un local favorable
à la promenade dans les mauvais temps.
Nous croyons donc que promenoir doit se dire
de tout local construit et abrité plus ou moins ,
où l’on peut se promener à couvert. Il est indispensable
d’en pratiquer ainsi dans un grand
Vitruve, dans son chapitre de interiore cella-
rum et pmnai distributions, nous montre avec
beaucoup .d’évidence ce qu’étoit le pronaos,
Après avoir établi la division proportionnelle de
| tout l’espaGe- occupé- par le temple : Reliquae très
partes (dit-il) prônai ad antas parietum pro-
currant. Çuoe antoe crassitudinem columnarum
habere debent. « Les trois parties restantes se^
» ront pour l’espace* qui s’étend jusqu’aux restes
» des murs du pronaos. Les antes doivent avoir
» en grosseur celle des colonnes ; si (contiuue-
» t-il) le temple , c’est-à-dire la cella , a plus de
» vingt pieds de large, on élevera, entre'les deux
» antes, deux colonnes qii-i sépareront l’espace
» du pronaos, de l’espace du pteroma. » Si oedes
erit latitudine major quant pedes viginti , dun
columnce inter duos antas interponantur, qu#
disjungant pteromatos et prônai spatiurn.
nombre d’édifices , tels que collèges , hospices ,
couvens, séminaires, etc.
PRONAOS : signifie, par la composition des
deux mots pro et naos, qui est en avant du naos.
Naos est uu de ces mots synonymes, en grec,
de ce que nous appelons généralement temple.
Nous n’avons consacré d’article, dans ce Diction- '
naire , ni au mot naos, ni au mot kiéron , ni à
quelques autres des noms que l ’on dounoit aux j
temples. Nous avons réservé la critique des notions
que ces mots comportent, au mot T e m p l e ,
mot générique chez les Modernes.
Toutefois, pour l’explication grammaticale du
mot pronaos, nous dirons, en deux mots, que
naos, navis , nef, expriment, dans les trois langues
, le corps principal ou la bâtisse du temple,
autrement dit le temple, considéré moins dans
toutes les parties qui pouvoient former son ensemble
, que dans la masse de son architecture.
Pour remonter à la notion élémentaire du pronaos,
il faut considérer le temple, chez les Anciens,
dans sa disposition la plus simple, qui est
celle du temple à Antes ou in Antis (comme
l’appelle Vitruve, liv. 3 , ch. i ). Ce temple
n’avoit point de colonnes autour de sa cella.
Ses murs , prolongés au-delà de la porte , se ter- '
minoient par les antes ou pilastres , qui , de cha-
quecôté, n’étoient rien autre chose que la tête de
cha que mur. Entre ces deux têtes de murs, s’éle-
voient deux colonnes : c’étoit là évidemment ce
qui constituoit l’avant-temple ou le pronaos.
Lorsqu’en agrandissant Jes temples, on voulut
augmenter la magnificence extérieure de leur
disposition ou de leur ordonnance, on le f i t , en 1
environnant le naos , autrement le mur de la
cella, y compris le pronaos, par un ou deux
rangs de colonnes. De-là les temples périptères , L
diptères , etc. ; mais cela ne dérangea rien à la
disposition comme à l’emploi du pronaos y il ne j
changea ni de forme, ni de destination , ni de
dénomination. 1
Dans les temples environnés de colonne*s, eu
dehors, le pronaosétoit un espace qui, formé
parles colonnes placées entre les antes, et en retraite
du pteroma , c’est-à-dire , des colonnes extérieures
, en était séparé par l’intervalle qui for-
moi t le promenoir circulant tout autour de la
cella. C’etoit un espace •circonscrit entre les antes
ou murs avancés de la c e lla , les colonnes qui
alloient d’une ante à l’autre , et le mur où étoit la
porte du temple (quiparies valvarum habuent
collocationem ) .
Tous les plans, des temples périptères nous
montrent cet espace si conforme à la description
de Vitruve , qu’il est impossible de s’y méprendre.
Il est bien vrai que dans plusieurs de.ces édifices
ampbiprostyles , on voit le même local ou espace
répété , avec une parfaite symétrie, à chacune
des deux façades; de sorte qu’on pourroit, s’il
n y,avoit pas eu un côté principal, celui de l’entrée
du temple , lui supposer un double pronaos.
Cependant, comme tout»le monde reconnoissoit
à chaque temple , un côté antérieur et un côté
postérieur, l’espace semblable à celui du pronaos,
qui se trouvoit au côté postérieur, étoit, et
s appeloit l’opisthodome ( opisthodomos ) , mot
tout-à-fait correspondant à celui de pronaos,
qui avoit pour synonyme le mol prodomos. Voy.
O p is t h o d o m e .
Une particularité à laquelle on a fait peu d’attention
, et que Vitruve nous a conservée, fait
croire que le pronaos pouvoit encore être distingué
par une sorte de clôture qui lui étoit propre.
Les trois entre-çolonnemens produits par les
colonnes placées entre les antes,, dévoient être
fermées par une cloison,.ou un petit mur d’appui
( pluteum) , soit de marbre , soit de menuiserie ,
de manière toutefois que des portes y étôient
pratiquées pour donner entrée dans le pronaos.
Item intercolumnia tria quee erunt inter antas et
columnas pluteis marmoreis, swe e x intestino
operefactis intercludantur, ita utijores habeant,
per quas itinera pronaofiant.
I hc pronaos du temple de Minerve ; à.Athènes,
Lv»U toutefois une disposition différente de celle
fcu’on suivoit ordinairement.. Il est assez précieux
1 vitruve nous ait transmis la menthoi* expresse
positive de celle exception. Effectivement on
§voit dans le pian encore subsistant de ee temple,
iflue l’espace du pronaos ne se,trouve pas, comme
U' [ous les autres temples cornais, renfermé entre
[le mur de la porte, les antes et les colonnes placées
entre Jes antes. Celles-ci n’y forment point
l’avance ordinaire. Elles ont en tête une colonne :
\columnis adjectis dexterâ ac sinistrâ ad humeras
Ypronai. C’est de celte maniéré (continue Vitruve)
■ bn’a été fait, pour la première fois-, à Rome , le
, temple de Castor, dans le Cirque : Hoc autem
\genere primafacta oedes uli est Castoris inCircoy
■ et il ajoute : « tels sont: le temple de Minerve ,
„ dans la citadelle d’Athènes, et celui de la même
» déesse, à Snuium dans PAttique » : Athenis
Iin ar.ee Minewes , et in Atticâ Sunio Palladis.
K. Stuart, d’après le: rapprochement de ce texte
lavée les, restes du Parthenon d’A thènes, a pro-
Iposé de remplacer, dans, la , phrase suivante de
■ Vitruve , les: mots jusqu’à présent inintelligibles,
\et uli reliqua exisona par ceux-ci : et uti reli-
wauet uo-actot quoe soient esse in frontibus ad la-
mera sunt translata. Ce changement , suggéré par
lia notion précédente, sur la»clÔLure et les entrées
■ du pronaos, reçoit la plus grande autorité, de
gl’application qu’on est forcé d’en faire, à la disposition
du temple: de Minerve.
■ ' D’où il paroît certain, que l’usage étoit de fermer
par eu bas, les entre-colonnemens du pro-
maos avec un pluteum, ou , comme nous le di-
irions, un petit mur d’appui, dans lequel on pra-
ftiquoit de petites portes d’entrée : Fores per
muas itinera ou tie-afoi. Alors il est sensible que
|deux entrées semblables ont pu être pratiquées au
■ temple de Minerve, de manière qu’au lieu de se
■ trouver à la face antérieure de cette sorte de
wbronaos, elles occupoient l ’entre-colonncmenl la-
Béral en retour, entre l’ante raccourcie et la co-
Bonne d’angle : Çuoe soient esse in frontibus ad
matera sunt translata.
I f On avoit emprunté (dit encore Vitruve) aux
lisages toscans’, une disposition semblable à la
iprecédente, et on l’avoit transportée’aux pro-
W^os des temples formés de colonnes ioniques et
po fini bien nés. Elle cou si s toit-à substituer des co-
Bonnes aux pilastres que donne l’avance des an-
Bes sur le pronaos Çuibus enini locis pronao
wprocurmnt antoe , in iisdem, è regione celloe pa-
mfetuni columnas binas collocantes.
I PRONONCER, v. act. On se sert de ce mot
■ dans les arts du dessin et aussi en architecture,
Bpour exprimer, surtout, ee qui a rapport au ca-
paclère, soit d’un ordre, soit d’un édifice.
: Ainsi l’ordre dorique des Grecs a un caractère
eaucoup plus prononcé que celui dont les Romains
ont fait usage , et dont les Modernes ont
hérité. Tout le monde sait qn’en.architecture, le
caractère de force ne peut se prononcer aux yeux
que par des formes, qui annoncent une grande solidité
mêlée à beaucoup de simplicité. Tel. cs.t le
c a ra c tè r e e t de la proportion , et de la forme de
l’ordre dorique , et ce caractère se prononce sur-
i l.Qiil dans son chapiteau, et dans Ja mâle saillie
I soit de son tailloir, soit de toutes les parties de
i son entablement..
L’élégance, la légèreté et la variété compagne
de la richesse, se trouvent prononcées aussi
clairement qu’il soit possible, dans les. ordres,ionique
et corinthien , c?est-à-dire , que l ’ensemble
et les détails de ces ordres, expriment un caractère
en tout opposé à celui de l’ordre dorique ,
des proportions plus sveltes, des membres plus
multipliés, moins saiilans, des détails beaucoup
plus variés, des profils découpés par toutes sortes
d’ornernens : voilà. ce qui prononce les qualités
qui sont propres de ces deux modes.
Il appartient à l’architecte , par le choix
qu’ il fait dans son édifice , d’un ordre ou d’un
autre, par le. plus ou le moins de détails ou
d’ornemens , et par leur emploi judicieux , de
prononcer le caractère , autrement d it, de ren-
: dr.e sensible la destination de cet édifice.
! Lorsque l’on considère les masses imposantes
et colossales des palais de Florence , on ne sau-
roit s’empêcher de reconnoître, que l’architecture
de ce temps leur donna un caractère trop pro-.
noncé. L ’emploi exorbitant qu’on fiL alors des
bossages dans leurs façades , produit une impression
sur les sens, qui tend à en dénaturer la destination.
A moins de raisons particulières , un
palais ne doit avoir l'apparence ni d’une forteresse
, ni d’un lieu qu’on veut faire paroi Ire inexpugnable.
O r , rien ne porte plus naturellement
l’esprit à de telles idées, que ces masses de pierres
rustiquement taillées qu’on appelle bossages.
Nous avons vu que cet emploi , dans ia prison de
Newgate, à Londres, en a prononcé le caractère
avec beaucoup de raison et de goût. Le bossage
se trouvera également bien placé dans le
soubassement, parce qu’il prononce avec énergie
le caractère de solidité que doit avoir cette partie
des édifices.
Qn se sert aussi du mot prononcer dans l’exécution
des détails ou des ornemens d’un édifice.
On demandera que telle ou telle moulure soit plus
clairement, plus énergiquement prononcée. L’art
de prononcer les ornemens consiste, soit dans le
fouillé qu’on leur donne, et qui les fait mieux
ressortir, soit dans la vivacité des arêtes que le
ciseau y ménage.
PROPNIGEUM. Ce mot,grec d’origine, doit,
par sa composition , signifier^/ônr en avant. C’étoit
un local, dans les bains des Anciens , qui pa>»
roit, comme Vhypocauste, avoir servi de brasies.