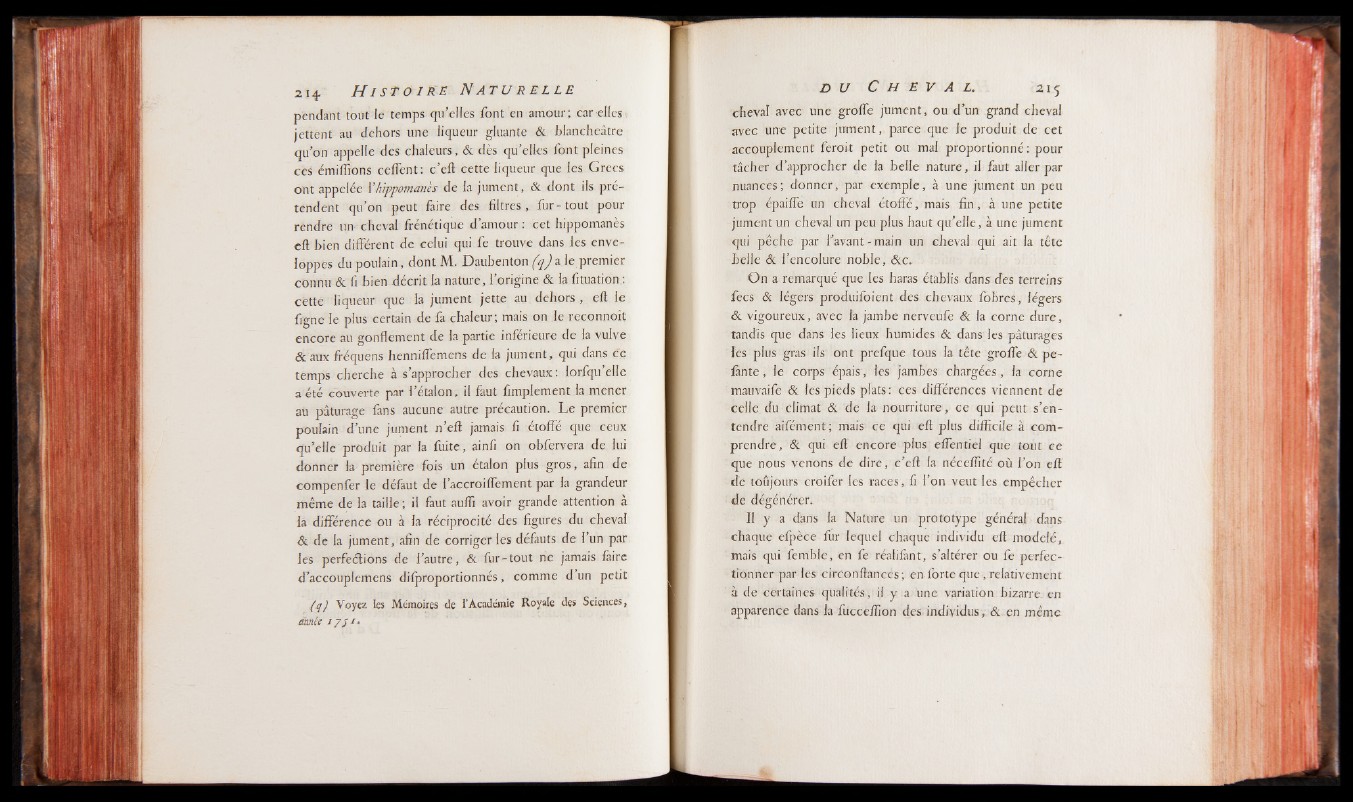
pendant tout Je temps qu’elles font en amour; car elles •
jettent au dehors une liqueur gluante & blancheâtre
qu’on appelle des chaleurs, & dès qu’elles font pleines
ces émiffions celfent: c’eft cette liqueur que les Grecs
ont appelée l’hippomanès de la jument, & dont ils prétendent
qu’on peut faire des filtres, fur - tout pour
rendre un. cheval frénétique d’amour : cet hippomanès
eft bien différent de celui qui fe trouve dans les enveloppes
du poulain, dontM. Daubenton (q) a le premier
connu & fi bien décrit la nature, l’origine & la fituation :
cette liqueur que la jument jette au dehors , eft le
figne le plus certain de fa chaleur; mais on le reconnoît
encore au gonflement de la partie inférieure de la vulve
étaux fréquens henniffemens de la jument, qui dans ce
temps cherche à s’approcher des chevaux: lorfqu’elle
a été couverte par l’étalon, il faut fimplement la mener
au pâturage fans aucune autre précaution. Le premier
poulain d’une jument n’eft jamais fi étoffé que ceux
qu’elle produit par la fuite, ainfi on obfervera de lui
donner la première fois un étalon plus gros, afin de
compenfer le défaut de l’accroiffement par la grandeur
même de la taille ; il faut auflï avoir grande attention à
là différence ou à la réciprocité des figures du cheval
Si de la jument, afin de corriger les défauts de l’un par
les perfections de l’autre, Sc fur-tout ne jamais faire
d’accouplemens difproportionnés, comme d’un petit
^q J Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences,
innée i j j e .
cheval avec une groffe jument, ou d’un grand cheval
avec une petite jument, parce que le produit de cet
accouplement feroit petit ou mal proportionné : pour
tâcher d’approcher de la belle nature, il faut aller par
nuances; donner, par exemple, à une jument un peu
trop épaiffe un cheval étoffé, mais fin, à une petite
jument un cheval un peu plus haut qu’elle, à une jument
qui pêche par l’avant-main un cheval qui ait la tête
belle & l ’encolure noble, &c.
On a remarqué que les haras établis dans dès terreins
fecs Sc légers produifoient des chevaux fobres, légers
& vigoureux, avec la jambe nerveufe & la corne dure,
tandis que dans les lieux humides & dans les pâturages
les plus gras ils ont prefque tous la tête groffe & pelante,
le corps épais , les jambes chargées, la corne
mauvaife & les pieds plats : ces différences viennent de
celle du climat & de la nourriture, ce qui peut s’entendre
aifément; mais ce qui eft plus difficile à comprendre,
& qui eft encore plus effentiel que tout ce
que nous venons de dire, c ’eft la néceffité où l’on eft
de toujours croifer les races, fi l’on veut les empêcher
de dégénérer.
Il y a dans la Nature un prototype général dans
chaque efpèce fur lequel chaque individu eft modelé,
mais qui fembie, en fe réaiifànt, s’altérer ou fe perfectionner
par les circonftances; en forte que, relativement
à de certaines qualités-, il y a une variation bizarre en
apparence dans la fucceffion des individus, & en même