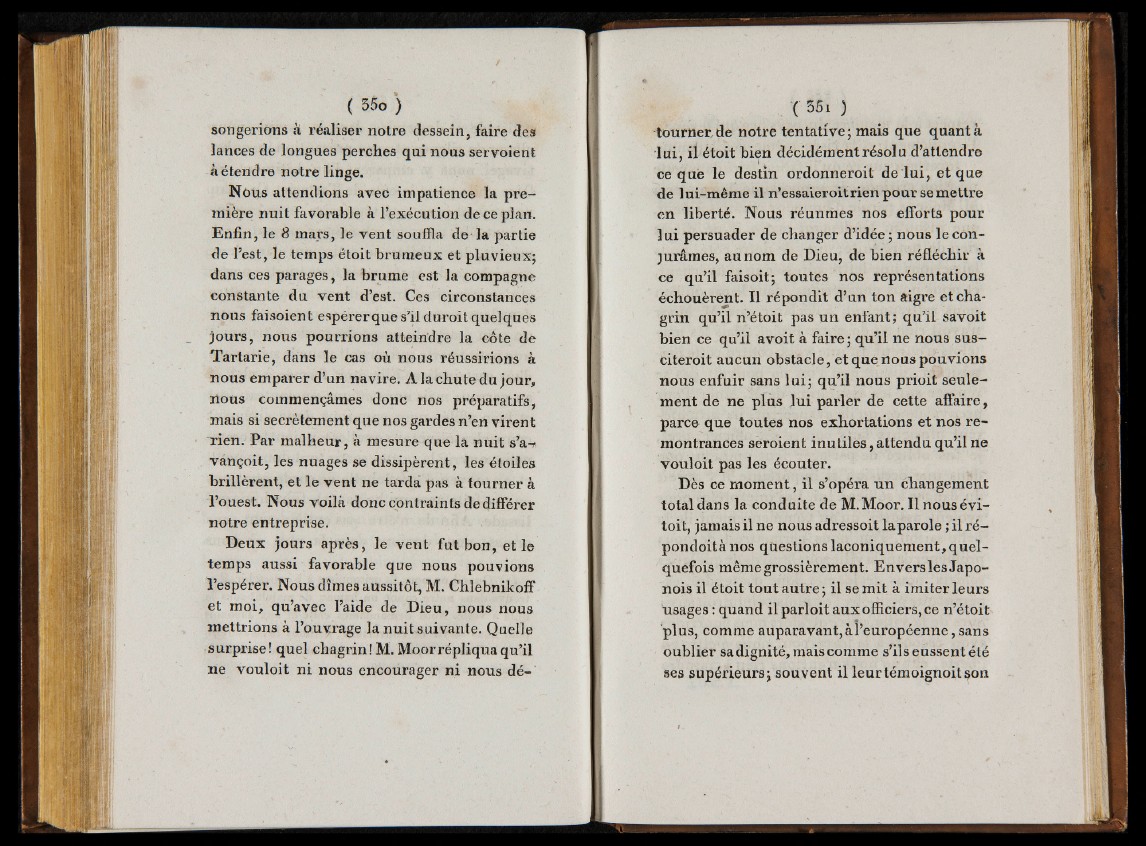
songerions à réaliser notre dessein, faire des
lances de longues perches qui nous servoient
â étendre notre linge.
Nôus attendions avec impatience la première
nuit favorable à l’exécution de ce plan.
Enfin, le 8 mars, le vent souffla de la partie
de l’est, le temps étoit brumeux et pluvieux;
dans ces parages, la brume est la compagne
constante du vent d’est. Ces circonstances
nous faisoient espérerque s’il duroit quelques
jours, nous pourrions atteindre la côte de
Tartarie, dans le cas où nous réussirions à
nous emparer d’un navire. À la chute du jour,
lions commençâmes donc nos préparatifs,
mais si secrètement que nos gardes n’en virent
rien. Par malheur, à mesure que la nuit s’a-r,
vançoit, les nuages se dissipèrent, les étoiles
brillèrent, et le vent ne tarda pas à tourner à
l ’ouest. Nous voilà donc contraints de différer
notre entreprise.
Deux jours après, le vent fut bon, et le
temps aussi favorable que nous pouvions
l ’espérer. Nous dîmes aussitôt, M. Chlebnikoff
et moi, qu’avec l’aide de Dieu, nous nous
mettrions à l’ouyrage la nuit suivante. Quelle
surprise! quel chagrin! M. Moor répliqua qu’il
ne vouloit ni nous encourager ni nous dé-
( 35i )
tourner.de notre tentative; mais que quanta
lui , il étoit bien décidément I résolu d’attendre
ce que le destin ordonnerait de lu i, et que
de lu i-m êm e il n’essaier o it rien pour se mettre
en liberté. Nous réunmes nos efforts pour
lu i persuader de changer d’idée; nous le conjurâmes,
au nom de Dieu, de bien réfléchir à
ce qu’il faisoit; toutes nos représentations
échouèrent. Il répondit d’an ton âigre et chagrin
qu’il n’étoit pas un enfant; qu’il savoit
bien ce qu’il avoit à faire ; qu’il ne nous susciterait
aucun obstacle, et que nous pouvions
nous enfuir sans lu i; qu’il nous prioit seulement
de ne plus fu i parler de cette affaire r
parce que toutes nos exhortations et nos remontrances
seraient inutiles,attendu qu’il ne
vouloit pas les écouter.
Dès ce moment, il s’opéra un changement
total dans la conduite de M.Moor. Il nousévi-
toit, jamais il ne nous adressoit la parole ; il ré -
pondoità nos questions laconiquement, quelquefois
même grossièrement. EnverslesJapo-
nois il étoit tout autre; il se mit à imiter leurs
usages : quand il pari oit aux officiers, ce n’étoit
plus, comme auparavant, à l’européenne, sans
oublier sa dignité, mais comme s’ils eussent été
ses supérieurs; souvent il leurtémoignoit son