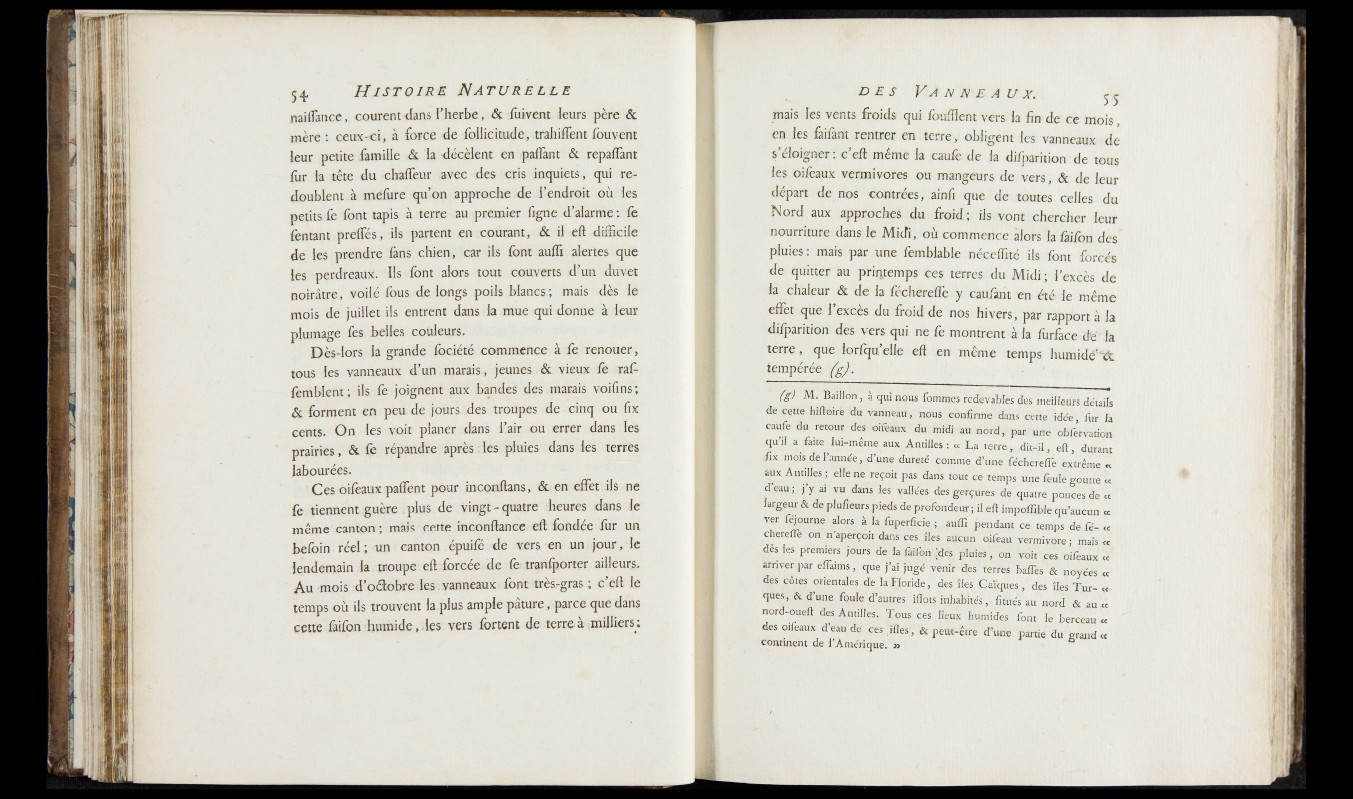
naiflance, courent'dans l’herbe, & -/utvem leurs père &
mère : ceux-ci, à force de follicitmtje., trahiffent fouvent
leur petite .famille & la décèlent en palfant & repayant
fur la tête du chafleur avec des cris inquiets^ qui redoublent
à mefure qu’on approche de l’endroit où les
petitSife font tapis à terre au ^premier figne d’alarme: fe
fentant pr.efles, ils partent en .courant, & il eft .di^kâlc
de les prendre fins chien, car ils font auffi alertes que
les perdreaux. Ils font alors tout couverts d’un duvet
noirâtre., voilé fous de longs poils blancs.; mais dès le
mois de juillet ils entrent dans ; la mue qui donne i leur
plumage fes belles couleurs.
Dès-lors la grande fociété commence à fe renouer,
tous les vanneaux d’un marais, jeunes & vieux fe raf-
femblent ; iis fe joignent aux bandes des . marais voifms ;
& forment en peu de jours jdes troupes de . cinq ou fix
cents. On les voit planer , dans isair ou errer dans les
prairies, & fe répandre après : lespjuiçs dans -les terres
labourées.
Ces oifeaux paflent pour inconftans, &/en effet ils ne
fe tiennent guère ïplus de vingt - quatre heures dans de
meme canton ; mais cette inconftance< eft fondçediir un
belçin- réel ; u n , canton .épuifë. de vers en: un jour, le
lendemain la troupe- eft forcée de fe* tranfporter ailleurs.
Au -mois d’o&ohre les. vanneaux font: :très.-gras ; c’eft le
temps où ils trouvent la.plus ample pâture, parce que dans
cette faifon humide, .les vers fortent de .terre à imiliiers;
mais les vents froids qui faufilent vers la fin de ce mois,
en les faifant rentrer en terre, obligent les vanneaux de
s’éloigner : c’eft même la caufe de la difpariiion de tous
les oifeaux vermivores ou mangeurs de vers, & de leur
départ de nos contrées, ainfi que de toutes celles du
Nord aux approches du froid ; ils vont chercher leur
nourriture dans le Midi, où commence alors la faifon des'
pluies ; mais par une femblabie néceflité ils font forcés
de quitter au printemps Ces terres du Midi ; l’excès de
la chaleur & de la féchereflè y caufant en été Je même
effet que 1 excès du froid de nos hivers, par rapport à la
dilparition des vers qui ne fc montrent à la ftirface la
terre, que lorfipi elle eft en meme temps humidd 'Â
tempérée/.^l; ;
, M. Baifldè, a qui nous Tom^e? redevables des'meilleurs détails
de ç^tte hiftêirédu vanneau, nous confirme dans Cette idée, fur la
caufe âü rètoutrd^ ôiMïix du midi aucnord, par une ôbfemtion
q-u’jl a faite lui-mêip aux Antilles: « -La terre, *îk-ii, eft, durant
dix mois de l’apnée, d’une-dureté comme d?unp fêchereffe extrême «
âtfx Antilles ; ’étte ne reçoit pas dans tout ce temps une feule goutte «
d eau; j’y ai vu dans les vallées des gerçures de quatre pouces de «
largeur & de piufîeurs pieds de profondeur; il eft impoffible qu’aucun «
ver tourne alors à la fuperfieie^auffi pendant ce temps de fé- «
chérene' -on n’aperçoit dans ces ÿ s aucun oifeau vermivore; mais«
^eS,leS. Pretniérs îôurs de la fâifon fâà pluies / on Voit ces oifeaux «
arriver par eflàims, que faffligé venir des terrés balfes & noyées «
des çÔÎ|s or^ ^ s^ d e la gorjde* des.îïes ,Caïques, des îles Tur- «
ques* & d W foule (fautes ifipts inhabités,; fitlii au nord & au«
nord-oueft des Antilles. Tous, ces jfeux InijnideVffont le berceau «
des oifeaux d’eau de t^à/iîîes, & peût-être d’une partie' du grand«
Continent de l’Amérique. » :