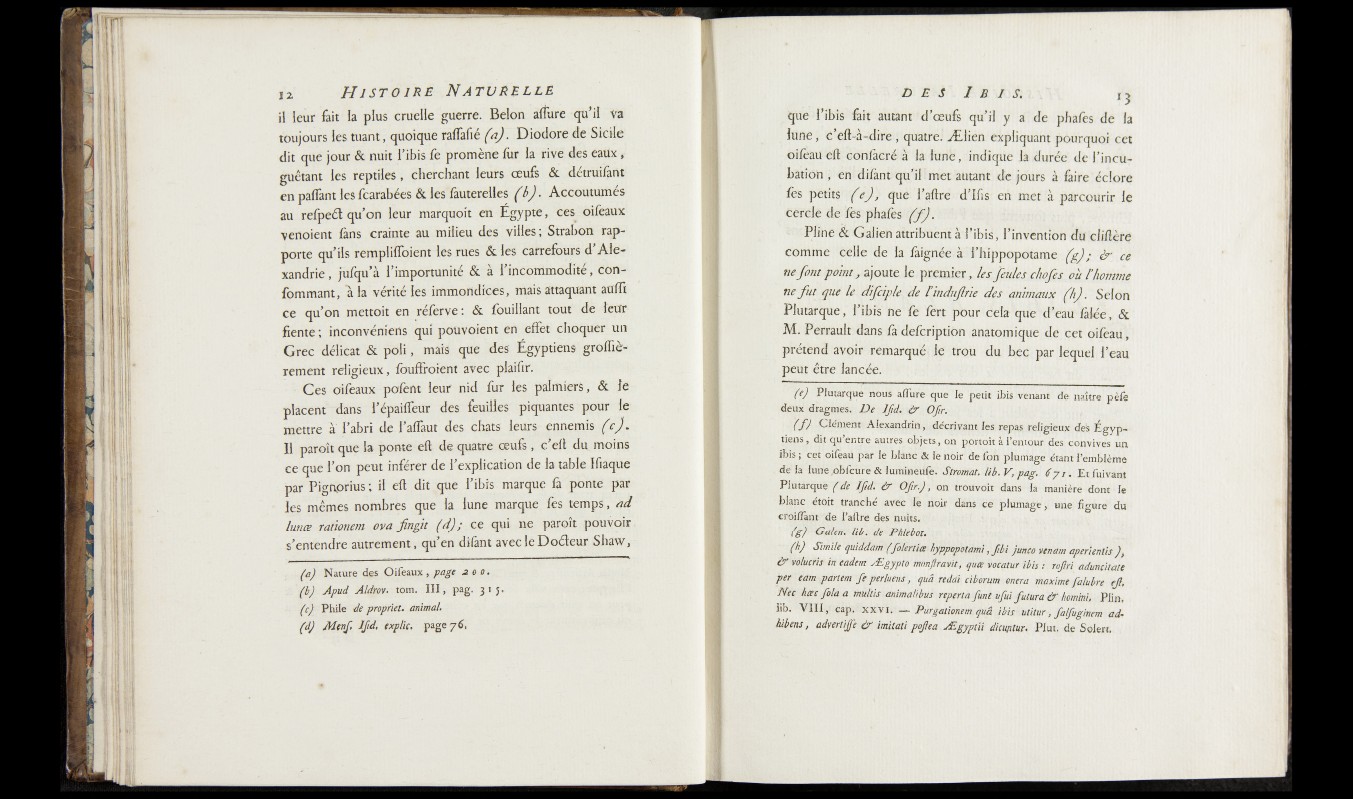
i 2 H i s t o i r e N a t u r e l l e
ii leur fait la plus cruelle guerre. Beloa afîure qu’il ta
toujours les tuant, quoique rafïafié (a). Diodore de Sicile
dit que jour & nuit l’rbis fe promène for la rive des eaüx,
guêtant les reptiles, cherchant leurs oeufs & détruifant
en paftànt les fcarabées & lesTauterelles (b ) . Accoutumes
au refpeét qu’on leur marquoît en Égypte, ces^ oifeaux
venoient fans crainte au milieu des villes; Strabon rapporte
qu’ils rempliÏÏbient les rues &les carrefours d’Alexandrie
, jufqu’à l’importunité & à i’incommodité, con-
fommant, a la vérité les immondices, mais attaquant atfflî
ce qu’on mettoit en réferve : & fouillant tout de leur
fiente; inconvéniens qui pouvoient en efîè-t choquer un
Grec délicat & poli, mais que des Égyptiens groffiè-
rement religieux, foudroient avec plaifir.
' Ces oifeaux pofent leur nid for les palmiers, & ,1e
placent dans i’épaifFeür des feuilles piquantes pour le
mettre à l’abri de J ’aflaut des chats leurs ennemis fe ) .
Il paroît que la ponte eft de quatre oeufs , c’eft du. moins
ce que l’on peut inférer de l’explication de la table Ifiaque
par Pigaorius ; il eft dit que l’ibis marque là ponte par
les mêmes nombres que la lune marque fes tempS, M
Iwioe rationem ova fingit (d); ce qui ne paroît pouvoir
s’entendre autrement, qu’en dilàfit avec le D odeur Shaw,
, f a ) Nature dps Oifeaux t page <a »0.
: (b) Apud Aldrov. tom. I I I , pag. 3 1 j.
- (c) Phile de propriet. animai
(d) Menf, Ifid, explic. page y 6,
D E S 1 B J S. ï / ' 13
que l’ibis fait autant d’oeufs qu’il y a de phafes de la
lune , c’eft-à-dire * quatre: Ælien expliquant pourquoi cet
oifeàU eft, GonfaCréià la lune, indique la durée de l’incubation
i en dilànt qü il met autant de jours à faire éclore
fe-s petits- ' ( è f ) qué; l’aftré d’ifïsr en met à parcourir le
Cerclé de fes phafes ; t
Pline <x Galien attribuent à l’ibisb l’invention du cliftère
comme celle de la làignée à l’hippopotame fg j; ce
n e f ont -point ^ajoute le premier, gjjjfeulej.f/iqfês où l’homme
ne fu t que U difciplefe llindujlrïe des animaux (h). Selon
Plutarque, l’ibis ne fe fèrt -pbiir’^darlqu^dW-làiéè, &
M. Perrault dans fa defcription anatomique de cet oifeaü ,
prétend avoir remarqué-. le‘ trou du bec par lequel l’eau
peut être lancée.., *&
(e) Plutarque nous allure- qué le petit ibis venant de naître pèle
deux dragmes. De Jfid. àr OJîr.
: ( f ) Clément-'Alexandrin, ,décriv.ant les repas, religieux de's Égyp-
m ÿÈ dit qw’emre autres^objets, on nmoit à l’éntoty-, des convives un
ibis j cgtdiîêad par le blanc & le noir de fok plumage étant l’emblème
de la lune pbfcure & lurriineille. Stronîat. lïb. V, pag. d p i. Et fuivant
Piutarquë (de tfid r tf Ofirz}\ on trouvoit dans- la manière dont le
blanc était tranché avfec 'Ife hoir dans ce plumage, «ne, figure’ du
efipifîàntfde î’aftfé des nuits»;
(g) Galen. lib. de Phlebot.\y
•T /V Sïmih quiddam (folertice hyppopotami, fibi jütico venant aperientis ) t
& vôluctis? in eadem Ægjpto mnpavit, quoe vocqtur ibis :: rojln aduncitate
per eam tparlemfè perluens, quâreddi, ci b emmènera maxime fakbre ejf,
Née haie fila a ihultis: Mmaiiblis repma funtvfui futur a '& hommï Piin.
Itb. VIII-,2 cap. XXVI. Pùrgationem^quâ ibis: utitur -, falfugmem ad-
hibens , advertïjfe&mitaü pojlea Ægyptii dicujitur. Plut, de Solert. *