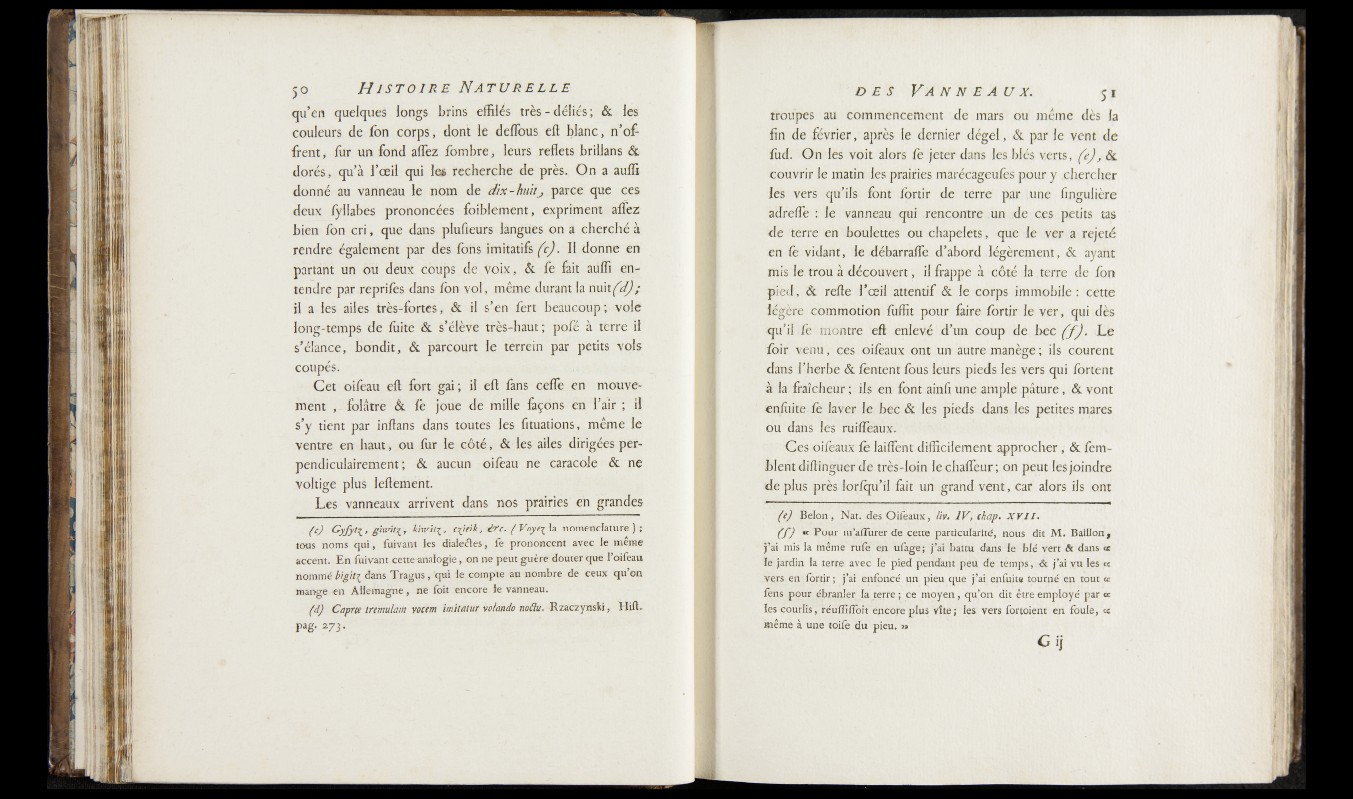
5Q H i s t o i r e N a t u r e l l e
qu’en quelques longs brins effiles très - déliés ; & les
couleurs de fon corps, dont le deffous eft blanc, n’offrent,
fur un fond affez fombre, leurs reflets brilians &
dorés, qu’à J’oeii qui le« recherche de près. On a auffi-
donné au vanneau Je nom de dix - h uitj parce que ces
deux fyilabes prononcées faiblement, expriment affez
bien fon cri, que dans plufleurs langues on a cherché à
rendre également par des lotis imitatifs ( c ) . II donne en
partant un ou deux coups de Voix, & fe fait auffi entendre
par reprifès dans fbn vol, meme durant la nm tfid );
il a les ailes très-fortes, & il s ’en fert beaucoup ;-vole
long-temps de fuite & S’élève très-haut ; pofé à ttrre il
s’élance, bondit, & parcourt le terrein par petits vols
coupés.
Cet oifeau eft fort gai ; il eft fans ceffe en mouvez
ment ,.. folâtre & fe joue de mille laçons éti l’air ; il
s’y tient par inftans dans toutes les fituations, meme le
ventre en haut-, ou lùr le côté * & les ailes dirigées perpendiculairement
; & aucun oilèau ne caracole & ne
Voltige plus leftemént.
Les vanneaux arrivent dans nos prairies eh grandes
( i j Gyjytii giwh^y (Voye\ la Moméjérianire | ?
tous noms qui, fuivant les diaïeétes, fe prononcent avec le mêjHff
accent. En fuivant cette-analogie >. on ne peut guère-douter que I’oifeau
nommé bigiti dans Tragus, 'qui ie compte an nombre de ceux qu’m
mange en Allemagne, ne foit encore le vanneau.
Çd) Capne trerdtililift vocem imitstut volando noélu, Rzaczynski, Hift.
pag. 273. •
troupes au commencement .de mars ou même dès la
fin de février, après le dernier dégel, & par le vent de
fiid. On les voit alors fe jeter dans les blés verts, (e), &
couvrir le matin les prairies marécageulès pour y .chercher
les vers qu’ils font iortir de terre par une fingulière
adreffe : le vanneau qui rencontre .un .de ces petits tas
-de terre en boulettes ou chapelets, que le ver a rejeté
en fè vidant, le débarraffe d’abord .légèrement, & ayant
mis le trou, à-découvert, il frappe à côté la .terre de fon
pied, & refte l’oeil attentif & le corps immobile : cette
légère commotion îùffit pour faire fbrtjr le ver, qui dès
qu’il .fe montre eft enlevé d’un coup de bec (f). Le
foir v«énu , ces oifèaux ont .un autre manège;, ils courent
dans l’herbe &fentent fbùs leurs pieds, lèp: vers qui fbrtent
à la fraîcheur ; ils en font ainfi une ample pâture, & vont
-enjiiitefè laver le bec & les pieds dans, les petites mares
ou dans les •ruhffeâ’ùx.?''^
Çes oifèaux fè laiffent difficilement approcher, & fèm-
blent diftinguer de très-loin le chaffeur; on peut lés joindre
de plus près-lorfqu’il fait un grand vent, car alors ils ,o.nt
(e) Bdon-, Nat.ées Oifèaux, liv. IV , thap. %VII.
(f) * Pour m’affurer de cette particularité, nous dit M. Bâillon ,
j ’ài mis la même rulëf eji ufage ;; j’ai battu dans le • Blé Vert & dans «
îe Jardin là terre ave© le pied pendant peu dç temps, & j’ai vu les «
.vers en-fbrtjr ; j’ai enfonCé jan pieu que fai, enfuit« tourné en tout «e
fens ppur ébranler la terre ; çe moyen, qu’on dit être employé par ce
les courlis, réüffifîbit encore plus rite ; les vers fortoient en foule, c<
Blême à une toife du pieu. »
Ci j