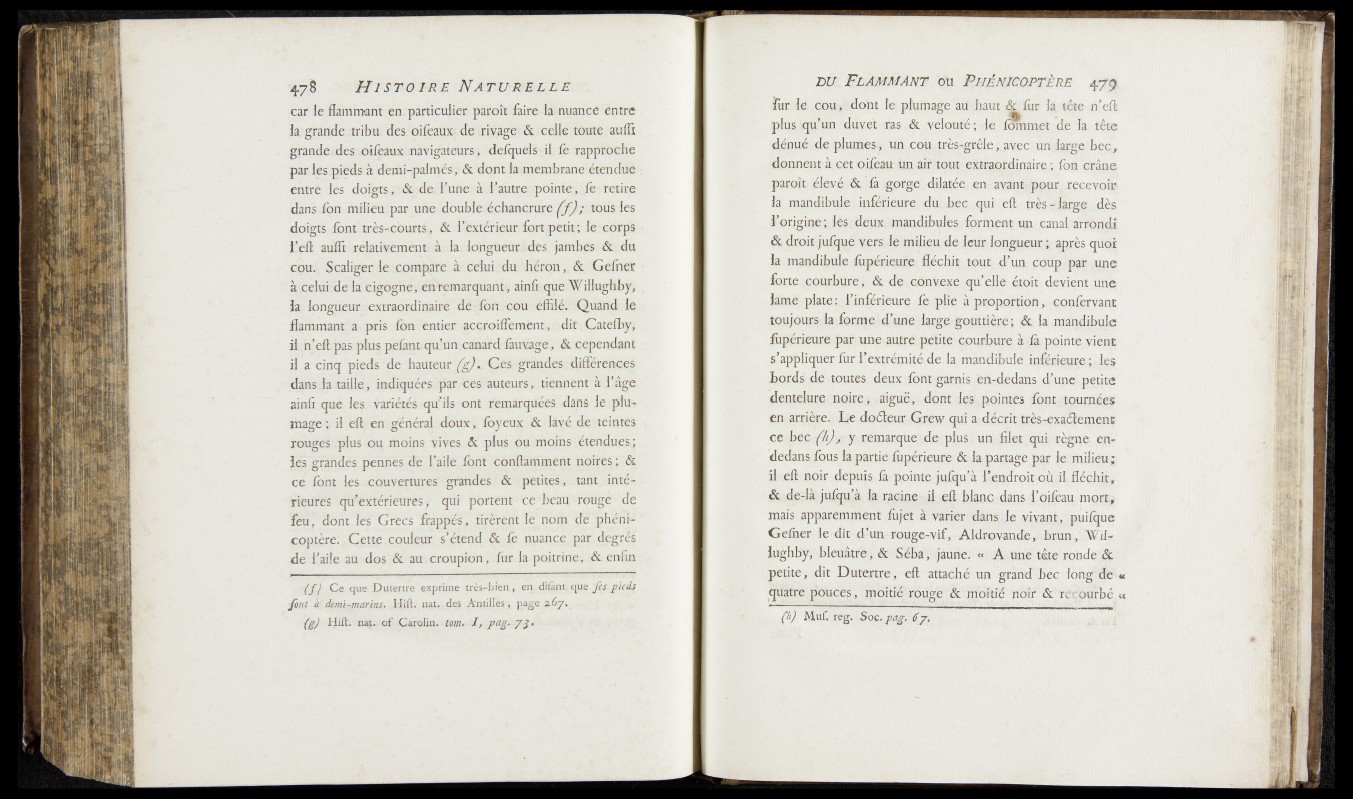
47 & H J S T O I R E N a t u r e l l e
car le flammant en.particulier, pàroît faire la nuance entre
la grande tribu, des oifeaux de rivage & celle toute auflt
grande des .oifeaux navigateurs * defquels il fe rapproche
par les .pieds à demi-palmés , & dont la membrane étendue
entre les doigts y & de. Tune, à l’autre pointe, J le retire
dans Ion milieu par une double échancrure ( f ) ; tous les
doigts font très-courts., & l’extérieur fort petit ; le corps
l’.eft aufli relativement à. la. longueur des jambes & du
cou. Scaliger le compare à celui du héron, & Gefner.
à,celui de la cigogne,.enïemarquant, ainfi/que Willughby*
la longueur extraordinaire de fon cou effilé.: Quand le
flammant a pris fon entier accroiffement, . dit . Gatefby,
il n’eft pas plus pefant qu’un canard fauvage, & cependant
il a cinq pieds de hauteur (g),. Ces grandes différences
dans la taille, indiquées par ces auteurs, tiennent à l’âge
ainfi que les variétés qu’ils ont remarquées dans le,plu*
m a g e ; il eft en générai doux , foyeux & lavé de teintes
rouges plus ou moins vives & plus ou moins étendues;;
les grandes pennes de l’aile font conftamment noires ; &
cé font les couvertures grandes & petites, tant intérieures
qu’extérieures î qui portent ce ’b eau ro u g e de
feu, dont les Grecs frappés, tirèrent le nom de phénr-
coptère. Cette couleur s’étend & fe nuance par degrés
de l’aile au dos & au croupion, fur la poitrine, & enfin
( f ) Ce que Dutertre exprime très-bien, en difant que f is pieds
font à' demi-marins. Hift. nat. des Antilles, page 2.67.
(g) Hift. natr of Carolin. tom. I , pag, 7$*
d u F l a m m a n t ou P h én ïco p tè r e 4 7 9
îùr le cou, dont le plumage au haut & flir la tête n’efl,
plus qu’un düvét -ras & velouté ; le fmnmet de la tête
dénué de pluihés , un cou très-grêle;, avec un» large d>eq,
donnent à cet oifeau un air tout extraordinaire ; fon crâne
paroît- 'élevé & fà gorge dilatée en avant, pour^recevoîr
la mandibule inférieure du |bec qui eft très-large dès
un canaf arrondi
& droit jufquè vers le milieu de leur longueur ^prés quof
la mandibule fopérieule fléchit tout d’un coup par une
forte courbure, & dé convexe qu’efle étoit-dçyient une
lame plate: l’inférieure fè ’plie à proportion;,, confèrvant
toujours la forme d’une large gouttière- &, la mapflihule
fùpérieure par une autre petite courbure à-fâ pointe vient
s’appliquer fur l’extrémité,de la mandibule inférieure; les
bords de toutes deux font garnis ën-dedans d’une petite
dentelure noire,- ..aiguë,• dont les;|pointes font tournées
en arrière. Le doéfeur Grew qui a décrit tx.ès-exaélement
ce Jbec ^i®R y remarque ; de plus un filet qui régne en-
dedans fous la partie fùpérieure & la partage par le milieu ;
îl eft noir depuis; fà pointe jufqu’à l’endrok où il fléchit,
& de-là jufqu’à la racine il eft blanc flans-ÿojfeaumort,
mais apparemment fùjet à varier dans, le vivant, puifque
Gefner le dit d’un rouge-vif, Aldrovande, brun\ViL
lughby, bleuâtre, & Séba, jaune. « A une tête-ronde &
petite , dit Dutertre, eft attaché un grand hec long de «
quatre pouces, moitié rouge & moitié noir & rec’ourbé «
(h) Muf. reg. Soc, pag. 6/,