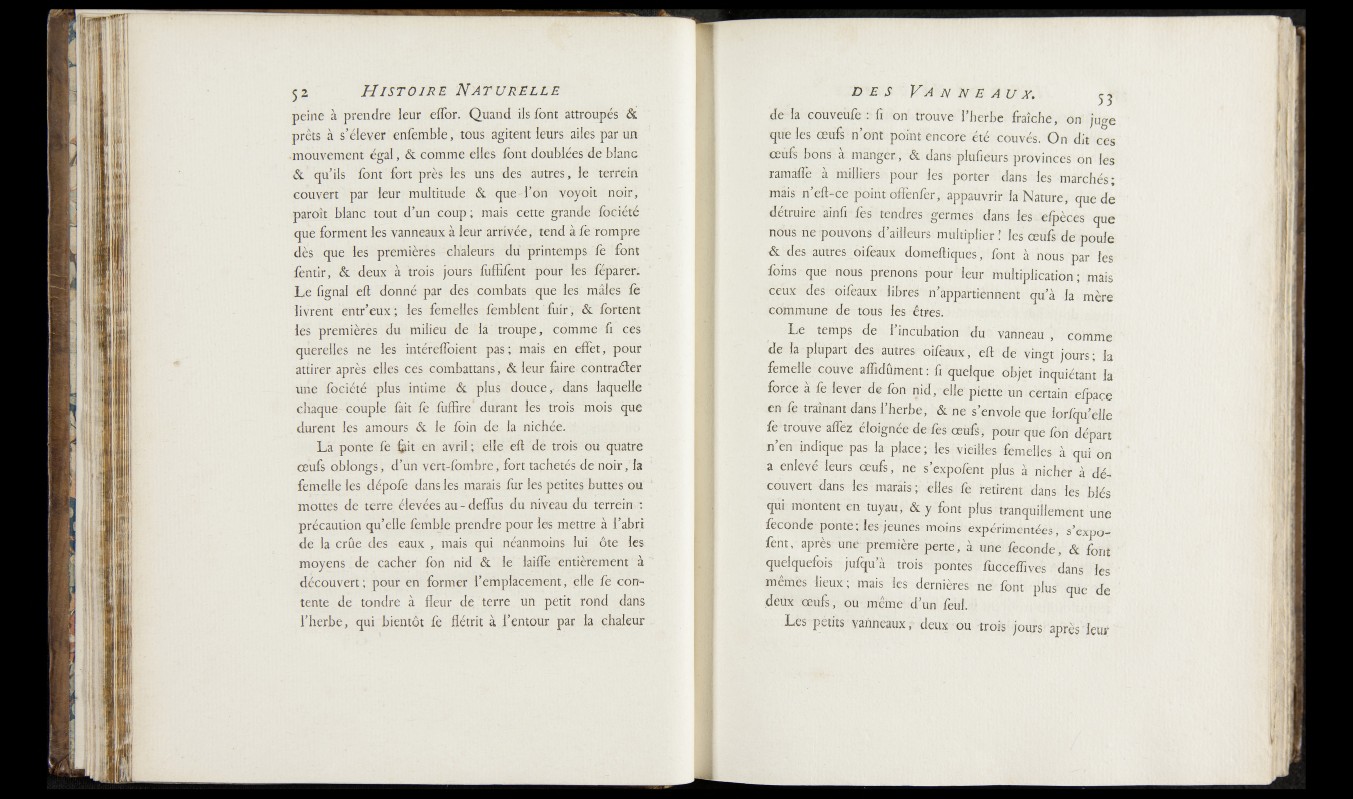
52 H i s to i r e N a t u r e l l e
peine à prendre leur éflbr. Quand ils font attroupés &
prêts à s'élever enfemble, tous agitent leurs ailes par un
•mouvement égal , & comme elles font doublées de blanG
& qu’ils font fort présidés uns des autres, le terrein
couvert par leur multitude & que-l’on voyoit noir,
paroit, Blanc tout d’un coup ; mais cette grande foeiéré
que forment les vanneaux à leur arrivée, tend àfe.rompre
dès que les premièrès--~chaleurs du printemps'fe font
fentiff*& deux ' à trois , jours foffifent pour? les. fépareri
Le fignal eft donné par des/combats que les mâles le
livrent entr’eux f les femelle^femblent -ferr& 'É»rïent
les premières du milieu dedâ' troupe,. comme Li ces'
querellé^? ne les intéreffoient pas ; mais en effet, pour
attirer après elles ces^eombattansy & leur faire, èontraéler
une foeiété plus intime & plus, douce, dans laquelle
chaque-couple fait fè fuffire* durant ;lësf trois ‘ mMs que
. durent les amours & le foin ‘de la nichée., L
Là ponte fe -frit-en avril; elle eft de trois ou quatre
oeufs oblongsf d’un vert-fombre, fort taphefo»de noir, la
femelle les dépofè dans les . marais fur les petites buttes ou
mottes de terré élevées au-deflus du niveau du terrein :
précaution qu’elle femble prendre pour los mettre à l’abri
de la crue des eaux , mais qui néanmoins lui ©te des
moyens/de cacher fon nid & le laide ,'entièrement ' à
découvert ; pour en former l’emplacement, elle fé contente
de tondre à fleur de, terre un petit. rond dans
l’herbe, qui bientôt le flétrit à fentour par la phaieur
de"îa coiiveiife fl on trouve f herbe fraîche, on juge
que des oeufs n’ont point encore été couves. On dit ces
oeûfs bons’" à manger,, & dans* plufieürs provinces ôn les
ramafley,;| milliers pour les porter dans les marchés;
mâis: n’eâ-ée point dffenfer, appauvrir la Nature, que de
détruire,vainfof©s- tendres fermes' dans iesJëfpèces que
nous rie pouvons d’ailleurs multiplier! les oeufs de poule
& ‘dey ‘autres oifeaux domeftiques ; font à nous par les
•fobsVquéf«eus prenons'pour leur multiplication; mais
ceut des - oifèaux 11 ibrdf" n ’ âpparti en n ent qu’à la mère
commune de-tous les êtres.
i-Le -témps.t de l’incubation du | vanneau | comme
de la-plupart des autres oifeaux, ëâ‘de vingt jours; la
femelle;cdüve aflidûment: fi.quelque objet inquiétant la
force à Le lever de fon nid,- elle piettè-un certain èfpace
en fe traînant dans l’herbe, & ne s’envoie que lor/qufolie
fè'trouve aflez éloignée deLes^oeufs, pour que fon départ
n’en indique pas la-place ; des;'vifeilles‘femelles à qui on
a enlevédëurs oeufs, ne s’expofent plus à nicher à découvert
dans les-marais;’ elles-fe Retirent dâps lès'blés
qui montent en tuyau, &y font plus ' tranquillement une
féconde ponte; les-jeunes-*moins expérimentées, s’expo-
fenty après-une-première-perte, à une fécondé, & font
quelquefois^ jufqii&'l trois* pontes fucceifivéS ; dans les
mèmès lieux-; mais les dernièmâ ne font plus que de
deux oeufs , ou même* d’un fehfcif
Lès -pétits | vanneaux f deu x >ou trois f jours après Leur