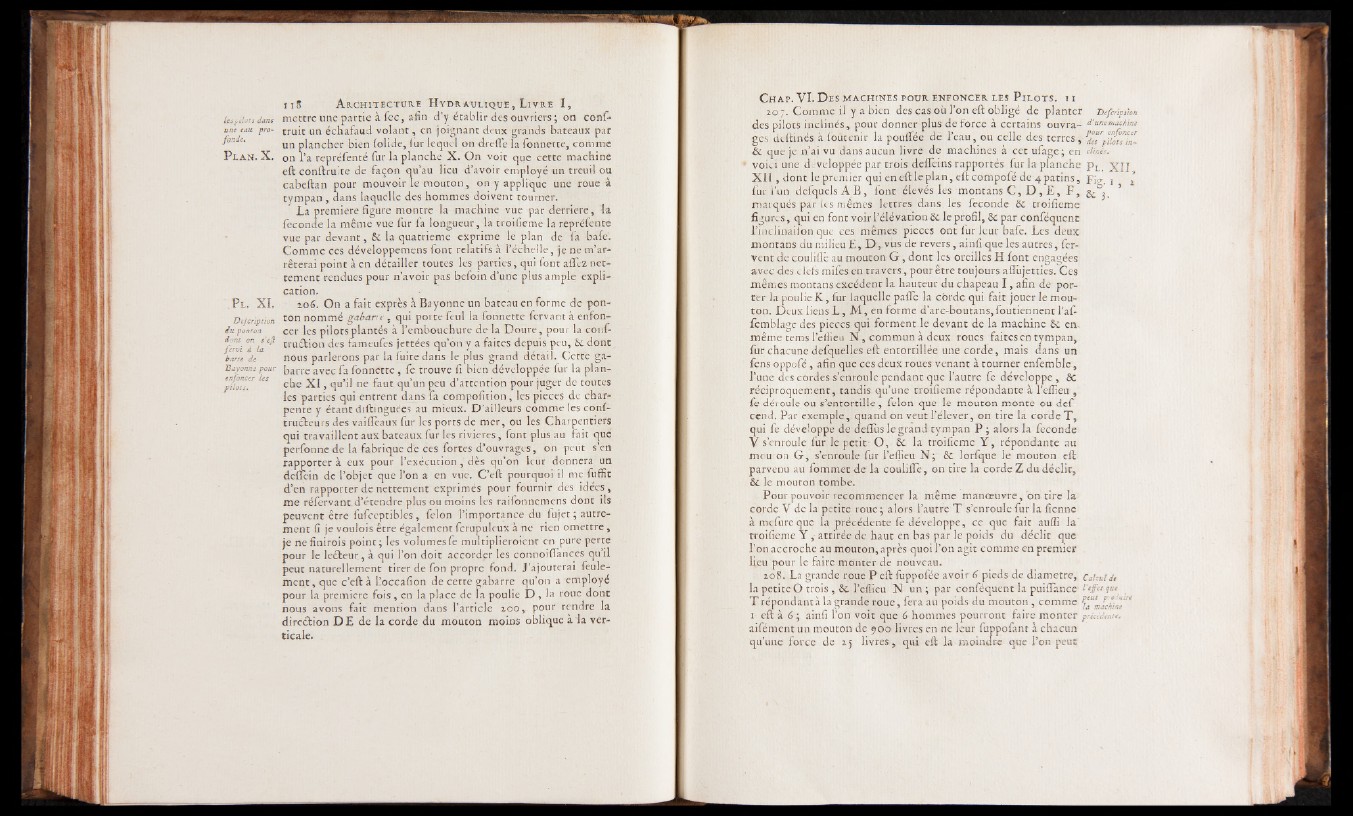
les pilots dans
une eau profonde.
P lan. X .
P l . XI,
Dejcription
du ponton
dont on s ’ejl
fe rv i d la
barre de
Bayonne pour
enfoncer les
pilots.
n S A rchitecture Hyd rau l iq u e , L iv r e I ,
mettre une partie à fec, afin d’y établir des ouvriers; on conf-
truit un échafaud volant, en joignant deux grands bateaux par
un plancher bien (olide, fur lequel on drefle la fonnerte, comme
on l’a repréfenté fur la planche X . On voit que cette machine
eftconftruite de façon qu’au lieu d’avoir employé un treuil ou
cabeftan pour mouvoir le mouron, on y applique une roue à
tympan, dans laquelle des hommes doivent tourner.
La première figure montre la machine vue par derrière, la
fécondé la même vue fur fa longueur, la troilîeme la repréfente
vue par devant, 8c la quatrième exprime le plan de fa baie.
Comme ces développemens font relatifs à l’échelle, je ne m’arrêterai
point à en détailler toutes les parties, qui font alfez nettement
rendues pour n’avoir pas befoin d’une plus ample explication.
z o 6. On a fait exprès à Bayonne un bateau en forme de ponton
nommé g a b a r e , qui porte feul la fonnette fervant à enfoncer
les pilots plantés à l’embouchure de la Doure, pour la çonf-
truéfcion des fameufes jettées qu’on y a faites depuis peu, St dont
nous parlerons par la fuite dans le plus grand détail. Cette ga-
barre avec fa fonnette , fe trouve fi bien développée fur la planche
X I , qu’il ne faut qu’un peu d’attention pour juger de toutes
les parties qui entrent dans fa compofition, les pièces de charpente
y étant diftinguées au mieux. D ’ailleurs comme les conl-
trucfeuis des vaillèaux fur les ports de mer, ou les Charpentiers
qui travaillent aux bateaux fur les rivières, font plus au fait que
perfonne de la fabrique de ces fortes d’ouvrages, on peut s’en
rapporter à eux pour l’exécution, dès qu’on leur donnera un
dellèin de l’objet que l’on a en vue. C ’eft pourquoi il me fuffit
d’en rapporter de nettement exprimés pour fournir des idées,
me réfervant d’étendre plus ou moins les raifonnemens dont ils
peuvent être fufceptibles, félon l’importance du fujet; autrement
fi je voulois être également fcrupulcux à ne rien omettre ,
je nefinirois point; les volumes fe multiplieroient en pure perte
pour le leébeur, à qui l’on doit accorder les connoiftances qu’il
peut naturellement tirer de fon propre fond. J ’ajouterai feulement
, que c’eft à lloccafion de cette gabarre qu’on a employé
pour la première fois, en la place de la poulie D , la roue dont
nous avons fait mention dans l’article z o o , pour rendre la
direction D E de la corde du mouton moins oblique à la verticale.
C hap. VI. D es machines pour enfoncer les P ilo t s , i i
20 7. Comme il y a bien des cas où l’on eft obligé de planter z><fcnpùon
des pilots inclinés, pour donner plus de force à certains ouvra-
ges deftinés à foücenir la poulfée de l’eau, ou celle des terres\ fda f f u i b -
&c que je n’ai vu dans aucun livre de machines à cet ufage; en clir.is.
voici une développée par trois defleins rapportés fur la planche p L x j j
X I I , dont le premier qui en eft le plan, eft compofé de 4 patins, Fiu. 1 ,
fur l’un defquelsAB, font élevés les montans C , D , E , F , 8c i . ’
marqués par les mêmes lettres dans les fécondé 8c troilîeme
figures , qui en font voir l’élévation fic le profil, 6c par conféquent
l ’inclinaiion que ces mêmes pièces ont lur leur bafe. Les deux
montans du milieu E , D , vus de revers, ainfi que les autres, fervent
de coulille au mouton G , dont les oreilles H font engagées
avec des clefs mifes en travers, pour être toujours allùjetties. Ces
mêmes montans excédent la hauteur du chapeau I , afin de porter
la poulie K , fur laquelle paffe la corde qui fait jouer le mouton.
Deux liens L , M , en forme d’arc-boutans,foutiennentl’af-
femblagc des pièces qui forment le devant de la machine 6c en,
même tems l’elîieu N , commun à deux roues faites en tympan,
fur chacune defquelles eft entortillée une corde, mais dans un
fens oppofé, afin que ces deux roues venant à tourner enfemble,
i ’une des cordes s’enroule pendant que l’autre fe développe, 8c
réciproquement, tandis qu’une troifieme répondante à l’elîîeu ,
fe déroule ou s’entortille , félon que le mouton monte ou def-
cend. Par exemple, quand on veut Pélever, on tire la corde T ,
qui fe développe de delïùs le grand tympan P ; alors la fécondé
V s’enroule fur le petit O, 6c la troifieme Y , répondante au
mou on G , s’enroule fur l’elîieu N ; 6c lorfque le mouton eft
parvenu au fommet de la couliflè, on tire la corde Z du dédit,
6c le mouron tombe.
Pour pouvoir recommencer la même manoeuvre, on tire la
corde V de la petite roue ; alors l’autre T s’enroule fur la fienne
à mefure que la précédente fe développe, ce que fait auffi la
troifieme Y ,• attirée de haut en bas par le poids du dédit que
l ’on accroche au mouton, après quoi l’on agit comme en premier
lieu pour le faire monter de nouveau.
20S. La grande roue P eft fuppofée avoir 6 pieds de diamètre, cdzuldt
la petite O trois , 6c l’elîieu N un; par conféquent la puiflance l'c ff»qut
T répondant à la grande roue, fera au poids du mouton , comme
1 eft à 6 ; ainfi l’on voit que 6 hommes pourront faire monter pricidenn.
aifément un mouton de 900 livres en ne leur fuppofanr à chacun
qu’une force de 15 livres, qui eft la moindre que l’on peut