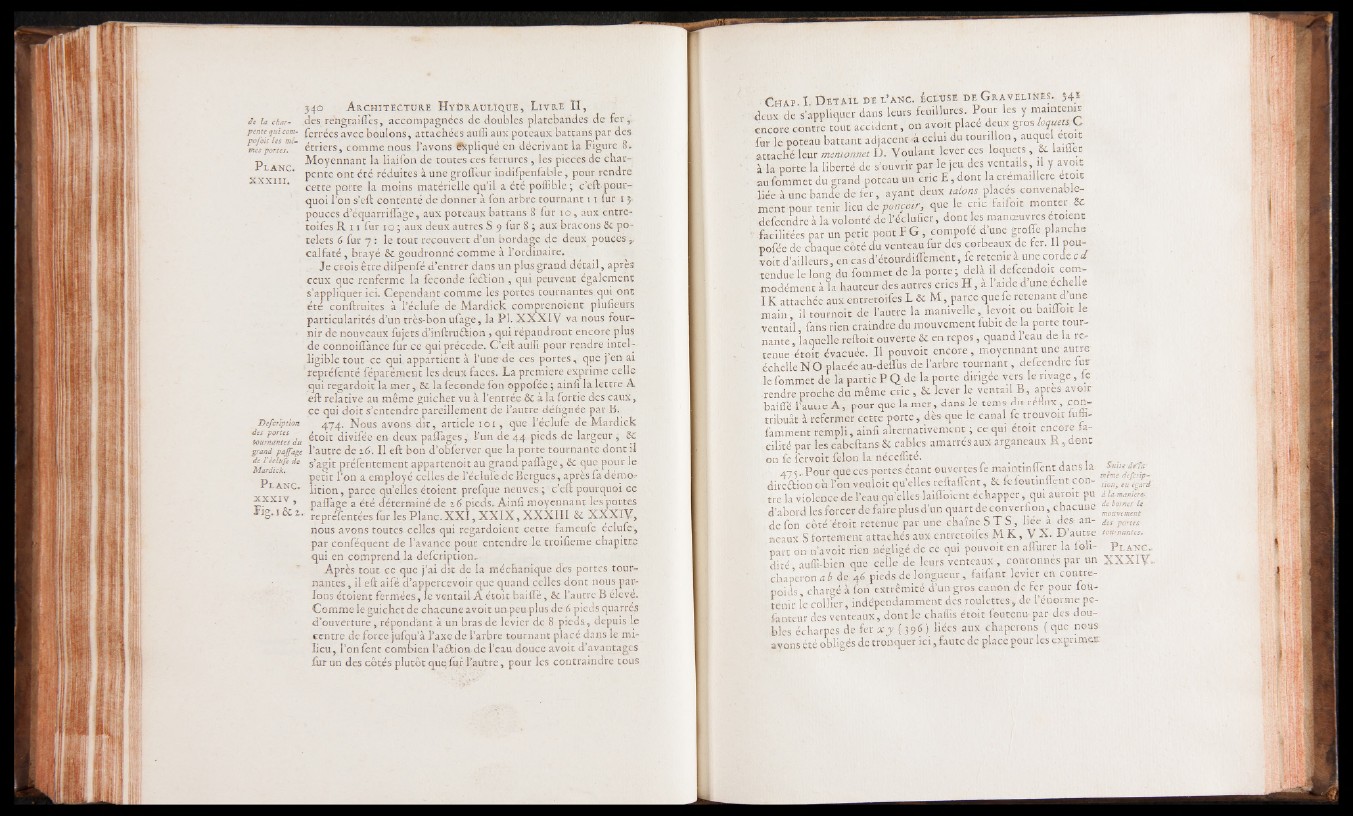
de la charpente
qui com-
pofoic les memes
portes.
P lànc.
X X X I I I.
Defcription
des portes
tournantes du
grand pajfage
de l ’éclufe de
Mardick.
Planc.
X X X IV ,
F ig .i8 tz .
540 A rchitecture Hydraulique, L ivre I I ,
des rengraiffès, accompagnées de doubles platebandes de fe r,.
ferrées avec boulons, attachées aulfi aux poteaux battans par des
étriers, comme nous l’avons Expliqué en décrivant la Figure 8»
Moyennant la liajfon de toutes ces ferrures, les pièces de charpente
ont été réduites à une grofîcur indifpenfable, pour rendre
cette porte la moins matérielle qu’il a été poffible ; c’eft pourquoi
l’on s’eft contenté de donner à fon arbre tournant 1 1 fur 1 j.
pouces d’équarriiïage, aux poteaux battans 8 fur 10 , aux entre-
toifes R 1 1 fur 10 ; aux deux autres S 9 fur 8 ; aux bracons 6c po-
telets 6 fur 7 : le tout recouvert d’un bordage de deux pouces ,,
calfaté, brayé 8c goudronné comme à l’ordinaire.
Je crois être difpenfé d’entrer dans un plus grand détail, apres
ceux que renferme la fécondé feétion , qui peuvent également
s’appliquer ici. Cependant comme les portes tournantes qui ont
été conftruites à l’éclufe de Mardick comprenoient plulieurs
particularités d’un très-bon ufage, la PL X X X IV va nous fournir
de nouveaux fujets d’inftrüchion , qui répandront encore plus
de connoiflance fur ce qui précédé. C ’eft auflî peur rendre intelligible
tout ce qui. appartient à l’unexle ces portes, que j’en ai
repréfenté féparément les deux faces. La première exprime celle
qui regardoit la mer, 8c la fécondé fon oppofée ; ainfi la.lettre A
eft relative au même guichet vu à l’entrée 8c à la fortie des eaux,
ce qui doit s’entendre pareillement de l’autre délignée par B.
474. Nous avons dit, article 101 , que l’éclule de Mardick
étoit divifée en deux paflages,. ïu-n de 44 pieds de largeur, Ôc
l’autre de 1 6 . Il eft bon d’obferver que la porte tournante dont il
s’agit préfentement appartenoit au grand paflage, 8c que pour le
petit l’on a employé celles de l’éclufe de Bergues, après fa démolition,
parce qu’elles étoient prefque neuves ; c’eft pourquoi ce
paflage a été déterminé de s 6 pieds.. A-infi moyennant les portes
repréfentées fur les P lan c .X X I, X X I X , X X X I I I 8c X X X IV ,
nous avons toutes, celles qui regardoient cette fameufe éclufe-,
par conféquent de l’avance pour entendre le troifîeme chapitre
qui en comprend la defcription.
Après tout ce que j’ai dit de la méchanique des portes tournantes
, il eft aifé d’appercevoir que quand celles dont nous parlons
étoient fermées, le ventail A étoit b aille, 8c l’autre B éleve.
Comme le guichet de chacune avoit un .peu-plus de 6 pieds quarres
d’ouverture, répondant à un bras de levier de 8 pieds, depuis le
centre de force jufqu’à l’axe de L’arbre tournant placé dans le milieu,
l’onfent combien l’aétion-de l’eau douce avoit d’avantages
fur un des côtés plutôt que,fur l’autre, pour les contraindre tous
C hap I D étail de l’anc. écluse de G ravelines. 54*
deux de s’appliquer dans leurs feuillures Pour les y maintenir
encore contre tout accident, on avoit place deux gros loquets C
fur le poteau battant adjacent -à celui du tourillon, auquel étoit
attaché leur memonnet D. Voulant lever ces loquets , 8c laitier,
à la porte la liberté de s’ouvrir par le jeu des ventails, il y avoit
aufommet du grand poteau un cric E , dont la cremaillere etoit
liée à une bande de fer, ayant deux talon s places convenablement
pour tenir lieu d e p o n c o t r , que le cric faifoit monter 8c
defcendre à la volonté de l’éclufier, dont les manoeuvres etoient
facilitées par un petit pont F G , compofe d’une greffe p anche
pofée de chaque côté du venteau fur des corbeaux de fer. Il pouvoir
d’ailleurs, en casd’étourdilTement, fe retenir a une corde c d
tendue le long du fommet de la porte ; delà il defcendoit com-
modément à la hauteur des autres crics H , a 1 aide d une. echelle
I K attachée aux.entretoifes L 8c M , parce que fe retenant d une
main, il tournoie de l’autre la manivelle, levoit ou bailloit le
ventail, fans rien craindre du mouvement fubit de la porte tournante
, laquelle reftoit ouverte 8c en repos, quand l’eau de la retenue
étoit évacuée. Il pouvoir encore, moyennant une-autre
échelle N O placée au-defliis de l’arbre tournant, defeendre lut
le fommet de la partie P Q de la porte dirigée vers le rivage, le
rendre proche du même cric , 8c lever le ventail B , apres.avoir
baille l’autre A , pour que la m er, dans le tems du reflux, contribuât
à refermer cette porte, dès-que le canal fe trouvoit iufli-
famment rempli, ainfi alternativement ; ce qui étoit encore facilité
par les cabeftans 8c cables amarrésaux arganeaux R , dont
on fe fervoit félon la néceflité.
475. Pour que ces portes étant ouvertes fe maintinrent dans la
dire&ion oh l’on vouloit qu’elles reftaflfent, 8c fe loutinflènt contre
la violence de l’eau quelles laiflbient échapper, qui auroit pu
d’abord les forcer de faire plus d’un quart de eon verfion, chacune
de fon côté étoit retenue par une chaîne S T S , liée à des- anneaux
S fortement attachés-aux entretoifes M K-, V X . D ’autre
part on n’avo-it rien négligé de ce qui pouvoir en affûter la folio
t é , auffi-bien que celle de leurs venteaux, couronnés par un
chaperon a b de 46 pieds de longueur, faifant levier en contrepoids,
chargé à fon extrémité d’un gros canon de fer pour fourn
ir le collier, indépendamment des roulettes-,, de l’énorme pe-
fanteur des venteaux, dont le chaffis étoit foutenu par des doubles
écharpes de fer x y ( 396) liées aux chaperons ( que nous
ayons été obligés de tronquer ic i, faute de place pour les exprimer.
Suite de"la'
meme deferip-
tion3 eu égard
à La-maniere-
de borner le
mouvement
des portes
tournantes.
P l a n c .