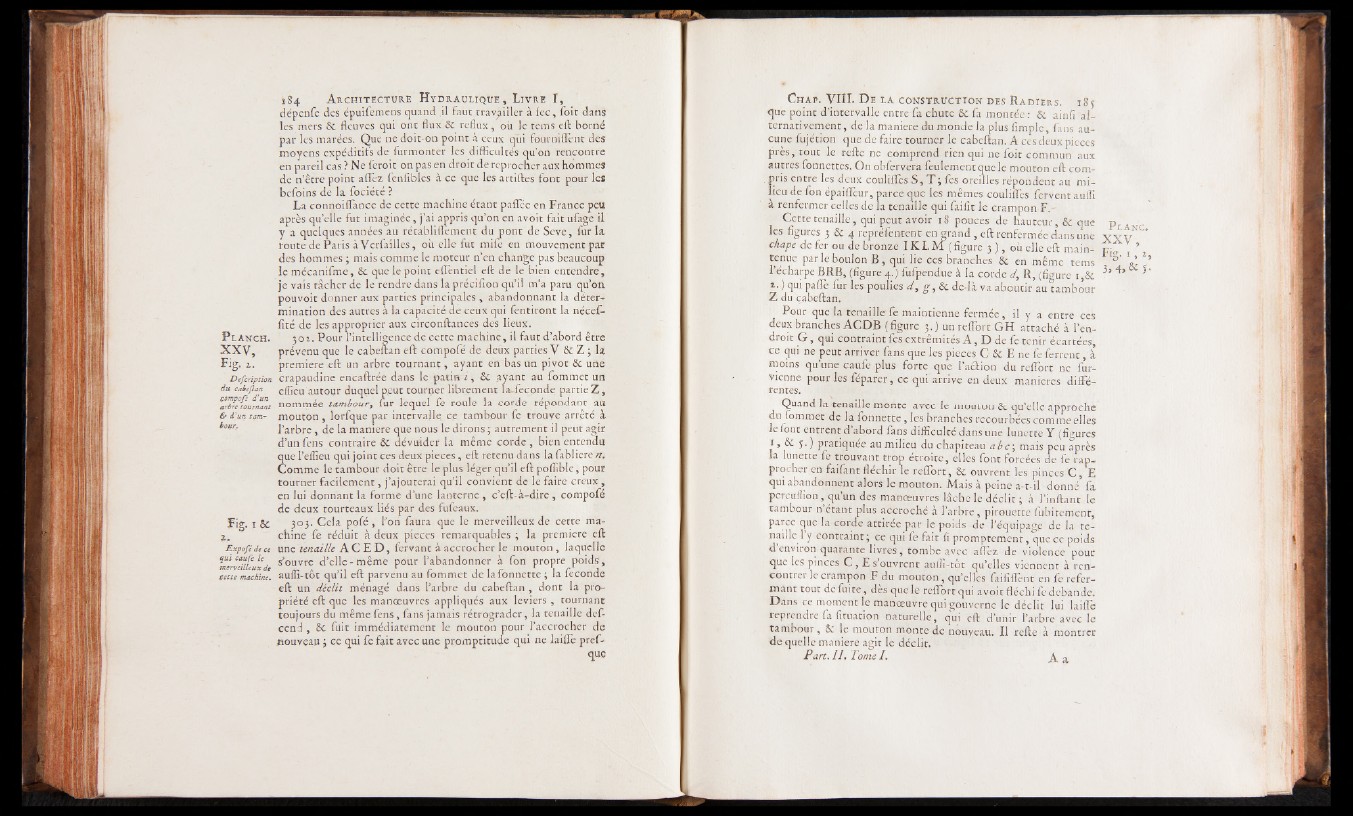
P l a n c h .
X X V ,
Fig, i.
Defcription
du cabeftan
compofé d’un
arbre tournant
& d ’un tambour*
Fig. i Sc
2.Expofè de ce
qui caufe le
merveilleux de
cette machine.
184 A rchitecture Hydraulique, Livre I ,
dépenfe des épuifemens quand il faut travailler à lec, foit dans
les mers Sc fleuves qui ont flux Sc reflux, où le te ms eft borné
par les marées. Que ne doit-on point à ceux qui fourniffènt des
moyens expéditifs de furmonter les difficultés qu’on rencontre
en pareil cas? Ne ferait on pas en droit de reprocher aux hommes
de n’être point allez fenfibles à ce que les artiftes font pour les
bcfoins de la fociété ?
La connoiflance de cette machine étant paffée en France peu
après qu’elle fut imaginée, j’ai appris qu’on en avoir faitufage il
y a quelques années au rétabliflement du pont de Seve, fur la
route de Paris à Verfailles, où elle fut mifè en mouvement par
des hommes 3 mais comme le moteur n’en change pas beaucoup
le mécanifme, Sc que le point effentiel eft de le bien entendre,
je vais tâcher de le rendre dans la précifion qu’il m’a paru qu’on
pouvoir donner aux parties principales , abandonnant la détermination
des autres à la capacité de ceux qui fendront la nécef-
fité de les approprier aux circonftances des lieux.
301. Pour l’intelligence de cette machine, il faut d’abord être
prévenu que le cabeftan eft compofé de deux parties V Sc Z ; la
première eft un arbre tournant, ayant en bas un pivot Sc une
crapaudine encadrée dans le patin i , 8c ayant au fommet un
effieu autour duquel peut tourner librement laJeconde partie Z ,
nommée tam b o u r , fur lequel fe roule la corde répondant au
mouton, lorfque par intervalle, ce tambour fe trouve arrêté à
l ’arbre , de la maniéré que nous le dirons ; autrement il peut agir
d’un fens contraire Sc dévuider la même corde , bien entendu
que l’elfieu qui joint ces deux pièces, eft retenu dans la fabliere rt.
Comme le tambour doit être le plus léger qu’il eft poflîble, pour
tourner facilement, j’ajouterai qu’il convient de le faire creux ,
en lui donnant la forme d’une lanterne , c ’eft-à-dire, compofé
de deux tourteaux liés par des fufeaux.
303. Cela pofé, bon faura que le merveilleux de cette machine
fe réduit à deux pièces remarquables ; la première eft
une t en a ille A C E D , fervant à accrocher le mouton , laquelle
s’ouvre d’elle-même pour l’abandonner à fon propre poids,
auffi-tôt qu’il eft parvenu au fommet de lafonnette ; la fécondé
eft un d é c lit ménagé dans l’arbre du cabeftan, dont la propriété
eft que les manoeuvres appliqués aux leviers , tournant
toujours du même fens, fans jamais rétrograder, la tenaille def-
cend , Sc fuit immédiatement le mouton pour l’accrocher de
nouveau ; ce qui fe fait avec une promptitude qui ne laiflè prefquc
Chap. V III. D e la construction des Radiers. 185
que point d’intervalle entre-fa chute Sc fa montée: Sc ainfi alternativement,
de la maniéré du monde la plus Ample, fans aucune
fujétion que de faire tourner le cabeftan. A ces deux pièces
près, tout le refte ne comprend rien qui ne foit commun aux
autres fonnettes. On obfervera feulement que le mouton eft compris
encre les deux couliffès S , T ; fes oreilles répondent au milieu
de fon épaiiïèur, parce que les mêmes codifiés fervent auffi
a renfermer celles de la tenaille qui faifit le crampon F.-
Cette tenaille, qui peut avoir 18 pouces de hauteur, Sc que
les figures 3 & 4 repré-fentent en grand , eft renfermée dans une
chape de fer ou de bronze I K L M (figure 3 ) , où elle eft maintenue
par le boulon B , qui lie ces branches Sc en même tems
l ’écharpe BRB, (figure 4.) fufpendue à la corde d , R, (figure i,Sc
t.) qui paflè fur les poulies d, g , Sc de-là va aboutir au tambour
Z du cabeftan.
Pour que la tenaille' fe maintienne fermée, il y a entre ces
deux branches A CD B (figure 3.) un reffort GH attaché à l’endroit
G , qui contraint fes extrémités A , D de fe tenir écartées,
ce qui ne peut arriver fans que les pièces C St E ne fe ferrent, à
moins qu’une caufe plus forte que l’action du reflort ne fur-
vienne pour les féparer, ce qui arrive en deux maniérés différentes.
.
Quand la tenaille monte avec le mouton Sc qu’elle approche
du fommet de la bonnette, les branches recourbées comme elles
le font entrent d abord fans difficulté dans une lunecte Y (figures
1 , 3.) pratiquée au milieu du chapiteau a b c ; mais peu après
la lunette fé trouvant trop étroite, elles font forcées de fe rapprocher
en faifant fléchir le reffort, Sc ouvrent les pinces C , E
qui abandonnent alors le mouton. Mais à peine a-t-il donné fa
percuffion, qu’un des manoeuvres lâche le déclit ; à l’inftant le
tambour n étant plus accroché à l’arbre, pirouette fubitemenr,
parce que la corde attirée par le poids de l’équipage de la tenaille
1 y contraint ; ce qui fe fait fi promptement, que ce poids
d’environ quarante livres, tombe avec a fiez de violence pour
que les pinces C , E s ouvrent auffi-tôt qu’elles viennent à rencontrer
le crampon F du mouton, qu’elles faififfènt en fe refermant
tout de fuite, dès que le reflort qui avoit fléchi fe débandé.
Dans ce moment le manoeuvre qui gouverne le déclit lui laiflè
reprendre fa ftruation naturelle, qui eft d’unir l’arbre avec le
tambour, Sc le mouton monte de nouveau. Il refte à montrer
de quelle maniéré agit le déclit.
P a n . I J . Tome I . yy a
P l a n c . xxv,
Fig. 1 , a,
3, 4 , S c 5 .