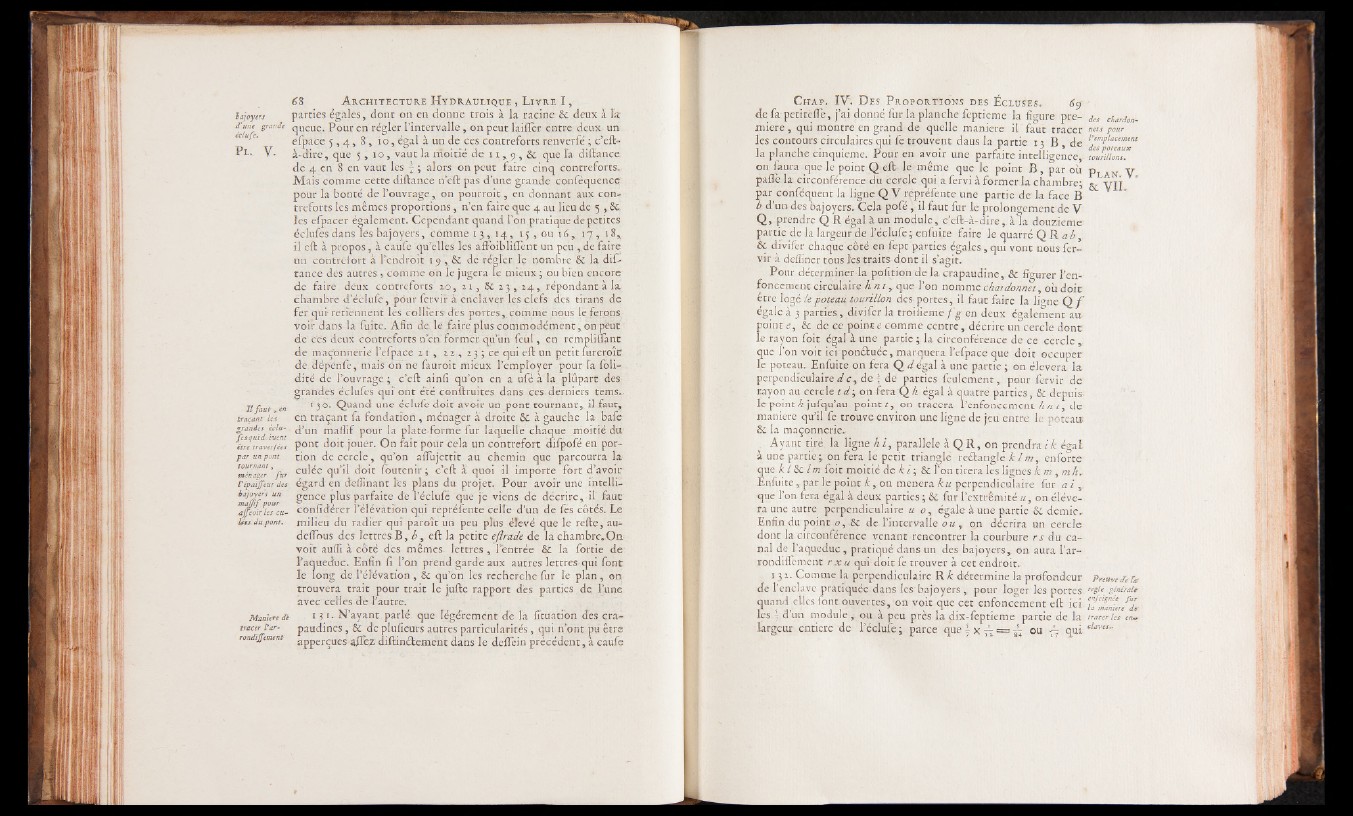
bajoyers
d'une grande
éclufe..
P u V.
- I l fau t f en
traçant les
grandes éplu-
jfesqui doivent
être traverfées
par un pont,
tournant ,
ménager pur
l'épaijpeur des
bajoyers un
majjif pour
ajfeoïr les cubées
du. pont.
Maniéré dè
tracer l3ar-
rondijfement
6 8 A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i t r e I ,
parties égales, dont on en donne trois à la racine 6c deux à Ta
queue. Pour en régler l’intervalle, on peut laiiler entre deux un
efpace 5 , 4 , 8, io , égal à un de ces contreforts renverfé ; c’eft-
à-dire, que 5 , I o , vaut la moitié de 1 1 , 9 , 6c que Ta diftance
de 4 en 8 en vaut les - ; alors on peut faire cinq contreforts.
Mais comme cette diftance n’ëft pas d’une grande conféquence
pour la bonté de l’ouvrage , on pourrait, en donnant aux contreforts
les mêmes proportions, n’en faire que 4 au lieu de 5 , 8c
les efpacer également. Cependant quand l’on pratique de petites
éclufes dans les bajoyers, comme 13 y 1 4 , i.j , ou 16,, 1 7 , 18,
il eft à propos, à caufe qu elles les affoibliflent un peu ,,de faire
un contrefort à l’endroit 1 9 , 5c de régler le nombre 6c la diftance
des autres j comme on le jugera le mieux ; ou bien encore
de faire deux contreforts 19 , 1 1 ,6 c 13 , 1 4 , répondant à la
chambre d’éclufe, pour fervir à enclaver-lès clefs des tirans de
fer qui retiennent les colliers des portes, comme nous le.ferons
voir dans la fuite.. Afin de. le faire plus commodément, on peut
de'Ces deux contreforts n’en former qu’un feul, en rempliflant
de maç'onnerie Tèfpace 1 1 , 1 1 , 13 ; ce qui eft un petit furcroît
dé. dépende, mais On ne fauroit mieux l’employer pour Ta foli-
dité de l’ouvrage. ; c’eft ainfi qu’on en a ufé à la' plupart des
grandes éclufes qui ont été conffiruites dans ces derniers teins..
f 30. Quand une éclufe doit avoir un pont tournant, il faut,
en traçant fa fondation , ménager à droite 6c à gauche la bafe
d’un maiîif pour la plate-forme fur laquelle chaque moitié du
pont doit jouer. On fait pour cela un contrefort difpofé en portion
de cercle, qu’on aflujettit au chemin que parcourra la
culée qu’il doit foutenir ; c’èft à quoi 11 importe fort d’avoir
égard en deffinant les plans du projet. Pour avoir une intelligence
plus parfaite de l’éclufë que je viens de décrire, il faut
confidérer ^élévation qui rëpréfente celle d’un de fes côtés. Le
milieu du radier qui paraît un peu plus élevé que le refte, au-
delïous des lettres B , b , eft la petite eflra d e de la chambre..On
voit aulfi à côté dès mêmes lettres , l’ëntrée 6c la fortie de
l’aqueduc. Enfin fi l’on prend garde aux autres lettres qui font
le long de l’élévation , 6c qu’on les recherche fur lé plan, on
trouvera trait pour trait le jufte rapport des parties de, l’une
avec celles de l’autre.
1 3 1 . N’ayant parlé que légèrement de la fituation des çra-
paudines, 6c de plufieurs autres particularités, qui n’ont pu être
apperçues aftèz diftinélement dans le deflein précédent, a caufe
Chap. IV. D e s P r o p o r t io n s d e s É c l u s e s . 6g
de fa petitéfle, j’ai donné fur la planche feptieme la figure première
, qui montre en grand de quelle maniéré il faut tracer
les contours circulaires qui fe trouvent daus la partie 13 B , de
la planche cinquième. Pour en avoir une parfaite intelligence,
on faura que le point Q eft le même que le point B , par où
paflè la circonférence du cercle qui a fervi à former la chambre;
par conféquent la ligne Q V repréfente une partie de la face B
b d’un des bajoyers. Cela pofé, il faut fur le prolongement de V
Q , prendre Q R égal à un module, c’eft-à-dire ,.à la douzième
partie de la largeur de l’éclufe ; enfuite faire le quarré Q R a i ,
6c divifer chaque côté en fept parties égales, qui vont nous fer-
vir à deffiner tous les traits-dont il s’agit.
Pour déterminer la pofition de la crapaudine,.6c figurer l’enfoncement
circulaire À « r,. que l ’on nomme chat d o n n e t , où doit
être logé le poteau, to u r illo n des- portes-; il faut faire la ligne Q f
égale à 3 parties, divifer la troifieme f g en deux également au-
point e , 6c de ce pointe comme centre, décrire un cercle dont
le rayon foit égal à une partie ; la circonférence de ce cercle ,,
que l’on voit ici ponétuée, marquera l’efpace que doit occuper
le poteau. Enfuite on fera Q d égal à une partie ; on élevera la
perpendiculaire d c , de de parties feulement, pour fervir de
rayon au cercle t d-, on fera Q h égal à quatre parties, 6c depuis:
le pointA jufqu’au po in t!, on tracera l’enfoncement h n t , de
maniéré qu’il fe trouve environ une ligne de jeu entre le poteau;
6c la maçonnerie.
. Ayant tiré, la ligne h i , parallèle a Q R , on prendra i k égal,
à une partie; on fera le petit triangle reétangle k l m , . enforte
que k 16c Im foit moitié de A 2 ; 6c Ton tirera les lignes k m , m h ,
Enfuite ,, par le point k ,o n mènera k u perpendiculaire fur a i ,
que Ton fera égal à deux parties ; 6C fur l’extrémité u , on éléve-
ra une autre perpendiculaire u o , égale aune partie 6C demie.
Enfin du point 0, 8c de l’intervalle 0 u , on décrira un cercle
dont la circonférence venant rencontrer la courbure r s du canal
de l’aqueduc , pratiqué dans un des bajoyers, on aura l’ar-
rondiffement r x u qui doit lé trouver à cet endroit.
131 . Comme la perpendiculaire R k détermine la profondeur
de T enclave pratiquée dans les’bajoyers , pour loger les portes,
quand elles font ouvertes, on voit que cet enfoncement eft ici
les \ d’ un moduleou à peu près la dix-feptieme partie de la
largeur entière de l’éclufe; parce que \ x — = £ ou ~ qui
des chardon-
nets pour
l3emplacement
des poteaux
tourillons.
P l a n . V.
6c V IL
Preuve de ta
réglé générale
enfeignée fu r
la maniéré de
tracer les en~
claves