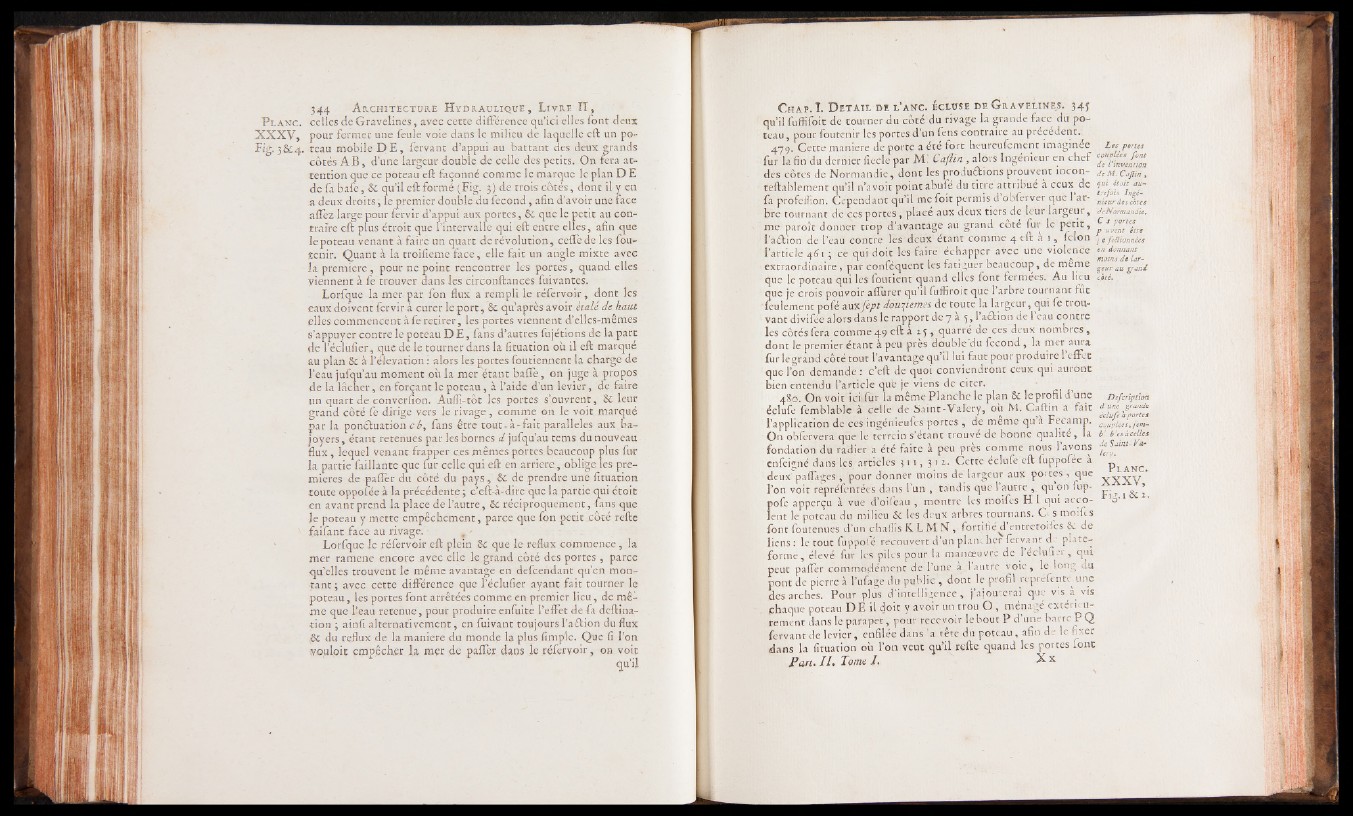
344 A rchitecture H yd raul iq u e , L iv r e I ï ,
P l a n c . celles de Gravelines, avec cette différence qn’ici elles font deux
X X X V , pour fermer une feule voie dans le milieu de laquelle eft un po-
Fig. 3SC4. teau mobile D E , fervant d’appui au battant des deux grands
côtés A B , d’une largeur double de celle des petits. On fera attention
que ce poteau eft façonné comme le marque le plan D E
de fa baie, Sc qu’il eft formé (Fig. 3) de trois côtés, dont il y en
a deux droits, le premier double du fécond, afin d’avoir une race
allez large pour fervir d’appui aux portes, 8c que le petit au contraire
eft plus étroit que l’intervalle qui eft entre elles, afin que
le poteau venant à faire un quart de révolution, ceffede les foute
ni r. Quant à la troifieme face, elle fait un angle mixte avec
la première, pour ne point rencontrer Les portes, quand elles
viennent à fe trouver dans les circonftances fuivantes.
Lorfque la mer- par fon flux a rempli le réfervoir, dont les
eaux doivent fervir à curer le port, 8c qu’après avoir étalé d e haut
elles commencent à fe retirer, les portes viennent d’elles-memes
s’appuyer contre le poteau D E , fans d’autres fujétions de la part
de l’éclufier, que de le tourner dans la fituation où il eft marqué
au plan 8c à l’élévation : alors les portes foutiennent la charge de
l’eau jufqu’au moment où la mer étant balle, on juge à propos
de la lâcher, en forçant le poteau, à l’aide d’un levier, de faire
lin quart de converfion. Auffi-tôt les portes s’ouvrent, êc leur
grand côté fe dirige vers le rivage , comme on le voit marqué
par la ponéluation c b , fans être tout-à-fait parallèles aux ba-
joyers, étant retenues par les bornes d jufqu’au tems du nouveau
flux , lequel venant frapper ces mêmes portes beaucoup plus fur
la partie faillante que fur celle qui eft en arriéré , oblige les premières
de palier du côté du pays , 8c de prendre une fituation
toute oppofée à la précédente ; c’eft-à-dire que la partie qui étoit
en avant prend la place de l’autre, 5c réciproquement, fans que
le poteau y mette empêchement, parce que fon petit côté refte
' faifant face au rivage,
Lorfque le réfervoir eft plein 8c que le reflux commence, la
mer ramene encore avec elle le grand côté des portes , parce
qu'elles trouvent le même avantage en defeendant qu’en montant
; avec cette différence que l’éclufier ayant fait tourner le
poteau, les portes font arrêtées comme en premier lieu, de même
que l’eau retenue, pour produire enfuite l’effet de fa deftina-
tion ; ainfi alternativement, en fuivant toujours l’aftion du flux
,8c du reflux de la maniéré du monde la plus (impie. Que fi l ’on
vouloir empêcher la mer de paflèr dans le réfervoir, on voit
pliSMl
• brl
C hap. T. D e t a i l d e l ’a n c . é c l u s e d e G r a v e l in e s . 345
qu’il fuffifoit de tourner du côté du rivage la grande face du poteau,
pour foutenir les portes d’un fens contraire au precedent.^
479. Cette maniéré de porte a été fort heureufement imaginée
fur la fin du dernier fiecle par Mi C a f t in , alors Ingénieur en chef
des côtes de Normandie, dont les produ£Lions prouvent incon-
teftablement qu’il n’avoit point abufe du titre attribue a ceux de
fa profeffion. Cependant qu’il me foit permis d obferver que 1 arbre
tournant de ces portes , placé aux deux tiers^de leur largeur,
me paroît donner trop d’avantage au grand cote fur le petit,
l ’a&ion de l’eau contre les deux étant comme 4 eft à 1 , félon
l ’article 4 6 1 ; ce qui doit les faire échapper avec une violence
extraordinaire, par conféquent les fatiguer beaucoup, de meme
que le poteau qui les foutient quand elles font fermées. Au lieu
que je crois pouvoir aflùrer qu il fuffiroit que 1 arbre tournant fut
•feulement pofé aux fe p t douzièmes de toute la largeur, qui fe trouvant
divifée alors dans le rapport de 7 à 5, l’a&ion de l’eau contre
les côtés fera comme49 a ^5 » quarre de ces deux nombres,
dont le premier étant à peu près double du fécond , la mer aura
fur le grand côté tout l’avantage qu’il lui faut pour produire 1 effet
que l’on demande : c’eft de quoi conviendront ceux qui auront
bien entendu l’article que je viens de citer. ■ > '
480. On voit ici-fur la même Planche le plan 8c le profil d’une
éclufe femblable à celle de Saint-Valéry, ou M. Caftin a fait
l’application de ces ingénieufes portes , de meme qu a Fecamp.
On obfe rvera que le terroin s étant trouve de bonne qualité, la
fondation du radiera été faite à peu près comme nous l’avons
cnfeiçné dans les articles 31 1 , 3 1 lm Cette éclufe eft fuppofee a
deux pa {piges 9 pour donner moins de largeur aux poites > que
l’on voit re.préfentécs dans l’un , tandis que 1 autre ,. qu on fup-
pofe apperçu à vue d’oifeau , montre les moifes H l qui accolent
le poteau du milieu ôc les deux arbres tournans. O s moifes
font foutenues d’un challis K LM N, fortifie^.entretoifes ôe de
liens : le tout fuppofé recouvert d’un plancher fervant de plateforme,
élevé fur les piles pour la manoeuvre de l’éclufier, qui
peut pafler commodément de l’une a. 1 autre voie, le long du
pont de pierre à l’ufage du public , dont le profil repréfentc^ une
des arches. Pour plus d'intelligence, j’ajourerai que vis à vis
phaque poteau D E il doit y avoir un trou O , ménagé extérieurement
dans le parapet, pour recevoir le bout P d’une barre P Q
fervant de levier, enfilée dans 'a tête du poteau, afin de le fixer
dans la fituation où l’on veut qu’il refte quand les portes font
Part, 11% Tonie /. X x
L e s portes
conviées font
de L'invention
de M. Caflin ,
qui étoit au-
trefois Ingc-
nieur des côtés
de Normandie,
C s portes
p uvent être
/ e fusionnées
eh donnant
moins de largeur
au grand
côté.
Defcription
d'une. grande
éclufe a portes
cùuplees, fem-
b ’. b'es à celles
de Saint-Valéry.
P l a n c .
X X X V ,
Fig. i 8c 2.