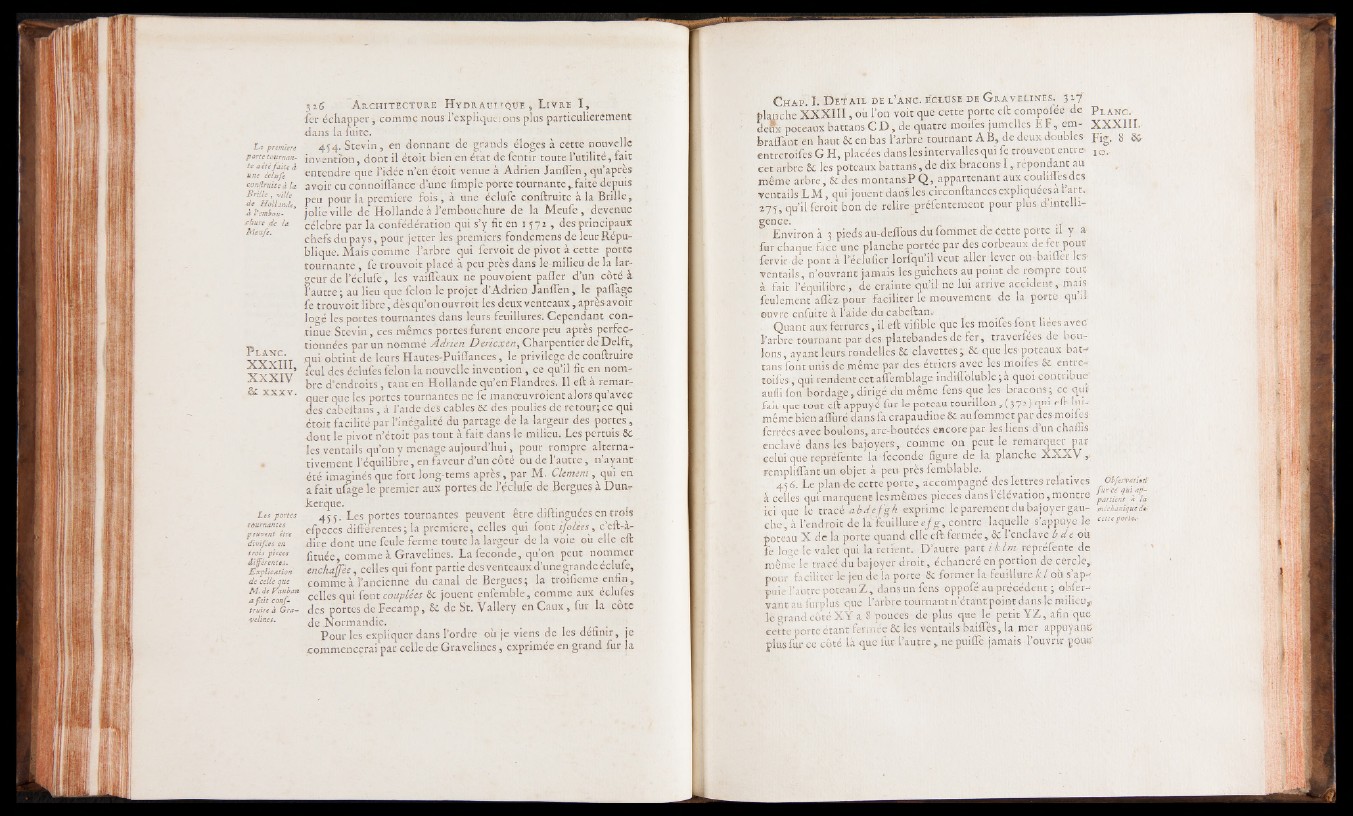
La première
porte tournante
a été faite à
une éclufe
c.onflruite à la
Brille , ville
■ de Hollande3
a Lsembouchure
de la
Mfiufe.
P l a n c .
X X X III,
X X X IV
fi£ XXXV.
Les portes
tournantes
peuvent être
divifées en
trois pièces
différentes.
Explication
4e celle que
M. de Vauban
A fait construire
à G ïa -
yeline$.
3 2 6 A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L iv r e I ,
fer échapper, comme nous l’expliquerons plus particulièrement
dans la fuite.
454. Stevin, en donnant de grands éloges à cette nouvelle
invention, dont il étoit bien en état de fentir toute l’utilité, fait
entendre que l’idée n’en étoit venue à Adrien Janlïèn, qu’apres
avoir eu connoillànce d’une'fimple porte tournante v faite depuis
peu pour la première fo is, à une éclufe conftruite à la Brille,
jolie ville de Hollande à l’embouchure de la Meufe , devenue
célébré par la confédération qui s’y fit en 1 572 , des principaux
chefs du pays, pour jetter les premiers fondemens de leur République.
Mais comme l’arbre qui fervoit de pivot à cette porte
tournante , fe trouvoit placé à peu près dans le milieu de la largeur
de l’éclufe, les vailfeaux ne pouvoient palier d’un côté à
l’autre; au lieu que félon le projet d’Adrien Janffen, le paffage
fe trouvoit libre, dès qu’on ouvroit les deux venteaux, après-avoir
logé les portes tournantes dans leurs feuillures. Cependant continue
Stevin, ces mêmes portes furent encore peu après perfectionnées
par un nommé A d r ie n JD e n e x e n , Charpentier de Delft,
qui obtint de leurs Hautes-Puiffances, le privilège de conftruire
feul des éclufes félon la nouvelle invention , ce qu’il fit en nombre
d’endroits , tant en Hollande qu’en Flandres. Il eft à remarquer
que les portes tournantes ne fe manoeuvroiént alors qu’avec
des cabeftans , à l’aide des cables 8C des poulies de retour; ce qui
étoit facilité par l’inégalité du partage de la largeur des portes,
dont le pivot n’étoit pas tout à fait dans le milieu. Les permis 6C
les ventails qu’on y ménagé aujourd’hui, pour rompre alternativement
l’équilibre, en faveur d’un côté ou de l’autre , n’ayant
été imaginés que fort long-tems après , par M. C lou en t , qui en
à fait ufage le premier aux portes de l’éclufe de Berguesà Dunr
kerque. ' ' - y ’ • ’
453. Les portes tournantes peuvent être diftinguées en trois
efpeces différentes ; la première, celles qui font i jo lc e s , c’eft-à-
dire dont une feule ferme toute la largeur de la voie où elle eft
fituée comme à Gravelines. La fécondé, qu’on peut nommer
e n c h a jfé e , celles qui font partie des venteaux d’une grande éclufe,
comme à l’ancienne du canal de Bergues; la troifieme enfin,
celles qui font couplées fie jouent enfemble, comme aux éclufes
des portes de Fecamp, 8e de St. Vallery enCaux, fur la côte
de Normandie. '
Pour les expliquer dans l’ordre où je viens de les définir, je
commencerai par celle de Gravelines, exprimée en grand fur Ja
C h a f . I . D é t a i l d e l ’ a n c . e'c lu s e d e G r à v e I in e s .^ 3 2 ?
planche X X X I I I , où l’on voit que cette porte eft compofée de
deux poteaux battans C D , de quatre moifes jumelles E F , em-
braffant en haut 8e en bas l’arbre tournant A B , de deux doubles
entretoifes G H, placées dans les intervalles qui fe trouvent entre-
cet arbre fie lés poteaux battans, de dix braconsl,.répondant au
même arbre, 6c des montansP Q , appartenant aux coulilïesdes
ventails LM , qui jouent dans les circonftancesexpliquéesial’art.
275, qu’il feroit bon de relire préfentement pour plus d’mtelli-
gence. .y
Environ à 3 pieds au-deffous du fommet de cette porte il -y a
fur chaque face une planche portée par des corbeaux de fer pour
fervir-de pont àTéclufier lorfqu’il veut allerlever ou-baiffer les-
ventails , n’ouvrant jamais les guichets au point de rompre tout
à fait l’équilibre, de crainte qu’il ne lui arrive accident-, mais
feulement affez pour faciliter le mouvement de la porte qu’il
ouvre enfuite à l’aide du cabeftan.
Quant aux ferrures, il eft vifible que les moifes-font liées avec
l’arbre tournant par des platebandes de fer, traverfées de boulons,
P lAnc.-
X X X III.
Fig. 8 86-
10-
ayant leurs-rondelles fie clavettes; fie que les-poteaux battans
font unis de même par des étriers- avec les moifes fie entretoifes
, qui rendent cet affemblage indiffôluble ; à quoi contribue;
auflifon bordage, dirigé du même fens que les bracons; ce qui
fait que tout eft appuyé fur le poteau tourillon ,£ 3 7 1! qui eft lui-
même bien affuré dansfa crapaudine fie au fommet par des-moifeS
ferrées avec boulons, arc-boutees encore pat les liens d un chafîis
enclavé dans-les- bajoyers, comme on peut le îemarquer par
celui que repréfente la fécondé figure de la planche X X X V ,■
rempliffant un objet à- peu- près iemblable.
456. Le plan-de cette porte, accompagné deslettres-relatives
à celles qui marquent-lesmêmes pieces-dansl élévation,montre
ici que le tracé a b d e f 'g h exprime le parement du bajoyer gauche,
à l’endroit de la feuillure e f g , contre laquelle S’appüye le
poteau X de la porte quand elle e"ft-fermée, Sfi l’enclave b d e où
fe lo<ie le valet qui la retient. D ’autre part i k l u i repréfente de
même le tracé du bajoyer droit, échancré en portion de cercle,
pour faciliter le jeu de la porte 8c former la feuillure k l où s’appuie
l’autre poteau Z , dans un fens oppofé au précédent ; observant
au furplus que l’arbre tournant n’étant point dans le milieu,
le grand côté X Y a 8'pouces de plus que le petit Y Z , afin que
cette porte étant fermée Se les Ventails baiffés, la mer appuyant
plus fur ce côté là que fur l’autre , ne puiffe jamais l’ouvrir goût
Ôbfefvaiieti'
fu r ce: qui appartient
a la
mêchanique d *
cette porte*-