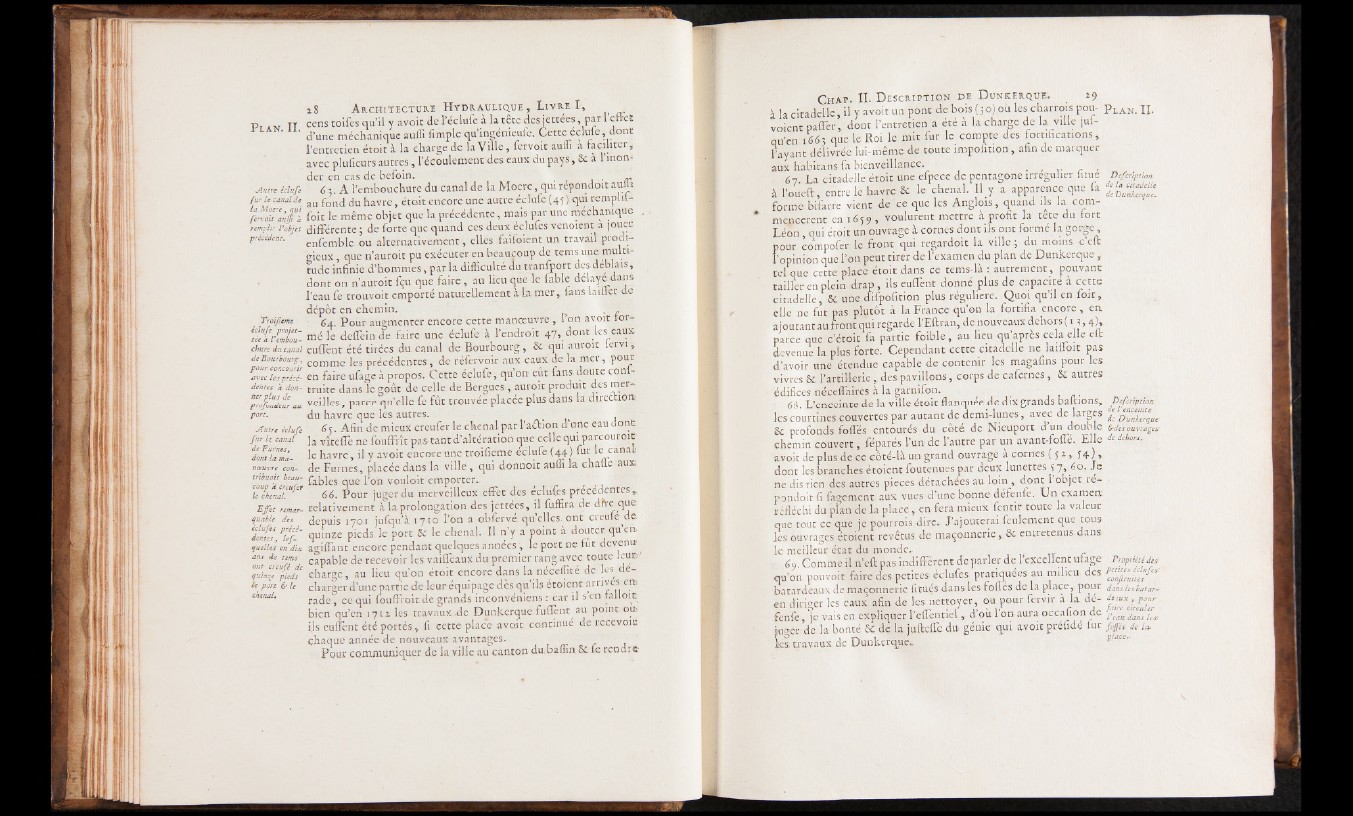
18 A rchitecture Hydraulique, L ivre I ,
p . .. . TT cens toifes qu’il y a v o it de l’éclufe à la tête des jettées, pari’effes
d’une méchaniquc auffi fimple qu’invémeufe. Cette eclule, dont
l’entretien étoit à la charge de la V ille , fervoit auffi à faciliter,
avec plufieurs autres, l’écoulement des. eaux du pays, & à l’inonder
en cas de befoin. ^
Autre éclufe 6 3. A l’embouchure du canal de la Moere , qui repondoit aullî
fur le-canal de au fonc[ cju havre, étoit encore une autre éclufe (45-) qui remplit^
M i foit le même objet que la précédente 5 mais par une méchanique
remplir l'objet différente ; de forte que quand ces deux éclufes venoient a jouée
précédent. cnfemble ou alternativement, elles faifoient un travail prodigieux
, que n’auroit pu exécuter en beaucoup de tems une multitude
infinie d’hommes, par la difficulté du tranfport des.deblais,
dont on n’auroit feu que faire, au lieu cjue le fable délaye dans
l ’eau fe trouvoit emporté naturellement a la. mer,. fans lailler de
dépôt en chemin. n - r
Troîjleme ■ g . Pour augmenter encore cette manoeuvre, l’on avoit ror-
3— T. mêle deflèinde faire une éclufe à l’endroit 47, dont les eaux
chure du canal euflent été tirées du. canal de Bourbourg, 8c qui auroit ervi ^
deBourbourg, comme les précédentes, de réfervoir aux eaux de la mer, .pour
ïlZ ïT p r Z é - en faire ufage à propos. Cette éclufe, qu’on- eût fans doute conf-
ientes k don- tru;.te dans.le goût de celle de Bergues, auroit produit des mer-
np‘rofÔ^et au veilles., parce quelle fe fût trouvée placée plus dans la direttiom
port. du havre que Les autres. - .
Autre éclufe 65. Afin.de mieux creufer le chenal-parl’a&ion d’une eau dont
fu r le canal \-c i vîreffè ne fouffrit pas tant d’altération que celle qui parcouroit
d on tUm ’a- » havre I il y avoit encore une troifieme éclufe
nceuvre con- de Fûmes., placée dans la v ille, qui donnoit auili la enaue
tniuoit beau- £ jjq es que pon vouloir emporter.
C™chênal-.' 6 6 . Pour juger du merveilleux effet des éclufes précédentes,,
Effe t remar- relativement à la prolongation des jettées, il fuffira de direque.
quable des depuis 170.1 jufqu’à 17 10 l’on a obfervé. qu’elles, ont crcufe de-
quinze pieds le port & le chenal. Il n’y a point à douter qu’en.
quelles en dix agi (Tant encore pendant quelques années le port ne fut devenu ^
ds “f f s capable de recevoir les vaiffeaux du premier rang avec toute leun'
çu in -^ fied f charge, au lieu qu’on étoit encore dans la néceffité de les de-
& pon & le charger d’une partie de leuréquipage dès qu’ils étoient arrivés en.
chenal. rac|e ^ ce qUi fouffroit.de grands inconvéniens : car il s’en ralloïc
bien qu’en 17-14, les travaux.de Dunkerque fuflène au point oui
iis euffènt été portés, fi cette place avoir continue de recevoir;
chaque année de nouveaux avantages.
Pour communiquer de la ville au canton du baffin. & fe rendic
C hap. II. Description de Dunkerque. *9
'0 U citadelle, il V avoir un pont de bois (30) où les charrois pou- Plan. II.
voient paffer, dont l’entretien a été à la charge de la ville juf-
qu’en 1663 que le Roi le mit fur le compte des fortifications,
layant délivrée lui-même de toute impofition, afin démarquer
aux habitans fa bienveillance. . . . . r >
6 7 . La citadelle étoit une efpece de pentagone irreguher iuue OEagMj*
à l’oueft, entre le havre Sc le- chenal. Il y a apparence que fa
forme bifarre vient de ce que les Anglois, quand ils la commencèrent
en 1659 , voulurent mettre à profit la tete du fort
Léon, qui étoit un ouvrage à cornes dont ils ont formé la gorge,
pour compofer le front qui regardoit la v ille ; du moins c’eft
l’opinion que l’on, peut tirer de l’examen du plan de Dunkerque ,
tel que cette place etoit .dans ce tems-la ; autrement, pouvant
tailler en plein drap, ils euffènt donné plus de capacité à cette
citadelle, &: une difpofition plus régulière. Quoi qu’il en foie,
elle ne fut pas plutôt à la France qu’on la fortifia encore , en
ajoutant au front qui regarde l’Eftran, de nouveaux dehors ( 13 ,4 ) ,
parce que c’étoit fa partie foible, au lieu qu’apres cela elle elt
devenue la plus forte. Cependant cette citadelle ne laifloit pas
d’avoir une étendue capable de contenir les magafins pour les
vivres 8c l’artillerie,. des pavillons, corps de eafernes, & autres
' édifices néceffaires à lagarnifon.
' 68. L ’enceinte de la ville étoit flanquée de dix grands battions, Defcriptïov
les courtines couvertes par autant de demi-lunes, avec de larges Qunktr(iuc
8c profonds foffés entourés du coté de Nieuport d’un double &des ouvrage*
chemin couvert, féparés l’un de l’autre par un avant-foffe. Llle
avoit de plus de ce côté-là un grand ouvrage a cornes ( 5 2 » 54 ) >
dont les branches étoient foutenues par deux lunettes 57, 6o. Je
ne dis rien des autres pièces détachées au loin, dont 1 objet re-
pondoit fi fagement aux vues d’une bonne defenfe. Un examen
réfléchi du plan de la place, en fera mieux fentir toute la valeur
que tout ce que je pourrois dire. J ’ajouterai feulement que tous
les. ouvrages étoient revêtus de maçonnerie,. 8c entretenus.dans
le meilleur état du monde..
- 69 Comme il n’eft pas indifférent de parler de l’excellent ufage Propriété de*
qu’on pouvoit faire des petites éclufes pratiquées-au-milieu, des
batardeaux de maçonnerie fitués dans les-foffes de la place,.pour dans les batar^
en diriger les eaux afin de les. nettoyer, ou pour fervir à la dé-
fenfe , je vais en expliquer l’effentiel, d’où 1 on aura occalion de p caudans [tsi
hio-er de la bonté Sc de la jufteffe du. génie qui avoit préfide lue foffés de U r o i i placer ' les. travaux. de Dunkerque