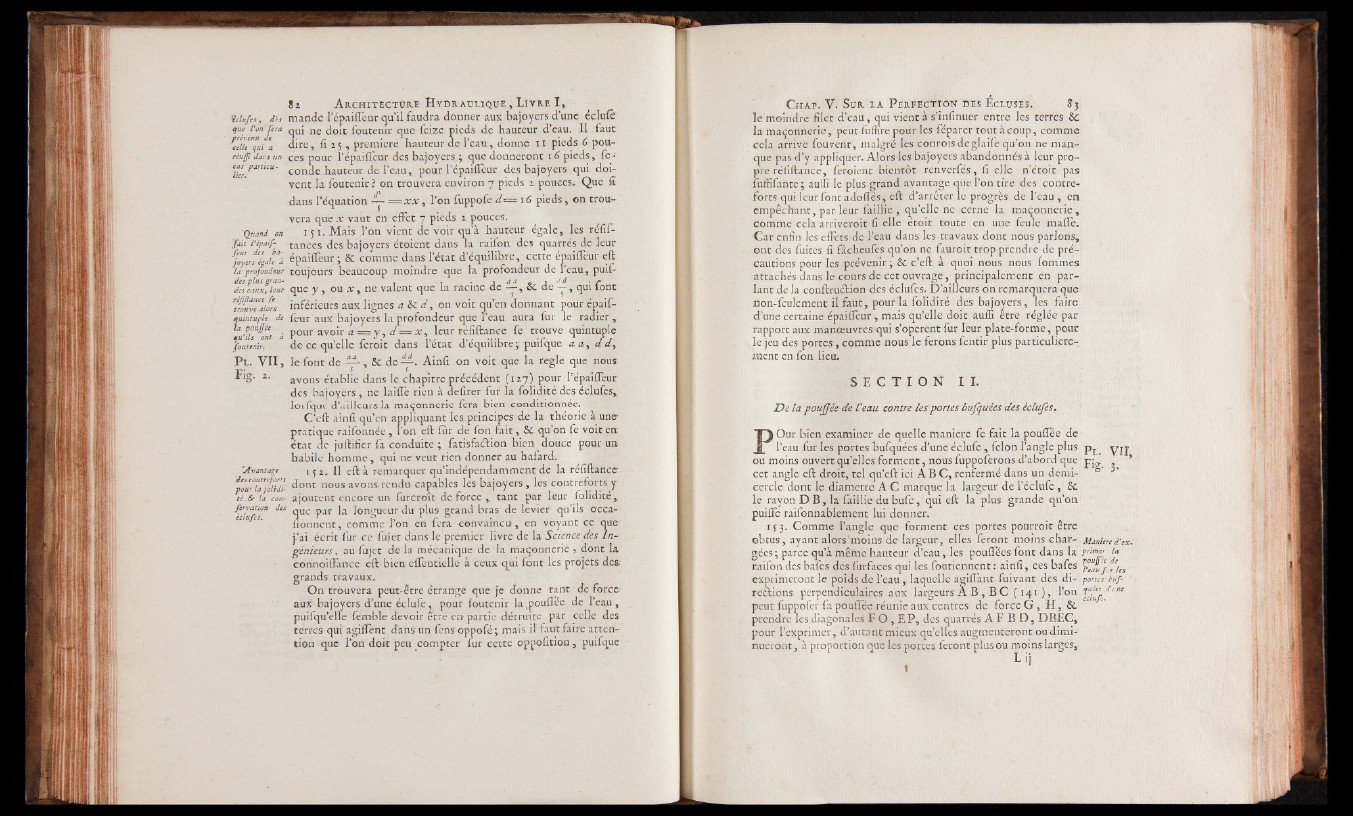
Mclufes, des
que l'on fera
prévenu de
telle qui a
réufli dans un
cas partieu-
lier..
‘Quand on
fait l'épaif-
feur des bajoyers
égale à
la profondeur
des plus grandes
eaux, leur
.féjîfiance fe
trouve alors
quintuple de
la pouffée
q u ils ont à
foutenir.
P i . V I I ,
Fig. 2*
Avantage:
des contreforts
pour la foltdi-
té. & la conservation
des
éclufes.
S i A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i v r e I ,
mande l’épaiffèur qu’il faudra donner aux bajoyers d’une éclufé
qui ne doit foutenir que feize pieds de hauteur d’eau. I l faut
dire, fi 1 5 , première hauteur de l’eau, donne 1 1 pieds 6 pouces
pour l’épaiffeur des bajoyers ; que donneront 16 pieds, fé conde
hauteur de l’eau, pour l’épaiflèur des bajoyers qui doivent
la foutenir ? on trouvera environ 7 pieds z pouces. Que £
dans l’équation = x x , l’on fuppofe if= 1 6 pieds, on trouvera
que x vaut en effet 7 pieds 1 pouces.
15 1 . Mais l’on vient de voir qu’à hauteur égale, les réfif-
tances des bajoyers étoient dans la raifon des quarrés de leur
épaiffeur ; Sc comme dans l’état d’équilibre, cette épaiffeur eft
toujours beaucoup moindre que la profondeur de l’eau, puif-
que y , ou x , ne valent que la racine de d - , 8c de -A, qui font
inférieurs aux lignes a S cd , on voit qu’en donnant pour épaiffeur
aux bajoyers la profondeur que l’eau aura fur le radier ,
pour avoir a — y , d = x , leur réfiftance fe trouve quintuple
de ce quelle feroit dans l’état d’équilibre; puifque a a , d d ,
le font d e -^ - , Sc de~— . Ainfi on voit que la réglé que nous
avons établie dans le chapitre précédent ( 1 17 ) pour l’épaifTeur
des bajoyers , ne laiffe rien à defîrer fur la folidité dés éclufes,
lorfque d’ailleurs la maçonnerie fera bien conditionnée.
C ’eft ainfi qu’en appliquant les principes de la théorie à une-
pratique raifonnée , l’on eft fur de fon fa it, Sc qu’on fe voit err,
état de juftifïer fa conduite ; fatisfaêfcion bien douce pour un
habile homme , qui ne veut rien donner au hafard.
1 5 1 . 11 eft à remarquer qu’indépendamment de la réfiftance
dont nous avons rendu capables les bajoyers, les contreforts y
ajoutent encore un furcroît de force , tant par leur folidité,
que par la longueur du plus grand bras de levier qu’ils occa-
fionnent, comme l’on en fera convaincu-, en voyant ce que-
j ’ai écrit fur ce fujet dans le premier livre de la Science dès Ingénieurs
, au fujet de la mécanique de la maçonnerie , dont la
connoiffance eft bien effentielle à ceux qui font les projets des
grands travaux.
On trouvera peut-être étrange que je donne tant dé force:
aux bajoyers d’une éclufe, pour foutenir lajjoufïèe de l’eau,
puifqu’elle femble devoir être en- partie détruite par celle des
terres qui'agiflent dans un fénsoppofé; mais il faut faire attention
que l ’on doit peu compter fur cette oppofition, puifque
C h a p . V . Sur l a P e r f e c t io n d e s É c l u s e s . 8 j
le moindre filet d’eau, qui vient à s’infinuer entre les terres 8c
la maçonnerie, peut fuffîre pour les féparer tout à coup, comme
cela arrive fouvent, malgré les conrois deglaife qu’on ne manque
pas d’y appliquer. Alors les bajoyers abandonnés à leur propre
réfiftance, feroient bientôt renverfés, fi elle n’étoit pas
fuffifante ; auffi le plus grand avantage que l’on tire des contreforts
qui leur font adoffés, eft d’arrêter le progrès de l’eau, en
empêchant, par leur faillie , qu’elle ne cerne la maçonnerie,
comme cela arriveroit fi elle étoit toute en une feule mafle.
Car enfin les effets de l’eau dans les travaux dont nous parlons,
ont des fuites fi fâcheufes qu’on ne fauroit trop prendre de précautions
pour les prévenir ; Sc c’eft à quoi nous nous fommes
attachés dans le cours de cet ouvrage, principalement en parlant
de la conftruction des éclufes. D ’ailleurs on remarquera que
non-feulement il faut, pourla folidité des bajoyers, les faire
d’une certaine épaifTeur, mais qu’elle doit auffi être réglée par
rapport aux manoeuvres qui s’opèrent fur leur plate-forme, pour
le jeu des portes, comme nous le ferons fentir plus particulièrement
en fon lieu.
S E C T I O N I I .
De la poujjée de l ’eau contre les portes bufquées des éclufes.
POur bien examiner de quelle maniéré fe fait la pouffée de
l’eau fur les portes bufquées d’une éclufe, félon l’angle plus p L y j j
ou moins ouvert qu’elles forment, nous fuppoferons d’abord que ’
cet angle eft droit, tel qu’eft ici A B C , renfermé dans un demi-
cercle dont le diamètre A C marque la largeur de l’éclufe,' 8c
le rayon D B , la faillie du bufe, qui eft la plus grande qu’on
puiffe raifonnablement lui donner.
1 y3. Comme l’angle que forment ces portes pourroit être
©btus, ayant alors moins de largeur, elles feront moins char- Manimd'cx.
gées; parce qu’à même hauteur d’eau, les pouffées font dans la Prm‘r |*j
raifon des bafes des furfaces qui les foutiennent : ainfi, ces bafes J A j ; , ; , ,
exprimeront le poids de l’eau , laquelle agiffant fuivant des di- - portes-tuf-
reétions perpendiculaires aux largeurs À B , B C ( 14 1 ), l’on f '* ' ‘ -'■*
peut fuppofer fa pouffée réunie aux centres de force G , H , &
prendre les diagonales F O , E P, des quarrés A F B D , DBEC,
pour l’exprimer, d’autant mieux qu’elles augmenteront ou diminueront
, à proportion que les portes feront plus ou moins larges,
L i j
t