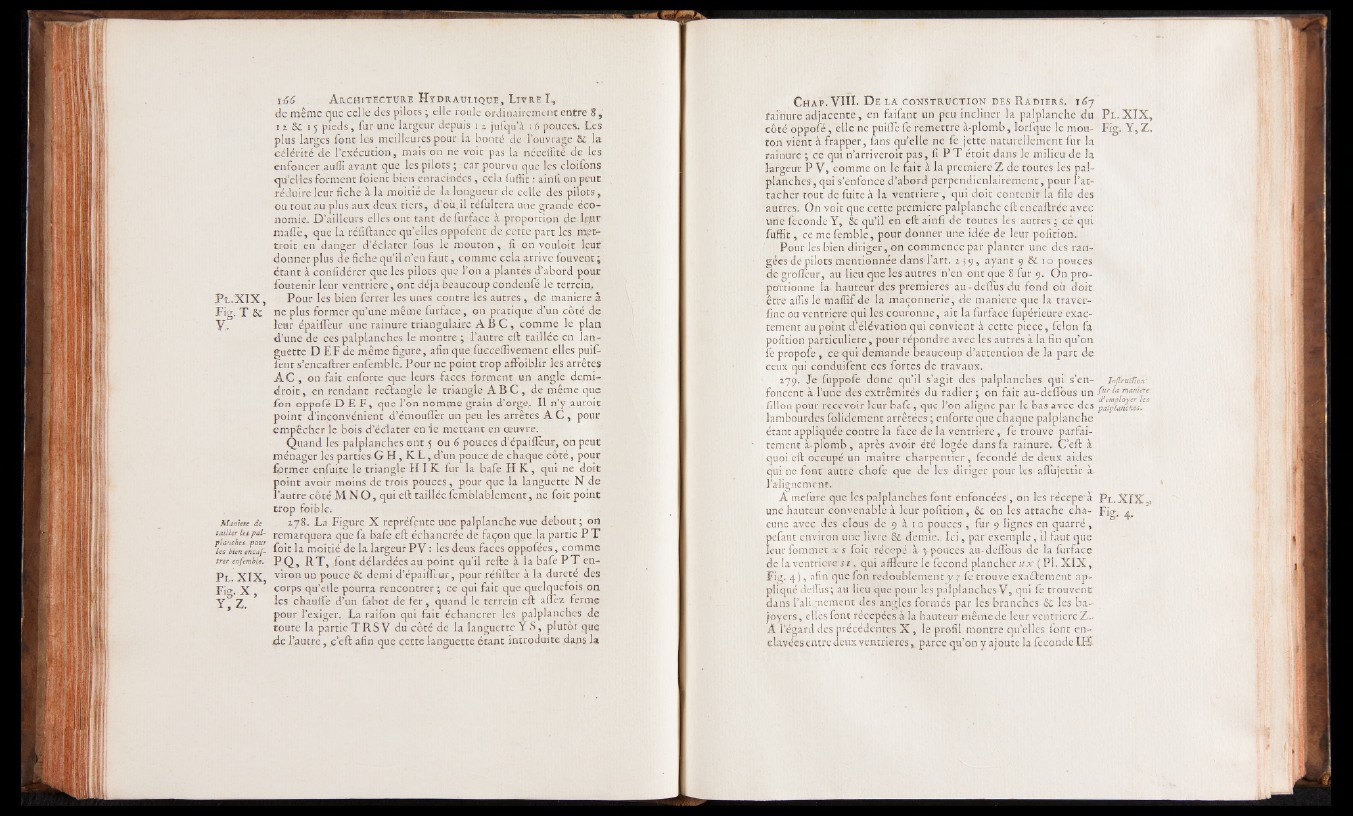
1 6 6 . A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L iv r e I ,
de même que celle des pilots ; elle roule ordinairement entre S,
1 1 Sc i 5 pieds, fur une largeur depuis i z jufqu’à i 6 pouces. Les
plus larges fondes meilleures pour la bonté de l’ouvrage 8e la
céléricé de l’exécution, mais on ne voit pas la néceffité de les
enfoncer .auffi avant que les pilots ; car pourvu que les cloifons
qu’elles forment foierit bien enracinées , cela fuffit : ainfi on pquc
réduire leur fiche à la moitié de la longueur de celle des pilots,
ou tout au plus aux deux tiers, d’où.il réfultera une grande économie..
D ’ailleurs elles ont tant de furface à proportion de four
maflè, que la réfiftance qu’elles oppofent de cette part les m,et-
troit en danger d’éclater fous le mouton , fi on vouloit leur
donner plus de fiche qu’il n’en faut, comme cela arrive fouvent ;
étant à confîdérer que les pilots que l’on a plantés d’abord pour
foutenir leur ventriere, ont déjà beaucoup condenfé le terrein.
P i .X I X , Pour les bien ferrer les unes contre les autres , d.e maniéré à
Fig. T fie ne plus former qu’une même furface, on pratique d’un côté de
Y,. leur épaiffeur une rainure triangulaire A B C , comme le plan
d’une de ces palplanches le montre ; l ’autre eft taillée en languette
D E F de même figure, afin que fueceffivement elles puif-
feut s’encaftrer enfemble, Pour ne point trop afFoiblir les arrêtes
A C , on fait enforte que leurs faces forment un angle demi-
droit, en rendant rectangle le triangle A B C , de même que
fon oppofé D E F , que l’on nomme grain d’orge. Il n’y aurofe
point d’inconvénient d’émoufler un peu les arrêtes A C , pour
empêcher le bois d’éclater en le mettant en oeuvre.
Quand les palplanches ont 5 ou 6 pouces d’épaiflfeur, on peut
ménager les parties G H , K L , d’un pouce de chaque côté, pour
former enfui.te le triangle H I K fur la bafe H K , qui ne doit
point avoir moins de trois pouces, pour que la languette N de
l ’autre côté M N O , qui eft taillée femblablement, ne fort point
trop foible.
Manitt! de 278. La Figure X repréfente une palplanche vue debout ; on
tailler Us pal- remarquera que fa bafe eft échancrée de façon que. la partie P T
ricTbUnencaf- foit la moitié de la largeur PV : les deux faces opp.ofées, comme
trer enfemble. P Q , R T , font délardées au point qu’il refte à la bafe P T en-
P l. X IX w o n un pouce 8t demi d’épaiflèur, pour .réfifter à la dureté des
Fia. X corps qu’eile pourra rencontrer; ce qui fait que quelquefois on
Y Z. les chauffe d’un fabot de fer, quand le terrein eft allez ferme
pour l’exiger. La raifon qui fait échancrer les palplanches de
toute la p a r t ieT R SV du côté de la languetteYS, plutôt que
4e l’autrg, .c’eft afin que cette languette étant introduite dans la
C hap.'VIU. D e la construction des R a d ie r s . 167
faîriure adjacente, en faifant un peu incliner la palplanche du
côté oppofé, elle ne puiflè fe remettre à-plomb, lorfque le mouton
vient à frapper, fans qu’elle ne fe jette naturellement fur la
rainure; ce qui n’arriveroitpas, fi P T é to it dans le milieu de la
largeur P V, comme on le fait à la première Z de toutes les palplanches,
qui s’enfonce d’abord perpendiculairement, pour l’at-
ta'cher tout de fuite à ja ventriere1, qui doit contenir la file des
autres. On voit que cette première palplanche eft encaftrée avec
une fécondé Y, 8c qu’il en eft ainfi de toutes les autres ; cé qui
fuffit, ce me femble, pour donner une idée de leur pofition.
Pour les bien diriger, on commence par planter une des rangées
de pilots mentionnée dans-l’art. 239, ayant 9 8c 1 o pouces
dé groflèur , au lieu que les autres n’en ont que 8 fur 9. On proportionne
la- hauteur des premières au-deliusdu fond où doit
être aflis le maffif de la maçonnerie, de maniéré que la traver-
fine ou ventriere qui les couronne, ait la furface fupérieure exactement
au point d’élévation qui convient à cette piece,'félon fà
pofition particulière, pour répondre avec les autres à la fin qu’on
fe propofe , ce qur demande beaucoup d’attention de la part de
ceux qui conduifent ces fortes de travaux.
279,;'Je fuppofe donc qu’il s’agit des palplanches qui s’enfoncent
à l’une des extrémités du radier ; on fait au-defTous un
fillon pour recevoir leur bafe, que l’on aligne par le bas avec des
lambourdes folidement arrêtées; enforte que chaque palplanche
étant appliquée contre la face de la ventriere , fe trouve parfaitement
à-plomb, après avoir été logée dans fa rainure. C ’eft à
quoi eft occupé un maître charpentier, fécondé de deux aides
qui ne font autre chofe que de les diriger pour les aflùjettir à.
l ’alignement-.
A mefure que les palplanches font enfoncées, on les récepe à
une hauteur convenable à leur pofition, 8c on les. attache chacune
avec des clous de 9 à 10 pouces-, fur 9 lignes en quarré,
pefant environ une li.vre 8c demie. I c i, par exemple, il faut que
leur fommet x s foit têcepé à- 3. pouces au-deflous de la furface
de la ventricrc s t . qui affleure le fécond plancher u x (PI. X IX ,;
Fig. 4 ) , afin que fon redoublement y ç fe trouve exactement appliqué
dclfus; au lieu que pour les palplanchcs-V, qui fe trouvent'
dans l’alignement des angles formés par les branches 8c les ba-
foyers, elles font récepées à la hauteur même de leur ventriere Z,.
A l’égard des précédentes X , le profil montre quelles font enclavées
entre deux ventrieres,. parce qu’on y ajoute la fécondé ILE
P l . X IX ,
Fig. Y , Z.
Inflrutflon'
fu r la maniéré
d’ employer les
palplanches
Pi.xrx.,,
Fig. 4.