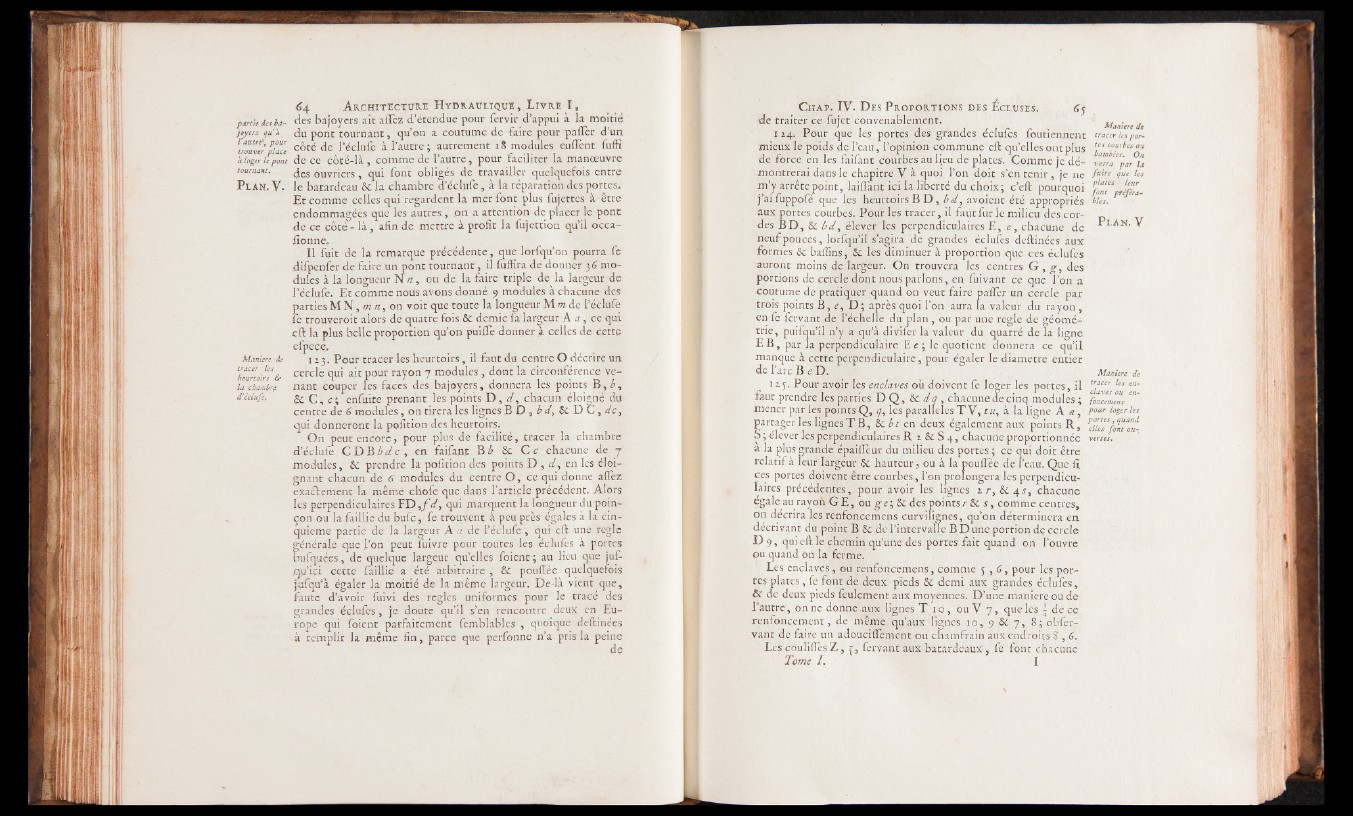
partie des la -
joyers qu'a
Vautre\ pour
trouver place
a loger le pont
tournant.
P l a n . V •
Maniéré de
tracer les
heurtoirs &
la chambrç
d’éclufe.
64 A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i v r e I ,
des bajoyers ait allez d’étendue pour fervir d’appui à la moitié
du pont tournant, qu’on a coutume de faire pour paflèr d’un
côté de l’éclufe à l’autre ; autrement 1 S modules euflènt fuffi
de ce côté-là , comme de l’autre, pour faciliter la manoeuvre
des ouvriers, qui font obligés de travailler quelquefois entre
le batardeau 6c la chambre d’éclufe, à la réparation des portes.
Et comme celles qui regardent la mer font plus fujettes à être
endommagées que les autres, on a attention de placer le pont
de ce côté - là , afin de mettre à profit la fujettion qu’il occa-
fionne.
I l fuit de la remarque précédente, que lorfqu’on pourra fe
difpenfer de faire un pont tournant, il fuffira de donner 36 modules
à la longueur N n , ou de la faire triple de la largeur de
l ’éçlufe. Et comme nous avons donné 9 modules à chacune des
parties M N , m n , on voit que toute la longueur Mm de l’éclufe
■fe trouveroit alors de quatre fois 5c demie fa largeur A a , ce qui
eft la plus belle proportion qu’on puilfe donner .à celles de cette
efpeçe,
1 z3, Pour tracer les heurtoirs, il faut du centre O décrire un
cercle qui ait pour rayon 7 modules , dont la circonférence venant
couper les faces des bajoyers, donnera les points B , b ,
& C , c ; enfuite prenant les points D , d , chacun éloigné du
centre de 6 modules, on tirera les lignes B D , b d , 6c D C , d e ,
qui donneront la pofition des heurtoirs.
On peut encore, pour plus de facilité, tracer la chambre
d ’éclufe C ’D 'Q b d c , en faifant B b 8c C e chacune de 7
modules, 6c prendre la pofition des points D , d , en les éloignant
chacun de 6 modules du centre O , ce qui donne aflèz
exactement la même chofe que dans l’article précédent. Alors
les perpendiculaires FD , f d , qui marquent la longueur du poinçon
ou la faillie du bufe, fe trouvent à peu près égales à la cinquième
partie de la largeur A a de l’éclufe , qui eft une réglé
générale que l’on peut fuivre pour toutes les éclufes à portes
bufquées, de quelque largeur qu’elles foient ; au lieu que juf-
qu’içi cette faillie a été arbitraire , 6c poulfée quelquefois
jufqu’à égaler la moitié de la même largeur. D e là vient que,
faute d’avoir fuivi des réglés uniformes pour le tracé des
grandes éclufes , je doute qu’il s’en rencontre deux en Europe
qui foient parfaitement femblables , quoique deftinées
à remplir la même fin, parce que perfonne n’a pris la peine
C h a p . IV. D e s P r o p o r t io n s d e s É c lu s e s .
de traiter ce fujet convenablement.
114 . Pour que lçs portes des grandes éclufes foutiennent
mieux le poids de l’eau, l’opinion commune eft qu’elles ont plus
de force en les fàifant courbes au lieu de plates. Comme je démontrerai
dans le chapitre V à quoi l’on doit s’en tenir, je ne
m’y arrête point, laiflànt ici la liberté du choix; c’eft pourquoi
j’aifuppofé que les heurtoirs B D , b d , avoient été appropriés
aux portes courbes. Pour les tracer, il faut fur le milieu des cordes
B D , 5c b d , élever les perpendiculaires E , e , chacune.de
neuf pouces, lorfqu’il s’agira de grandes éclufes deftinées aux
formes ôc balfins, 6c les diminuer à proportion que ces éclufes
auront moins de largeur. On trouvera les centres G , g , des
portions de cercle dont nous parlons, en fuivant ce que l’on a
coutume de pratiquer quand on veut faire paflèr un cercle par
trois points B , e , D ; après quoi l’on aura la .valeur du rayon ,
en fe fervant de l’échelle du plan, ou par une réglé de géométrie,
puifqu’il n’y a qu’à divifer la valeur du quarré de Ta ligne
E B , par la perpendiculaire E t ; le quotient donnera ce qu’il
manque à cette perpendiculaire, pour égaler le diamètre entier
de l’arc B e D.
12.5. Pour avoir les en c la v es où doivent fe loger les portes, il
faut prendre les parties D Q ,6 c d q , chacune de cinq modules ;
mener par les points Q, y, les parallèles T V , ta, à. la ligne A a ,
partager les lign e sT B , 6c b t en deux également aux points R ,
S ; élever les perpendiculaires R 1 8c S 4 , chacune proportionnée
a la plus grande epaiiïèur du milieu des portes; ce qui doit être
relatif à leur largeur 8c hauteur, ou à la poulfée de l’eau. Que lî
ces portes doivent être courbes, l’on prolongera les perpendiculaires
précédentes, pour avoir les lignes 2. r , 6c 4 s , chacune
égalé au rayon-GE, ou g e - , 8c des points/- 8c s , comme centres,
on décrira les renfoncemens curvilignes, qu’on déterminera en
décrivant du point B 8c de l’intervalle B D une portion de cercle
D 9, qui eft le chemin qu’une des portes fait quand on l ’ouvre
ou quand on la ferme.
Les enclaves, ou renfoncemens, comme 5 , 6 , pour les portes
plates, fe font de deux pieds 6C demi aux grandes éclufes,
6c de deux pieds feulement aux moyennes. D ’une maniéré ou de
l’autre, on ne donne aux lignes T 1 0 , ou V 7 , que les \ de ce.
renfoncement, de même qu’aux lignes 10 , 9 6c 7 , 8; obfer-
vanr de faire un adouciflèment ou chamfrain aux endroits-8 , 6.
Les couliflèsZ, f , fervant aux batardeaux , fe font chacune
T om e I . I
Maniéré de
tracer les portes
courbes ou
bombées. On
verra par la
fuite que les
plates leur
font préférables.
P l a n . V
Maniéré de
tracer les enclaves
ou en-
foncemens
pour loger les
portes 3 quand
elles font ouvertes.