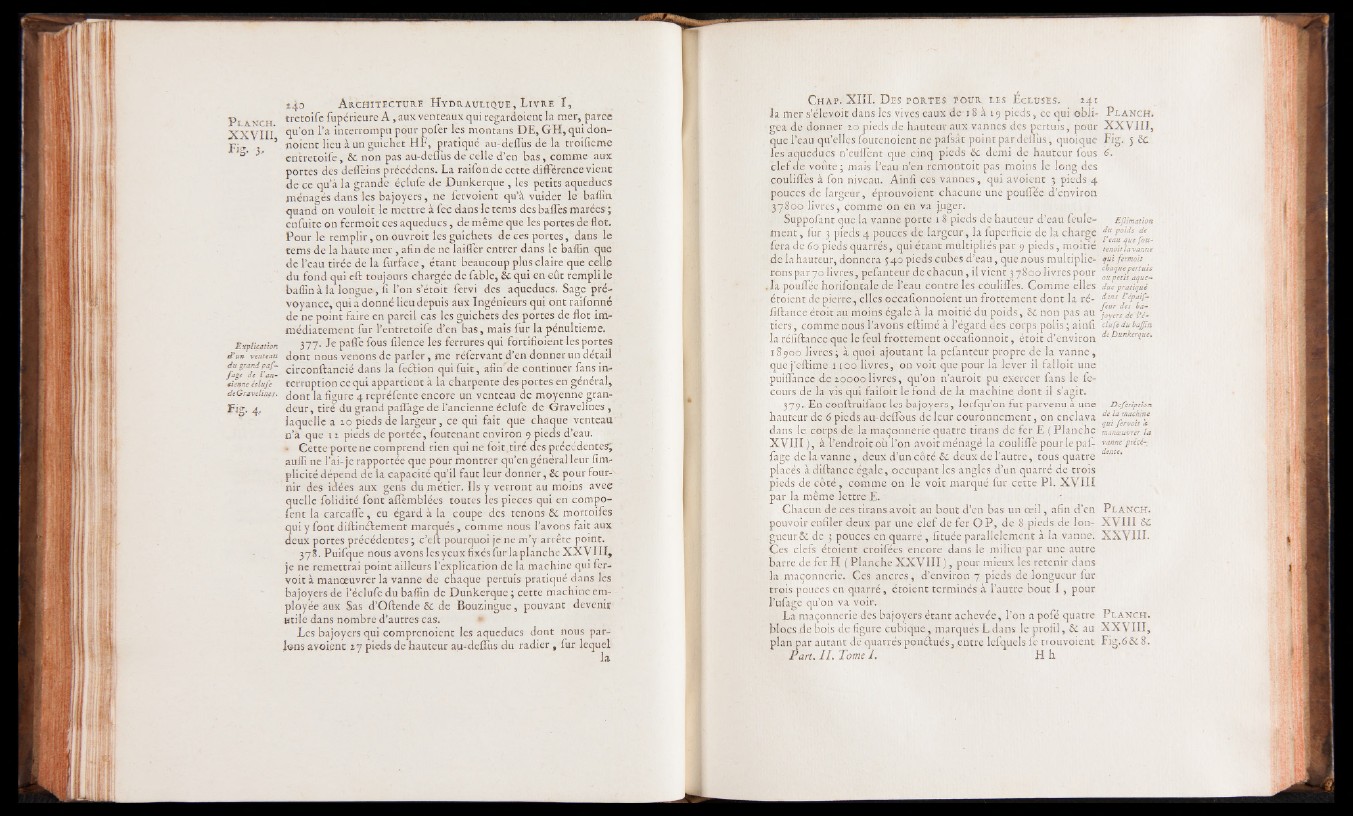
P l a n c h .
X X V I I I , Fig. 3,
Explication
d'un venteau
du grand pa f-
fage de l'antienne
éclufe
de Gravelines.
Fig- 4.
1 4 0 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v r e I ,
tretoife fupéricure A , aux venteaux qui regardoient la mer, parce
qu’011 l’a interrompu pour pofer les montans DE, GH, qui don-
noient lieu à un guichet HÉ, pratiqué au-deffus de la troifieme
entretoife, Sc non pas au-defl'us de celle d’en bas, comme aux
portes des deflèins précédens. La raifon de cette différence vient
de ce qu’à la grande éclufe de Dunkerque , les petits aqueducs
ménagés dans les bajoyers, ne fetvoient qua vuider le baffin
quand on vouloir le mettre à fee dans le tcms des baffes marées ;
enfuite on fermoir ces aqueducs, de même que les portes de flot.
Pour le remplir, on ouvroit les guichets de ces portes, dans le
tems de la haute mer , afin de ne laiffer entrer dans le baffin que
de l’eau tirée de la furface, étant beaucoup plus claire que celle
du fond qui eft toujours chargée de fable, Sc qui en eût rempli le
baffin à la longue, fi l’on s’étoit fervi des aqueducs. Sage prévoyance,
qui a donné lieu depuis aux Ingénieurs qui ont raifonné
de ne point faire en pareil cas les guichets des portes de flot immédiatement
fur l’entretoife d’en bas, mais fur la pénultième.
377. Je paflè fous filence les ferrures qui fortifioiént-les portes
dont nous venons de parler, me réfervant d’en donner un détail
circonftancié dans la feclion qui fuit, afin'de continuer fans interruption
cequi appartient à la charpente des portes en général,
dont la figure 4 repréfente encore un venteau de moyenne grandeur,
tiré du grand paflage de l’ancienne éclufe de Gravelines ,
laquelle a 20 pieds de largeur, ce qui fait que chaque venteau
n’à que 1 1 pieds de portée, foutenant environ 9 pieds d’eau.
• Cette porte ne comprend rien qui ne foit.tiré des précédentes;
auffi ne l’ai-je rapportée que pour montrer qu’en général leur fim-
plicité dépend de la capacité qu’il faut leur donner, Sc pour four-'
nir des idées aux gens du métier. Us y verront au moins avec
quelle folidité font alïemblées toutes les pièces qui en compo-
fent la carcaffe, eu égard à la coupe des tenons Sc mortoifes
qui y font diflinélement marqués, comme nous l’avons fait aux
deux portes précédentes; c’efl pourquoi je ne m’y arrête point.
378. Puifque nous avons les yeux fixés fur la planche X X V I I I ,
je ne remettrai point ailleurs l’explicarion de la machine qui fer-
voit à manoeuvrer la vanne de chaque permis pratiqué dans les
bajoyers de l’éclufe du baffin de Dunkerque ; cette machine employée
aux Sas d’Oftende Sc de Bouzingue, pouvant devenir
Utile dans nombre d’autres cas.
Les bajoyers qui comprenoient les aqueducs dont nous parlons
avoient 27 pieds de hauteur au-dcffus du radier , fur lequel
la
C h a p . X I II . D e s p o r t e s p o u r l e s É c l u s e s . 2 4 1
la mer s’élevoit dans les vives eaux de 18 a 19 pieds, ce qui obligea
de donner 10 pieds de hauteur aux vannes des permis, pour
que l’eau qu’elles foutenoient ne pafsât point par deffus, quoique
les aqueducs n’euflènt que cinq pieds Sc demi de hauteur fous
clef de voûte ; mais l’eau n’en remontoit pas moins le long des
couliflès à fon niveau. Ainfi ces vannes, qui avoient 3 pieds 4
pouces de largeur, éprouvoient chacune une pouflée d’environ
37800 livres, comme on en va juger.
Suppofant que la vanne porte 1 S pieds de hauteur d’eau feulement,
fur 3 pieds 4 pouces de largeur, la fuperficie de la charge
fera de 60 pieds quarrés, qui étant multipliés par 9 pieds, moitié
de la hauteur, donnera 540 pieds cubes d’eau, que nous multiplierons
par 70 livres, pefanteur de chacun, il vient 3 7800 livres pour
. la pouffée horifontale de l’eau contre les couliflès. Comme elles
étoient de pierre, elles occafionnoient un frottement dont la ré-
fîfiance étoit au moins égale à la moitié du poids, Sc non pas au
tiers, comme nous l’avons eflimé à l’égard des corps polis ; ainfi
la réfîflance que le feu} frottement occafionnoit, étoit d’environ
18900 livres ; à quoi ajoutant la pefanteur propre de la vanne,
que j’eflime 110 0 livres, on voit que pour la lever il falloir une
puiffance de 10000 livres, qu’on n’auroit pu exercer fans le fe-
cours de la vis qui faifoit le fond de la machine dont il s’agit.
379. En conflruifant les bajoyers, lorfqu’on fut parvenu à une
hauteur de 6 pieds au-deflous de leur couronnement, on enclava
dans le corps de la maçonnerie quatre tirans de fer E ( Planche
X V I I I ) , à i’endroitoù l’on avoitménagé la couliflè pourlepaf-
fage de la vanne , deux d’un côté Sc deux de l’autre, tous quatre
placés à diflance égale, occupant les angles d’un quarré de trois
pieds de côté, comme on le voit marqué fur cette PI. X V I I I
par la même lettre E. '
Chacun de ces tirans avoit au bout d’en bas un oe il, afin d’en
pouvoir enfiler deux par une clef de fer O P , de 8 pieds de longueur
Sc de 3 pouces en quarré , .fituée parallèlement à la vanne.
Ces clefs étoient croifées encore dans le milieu'par une autre
barre de fer H ( Planche X X V I I I ) , pour mieux les retenir dans
la maçonnerie. Ces ancres, d’environ 7 pieds de longueur fur
trois pouces en quarré, écoient terminés à l’autre bout I , pour
l ’ufage qu’on va voir.
La maçonnerie des bajoyers étant achevée, l’on a pofé quatre
blo.cs de bois de figure cubique, marqués L dans le profil, & au
plan par autant de quarrés-ponétués,.entre lefquels fe trouvoient
P a r t . i l . Tome 1. H h
P l a n c h .
X X V I I I ,
Fig. 5 Sc.
6.
Eflimation
du poids de
l'eau que fou-
tenoitlavanne
qui fermoit
chaque pertuis
ou petit aqueduc
pratiqué
dans l’épaif-
feur des bajoyers
d e 'l’éclufe
du baffin
de Dunkerque.
Defcription
de la machine
qui fervoit a
manoeuvrer la
vanne précédente,
P l a n c h .
X V I I I Sc
X X V I II .
P l a n c h .
XXVIII,
Fig.éScS.