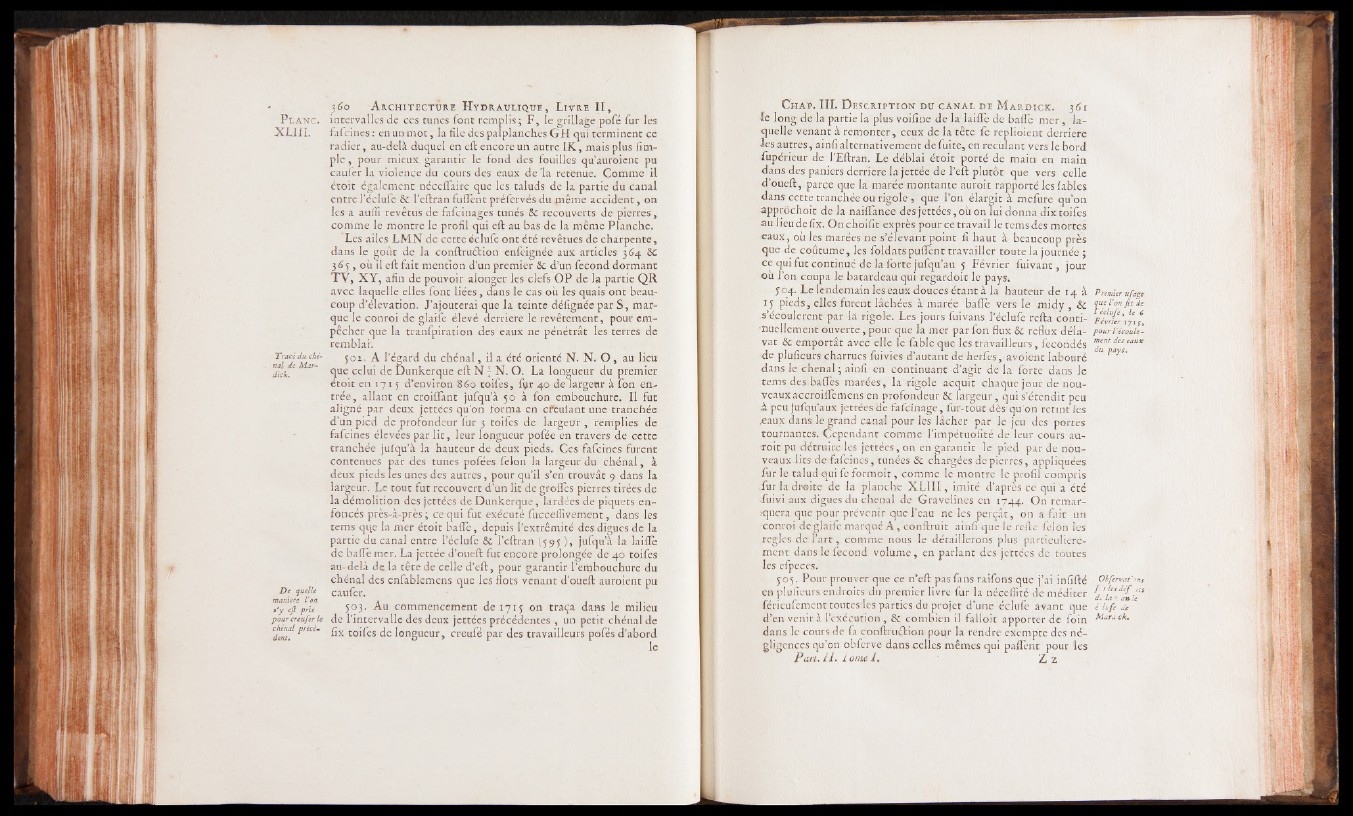
P lanc.
X L 11I.
Tracé du. chenal
de Mar-
diçk.
De quelle
maniéré l ’on
s’y efi pris
pour creufer le
chenal précèdent.
360 A rchitecture Hydraulique, L ivre I I ,
intervalles de ces tunes font remplis; F , le grillage pofé fur les
fafcines : en un m ot, la file des palplanches GH qui terminent ce
radier, au-delà duquel en eft encore un autre IK , mais plus Ample
, pour mieux garantir le fond des fouilles qu’auroient pu
caufer la violence du cours des eaux de 'la retenue. Comme il
étoit également néceflaire que les taluds dé la partie du canal
entre l’éclufe êc l’eftran fuflent préfervés du même accident, on
les a auffi revêtus de fafeinages tunés 6c recouverts de pierres ,
comme le montre le profil qui eftau bas de la même Planche.
Les ailes LMN de cette éclufe ont été revêtues de charpente,
dans le goût de la conftrudHon enfeignée aux articles 364 Sc
36 5, où il eft fait mention d’un premier ôc d’un fécond dormant
T V , X Y , afin de pouvoir alonger les clefs OP de la partie QR
avec laquelle elles font liées, dans le cas où les quais ont beaucoup
d’élévation. J ’ajouterai que la teinte défîgaéc par S , marque
le conroi de glaife élevé derrière le revêtement, pour empêcher
que la tranfpiration des eaux ne pénétrât les terres de
remblai’.
501 . A l’égard du chénal, il a été orienté N. N. O , au lieu
que celui de Dunkerque eft N j N. O. La longueur du premier
étoit en 17 15 d’environ 860 toifes, fur 40 de largeur à fon entrée,
allant en croiflànt jufqu’à 50 à fon embouchure. Il fut
aligné par deux jettées qu’on forma en cfëufant une tranchée
d’un pied de profondeur fur 3 toifes de largeur , remplies de
fafcines élevées par lit, leur longueur pofée en travers de cette
tranchée jufqu’à la hauteur de deux pieds. Ces fafcines furent
contenues par des tunes pofées félon la largeurdu chénal, à
deux pieds les unes des autres, pour qu’il s’en trouvât 9 dans la
largeur. Le touc fut recouvert d’un lit de greffes pierres tirées de
la démolition des jettées de Dunkerque, lardées de piquets enfoncés
près-à-près ; ce qui fut exécuté fucceflivement, dans les
tems que la mer étoit baffe, depuis l’extrémité des digues de la
partie du canal entre l’éclufe êc l’eftran (595 ), jufqu’à la Iaiflè
de baffemer. La jettée d’oueft fut encore prolongée de 40 toifes
au-delà de la tête de celle d’eft, pour garantir l’embouchure du
chénal des enfablemens que les flots venant d’oueft auroient pu
caufer.
503. Au commencement de 17 15 on traça dans le milieu
de l ’intervalle des deux jettées précédentes -, un petit chénal de
fix toifes de longueur, creufé par des travailleurs pofés d’abord
le
Char. III. Description du canal de Mardick. 361
le long de la partie la plus voifine de la laiffe de balle mer, laquelle
venant à remonter, ceux de la tête fe replioient derrière
les autres, ainfî alternativement de fuite, en reculant vers le bord
fupérieur de l’Eftran. Le déblai étoit porté de main en main
dans des paniers derrière la jettée de l’eft plutôt que vers celle
d’oueft, parce que la marée montante auroit rapporté les fables
dans cette tranchée ou rigole, que l’on élargit à mefure au’on
apprôchoit de la nailïànce desjettées,où onlui donna dix toifes
au lieu de fix. On choifit exprès pour ce travail le tems des mortes
eau3{, ou les marées ne s’élevant point fi haut à beaucoup près
que de coutume, les foldats puflènt travailler toute la journée ;
ce qui fut continué de la forte jufqu’au 5 Février fuivant, jour
ou l’on coupa le batardeau qui regardoic le pays.
504. Le lendemain les eaux douces étant à la hauteur de 14 à
15 pieds, elles furent lâchées à marée baffe vers le midy , 6c
s’écoulèrent par la rigole. Les jours fuivans l’éclufe refta conti-
■ nuellement ouverte, pour que la mer par fon flux 6c reflux délavât
6c emportât avec elle le fable que les travailleurs, fécondés
de plufieurs charrues fuivies d’autant de herfes, avoient labouré
dans le chenal; ainfi en continuant d’ agir de la forte dans le
tems des baffes marées, la ■ rigole acquit chaque jour de nouveaux
accroiffèmens en profondeur 6c largeur, qui s’étendit peu
à peu jufqu’aux jettées de fafeinage, fur-tout dès qu’on retint les
eaux dans le grand canal pour les lâcher par le jeu des portes
tournantes. Cependant comme l’impétuofité de leur cours auroit
pu détruireles jettées, on en garantit le pied par de nou-
veaüxdits de:fafcines, tunées 5c chargées de pierres, appliquées
fur le.taludqui fe formoit, comme le montre le profil compris
fur la d roi te de la planche X L I I I , imité d’après ce qui a été
fui vi .aux digues du chenal de Gravelines en 1744. On remarquera
que pour prévenir que l’eau ne les perçât, on a fait un
■ conroi de glaife marqué A , conftruir ainfi que le refte félon les
réglés de l’a rt, comme nous le détaillerons plus particulièrement
dans le fécond volume, en parlant des jettées de toutes
les efpeces.
505. Pour prouver que ce n’eft pasfans raifons que j’ai infifté
en plufieurs endroits du premier livre fur la néceffité de méditer
férieufement toutesdes parties du projet d’une éclufe ayant que
d’en venir à l’exécution , 6c combien il falloir apporter de foin
dans le cours de fa conftmétion pour la rendre exempte des négligences
qu’on obferve dans celles mêmes qui paflènt pour les
P a n . i l . io / n c - l. Z z
Premier ufiage
que l ’on f it de
l éclufe y le 6
Février 1 7 1 f ,
pour l ’écoulement
des eaux
du pays.
Obfervat '~>ns
f i r ies défi us
de la « an le
é lu fie de
Mura ck.