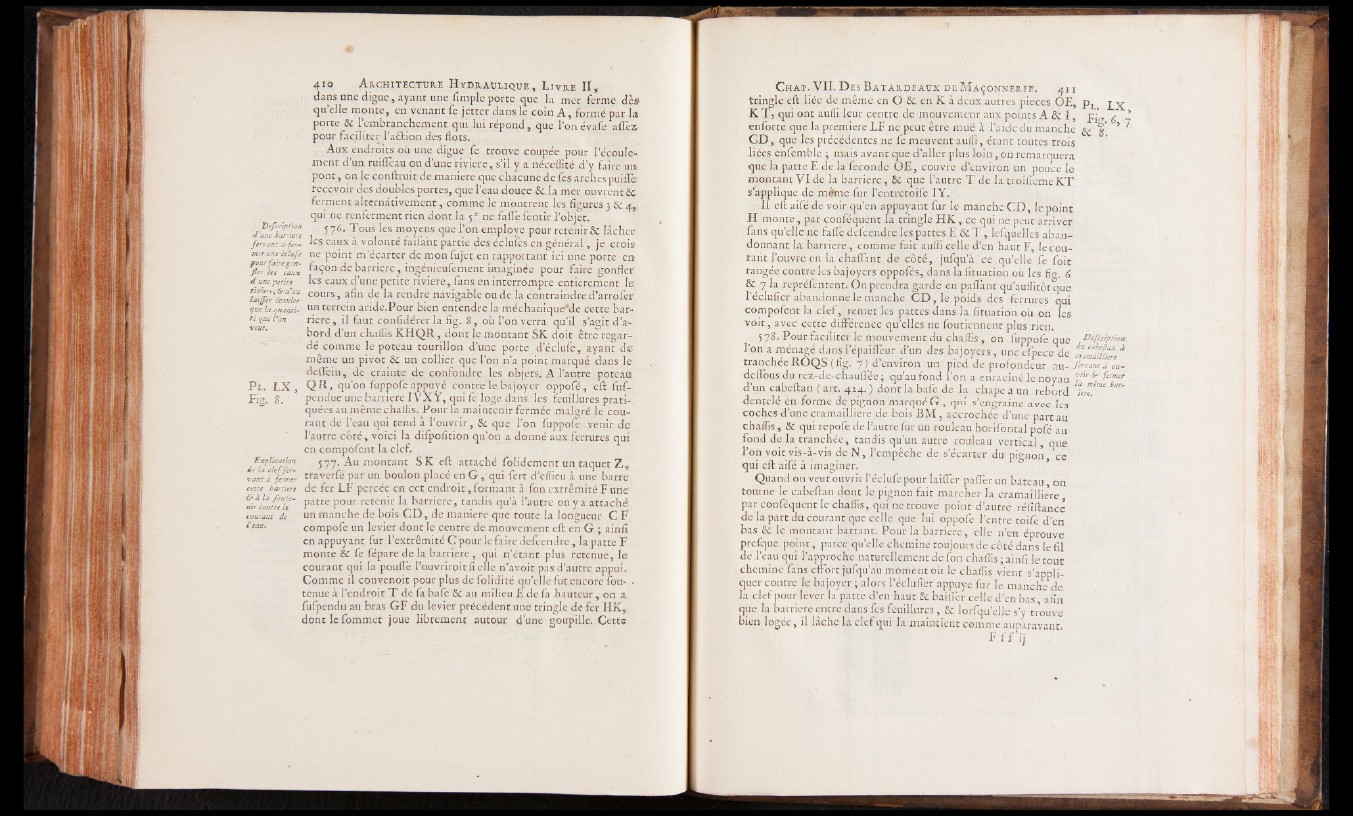
4 io A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i v r e I I ,
dans une digue, ayant une fimple porte Que la met ferme dès*
quelle monte, en venant fe jetter dans le coin A , formé par 1*
porte & l’embranchement qui lui répond, que l’on évafe allez
pour faciliter l’adtion des flots.
Aux endroits où une digue fe trouve coupée pour l’écoulement
d’un ruiflèau ou d’une riviere, s’il y anéceflîté d’y faire un
pont, on le conftruit de maniéré que chacune de fes arches puifle
recevoir des doubles portes, que l’eau douce St la mer ouvrent 6c
ferment alternativement , comme le montrent les figures 3 & 4,
qui ne renferment rien dont la 5 e ne fafTe fentir l’objet.
d'fnftanUre Î 76' Tous les moyens que l’on employé pour retenir 6c lâcher.
fervant à-fer- lcs eaux à volonté faifaht partie des éclufes en général, je crois
mtr une êdufi ne point m’écarter demonfujet en rapportant ici une porte en
rflerUsr‘emx faÇon de barrière, ingénieufement imaginée pour faire gonfler
dune petite les eaux d’une petite riviere, fans en interrompre entièrement le',
U ff ir ’fcÔuUr C0urs 5 a® n ren^re navigable ou de la contraindre d’arrofer
que la quanti- V p n aride.Pour bien entendre la méchanique'de cette bar-
tè que l’on riere, il faut coufidérerla fig. 8, où l’on verra qu’il s’agit d’abord
d’un chaflis K H Q R , dont le montant SK doit être regardé
comme le poteau tourillon d’une porte d’éclufe, ayant d©
même un pivot Sc un collier que l’on n’a point marqué dans le
deflèin, de crainte de confondre les objets. A l’autre poteau!
P l . L X , QH» qu’on fuppofe appuyé contre le bajoyer oppofé, eft fuf-
F ig . 8. pendue une barrière IV X Y , qui fe loge dans les feuillures pratiquées
au même chaflis. Pour la maintenir fermée malgré le courant
de l’eau qui tend à l’ouvrir, Sc que l’on fuppofe venir de
l’autre côté, voici la difpofition qu’on a donné aux ferrures qui
en compofent la clef. ,
^Explication 577. Au montanc S K eft attaché folidement un taquet Z ,
v ‘ant à fermer traverfé par un boulon placé en G , qui fert d’eflieu à une barre
cette barrière de fer LF percée en cet endroit, formant à fon extrémité F une'
% blo r£ èh ~ Pacce pour retenir la barrière, tandis qu’à 1 autre on y a attaché
courant de un manche de bois C D , de maniéré que toute la longueur C F
l ’eau. compofe un levier dont le centre de mouvement eft en G ; ainfi
en appuyant fur l’extrêmité Cpour le faire defeendre, la patte F
monte St fe fépare de la,barrière, qui n’étant plus retenue, le-
courant qui la pouflè PouvrirpitCelle n’avoit pas d’autre appui.
Comme il convenoit pour plus de folidité qu’elle fut encore fou- •
tenue à l’endroit T de fa bafe Sc au milieu E de fa hauteur, on a
fufpendu au bras G F du levier précédent une tringle de fer HK,
dont le fommet joue librement autour d’une goupille. Cette
C haé. V II. Des Batardeaux de Maçonnerie. 4 1 i
tringle eft liée de même en O 6c en K à deux autres pièces OE, p L t v
K T , qui ont auflî leur centre de mouvemenr aux points A Sc I , Fiu 6 *
enforte que la première LF ne peut être mue à l’aide du manche & g QD
C D , que les précédentes 11e fe meuvent aufli, étant toutes trois
liées enfemble ; mais avant que d’aller plus loin, on remarquera
que la patte E de la fécondé O E, couvre d’environ un pouce le
montant V I de la barrière, Sc que l’autre T de la troifiemeKT
s applique de même fur l’entretpife IY .
Il eft aifé devoir qu’en appuyant fur le manche C D , le point
H monte , par conféquent la tringle H K , ce qui ne peut arriver
fans qu’elle ne fafTe defeendre les pattes E Sc T , lefquelles abandonnant
la barrière , comme fait auflî celle d’en haut F, le courant
l’ouvre en la chaflant de côté, jufqu’à c e qu’elle fe foie
rangée contre les bajoyers oppofés, dans lafituation où les fig. 6
Sc 7 la repréfentent. On prendra garde en paflant qu’auflîtôt que
l’éçlufier àbaudonnele manche C D , le poids des ferrures qui
compofent la c lef, remet les pattes dans la fituation où on les
voit, avec cette différence qu’elles ne foutiennent plus rien.
578. Pour faciliter le mouvement du chaflis , on fuppofe que Dcfiriptwn
l ’on a ménagé dans l’épaifleur d’un des bajoyers , une efpece de trammulc *'
tranchée RÔQS ( fig. 7 ) d’environ Un pied de profondeur au - fenâm'Tlu-
deflousdu rez-de-chauflee ; qu’au fond l’on a enraciné le noyau Y " fermc*
d’un càbeftan ( art. 4 14 .) dont la bafe de la chape a Un rebord i ™ " “ b" '
dentelé en forme de pignon marqué G , qui s’engraine avec les
coches d’une cramâilliere de bois BM , accrochée d’une part au
chaflis, Sc qui repofe de l’autre fur un rouleau horifontal pofé au
fond de la tranchée, tandis qu’un autre rouleau vertical que
l ’on voit vîs-à-vis de N , l’empêche de s’écarter du pignon, ce
qui eft aifé à imaginer.
Quand on veut ouvrir Téclufe pour laifTer pafTerun bateau on
tourne le cabeftan dont le pignon fait marcher la cramailliere
par conféquent le'chaflis, qui ne trouve point d’autre réfîftancè
de la part du courant que celle que lui oppofe l’entre toife d’en
bas Sc le montant battant. Pour la barrière, elle n’en éprouve
prefque point, parce qu’elle chemine toujours de côté dans le fil
de l’eau qui l’approche naturellement de fon chaflis ; ainfi le tout
chemine fans effort jufqu’au moment où le chaflis vient s’appliquer
contre le bajoyer ; alors l’éclufier appuyé fur le manche de
la clef pour lever la patte d’en haut Sc bailler celle d’en bas afin
que la barrière entre dans fes feuillures , Sc lorfqu’elle s’y trouve
bien logee, il lâche la clef qui la maintient comme auparavant.