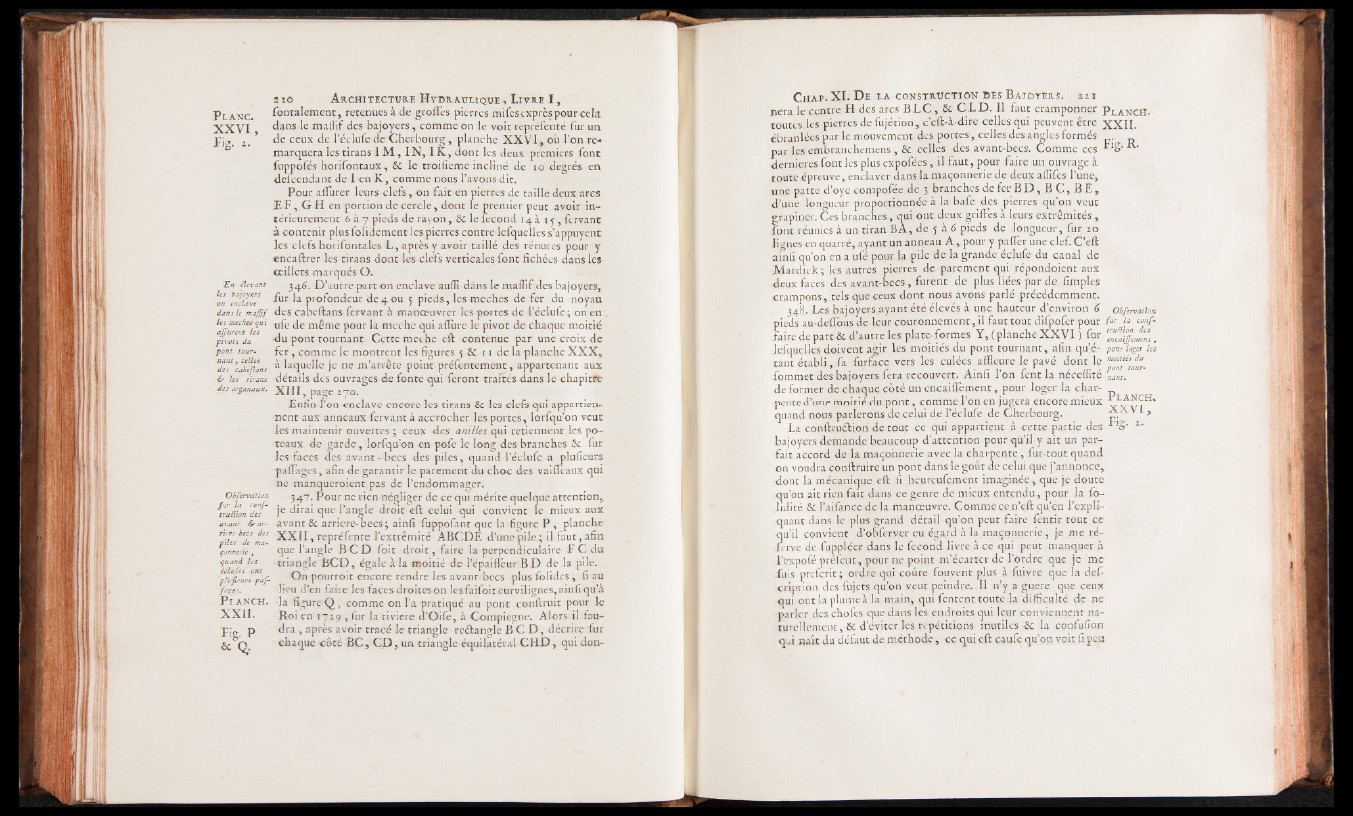
P l a n c .
X X V I ,
Fig. z.
E n élevant
les bajoycrs
on enclave
dans le majfff
les meches-qui
affûtent les
pivots du
pont tournant3
celles
des cabefians
& les tirans
des arganaux.
Obfervation
fu r la conf-
truElïon des
avant & ar-
rure-becs des
piles de maçonnerie
y
quand les
éclufes ont
phfieurs paf-
fa ge s.
P l a n c h .
X X I I .
Fig. P
8c Q.
i i o A r c h it e c t u r e H y d r a u l iq u e , L iv r e I ,
fontalement, retenues à de grofles pierres mifes exprès pour cela
dans le maflîf des bajoyers, comme on le voit repréfenté fur un
de ceux de l’éclufe de Cherbourg, planche X X V I , où l’on re->
marquera les tirans 1 M , IN , I K , dont les deux premiers font
fuppofés horifontaux, & le troifieme incliné de io degrés en
defcendant de I en K , comme nous l’avons dit.
Pour allùrer leurs clefs, on fait en pierres de taille deux arcs
E F , G H en portion de cercle, dont le premier peut avoir intérieurement
6 à 7 pieds de rayon, 8t le fécond 14 a 1 5 , fervant
à contenir piusfolidement les pierres contre lefquelles s’appuyent
les clefs horifontales L,après y avoir taillé des rénures pour y
encadrer les tirans dont les clefs verticales font fichées dans les
oeillets marqués O.
346. D ’autre part on enclave auffi dans le maflif des bajoyers,
fur la profondeur de 4 ou 5 pieds, les meches de fer du noyau
des cabeftans fervant à manoeuvrer les portes de l’éclufc ; on en .
ufe de même pour la meche qui allure le pivot de chaque moitié
-du pont tournant Cette meche eft contenue par une croix de
fe r , comme le montrent les figures 3 8t 1 1 de la planche X X X ,
à laquelle je ne m’arrête point préfentement, appartenant aux
dét-ails des ouvrages de fonte qui feront traités dans le chapitre
X I I I , page 170.
Enfin l’on enclave encore les tirans 8t les clefs qui appartiennent
aux anneaux fervant à accrocher les portes, lorfqu’on veut
les maintenir ouvertes ; ceux des an ilte s qui retiennent les poteaux
de garde, lorfqu’on en pofe le long des branches & fur
les faces des avant- becs des piles, quand l’éclufe a plufieurs
■ pailages, afin de garantir le parement du choc des vaifTeaux qui
ne manqueroient pas de l’endommager.
3 4 7 . Pour ne rien négliger de ce qui mérite quelque attention,
je dirai que l’angle droit eft celui qui convient le mieux aux
avant & arriere-becs; ainfi fuppofant que la figure P , planche
X X I I , repréfenre l’extrémité ABCDE d’une pile.; il faut, afin
que l’angle B C D foit droit, faire la perpendiculaire F C du
triangle B C D , égale à la moitié de l’épaifïcur B D de la pile.
On pourroit encore rendre les avanr-becs plus folides , fi au
lieu d’en faire les faces droites on les faifoit curvilignes, ainfi qu’à
la figure Q , comme on l’a pratiqué au pont conftruit pour le
Roi en 1729 , fur la riviere d’Oife, à -Compiegne. Alors il faudra
, après-avoir tracé le triangle reélangle B C D , décrire fur
chaque côté B C , C D , un triangle équilatéral CH D , qui don-
C h a p . X I . D e l a c o n s t r u c t io n d e s B a jo y e r s . 2 2 1
nera le centre H des arcs B L C , 8c C L D. Il faut cramponner P lancH.
toutes les pierres de fujédon, c’eft-à-dire celles qui peuvent être X X I I .
ébranlées par le mouvement des portes, celles des angles formés
par les embranchemens , 8c celles des avant-becs. Comme ces
dernieres font les plusexpofées, il faut, pour faire un ouvrage à
toute épreuve, enclaver dans la maçonnerie de deux alfifes l’une,
une patte d’oye compofée de 3 branches de fer B D , B C , B E ,
d’une longueur proportionnée à la bafe des pierres qu’on veuc
grapiner. Ces branches, qui ont deux griffes à leurs extrémités ,
font réunies à un tiran BA, de 5 à 6 pieds de longueur, fur 20
lignes en quarré, ayant un anneau A , pour y paffer une clef. C ’eft
ainfi qu’on en a ufé pour la pile de la grande éclufe du canal de
Mardick ; les autres pierres de parement qui répondoient aux
deux faces des avant-becs, furent de plus liées par de fimples
crampons, tels que ceux dont nous avons parlé précédemment.
348..-Les bajoyers ayant été élevés à une hauteur d’environ 6 o iftmuim
pieds au-deffous de leur couronnement, il faut tout difpofer pour f ur [* a f faire
de part 8c d’aurre les plate-formes Y , (planche X X V I ) fur
lefquelles doivent agir les moitiés du pont tournant, afin qu’é- pour loger les
tant établi, fa furface vers les culées affleure le pavé dont le B E h ë
fommet des bajoyers fera recouvert. Ainfi l’on fent la néçeflîté Zmt.
de former de chaque côté un encadrement, pour loger la char-
pente d’une moitié du pont, comme l’on en jugera encore mieux v l f v T K*
quand nous parlerons de celui de l’éclufe de Cherbourg. 7 : ^ ' »
La conftru&ion de tout ce qui appartient à cette partie des ^1§' 1 ’
bajoyers demande beaucoup d’attention pour qu’il y ait un parfait
accord de la maçonnerie avec la charpente , fur-tout quand
on voudra conftruire un pont dans le goût de celui que j’annonce,
dont la mécanique eft fi heureufement imaginée, que je doute
qu’on ait rien fait dans ce genre de mieux entendu, pour la fo-
lidité 8t l’aifance de la manoeuvre. Comme ce n’eft qu’en l’expliquant
dans le plus grand détail qu’on peut faire fentir tout ce
qu’il convient d’obferver eu égard à la maçonnerie , je me ré-
fierve de fuppléer dans le fécond livre à ce qui peut manquer à
l ’txpofé préfent, pour ne point m’écarter de l’ordre que je me
fuis preferit ; ordre qui coûre fouvent plus à fuivre que la de f
cription des fujets qu’on vent peindre. . Il n’y a guere que ceux
qui ont la plume à la main, qui fentent toute la difficulté de ne
parler des chofes que dans les endroits qui leur conviennent naturellement,
& d’éviter les répétitions inutiles 8c la confufion
qui naît du défaut de méthode, ce qui eft çaufe qu’on voit fi peu