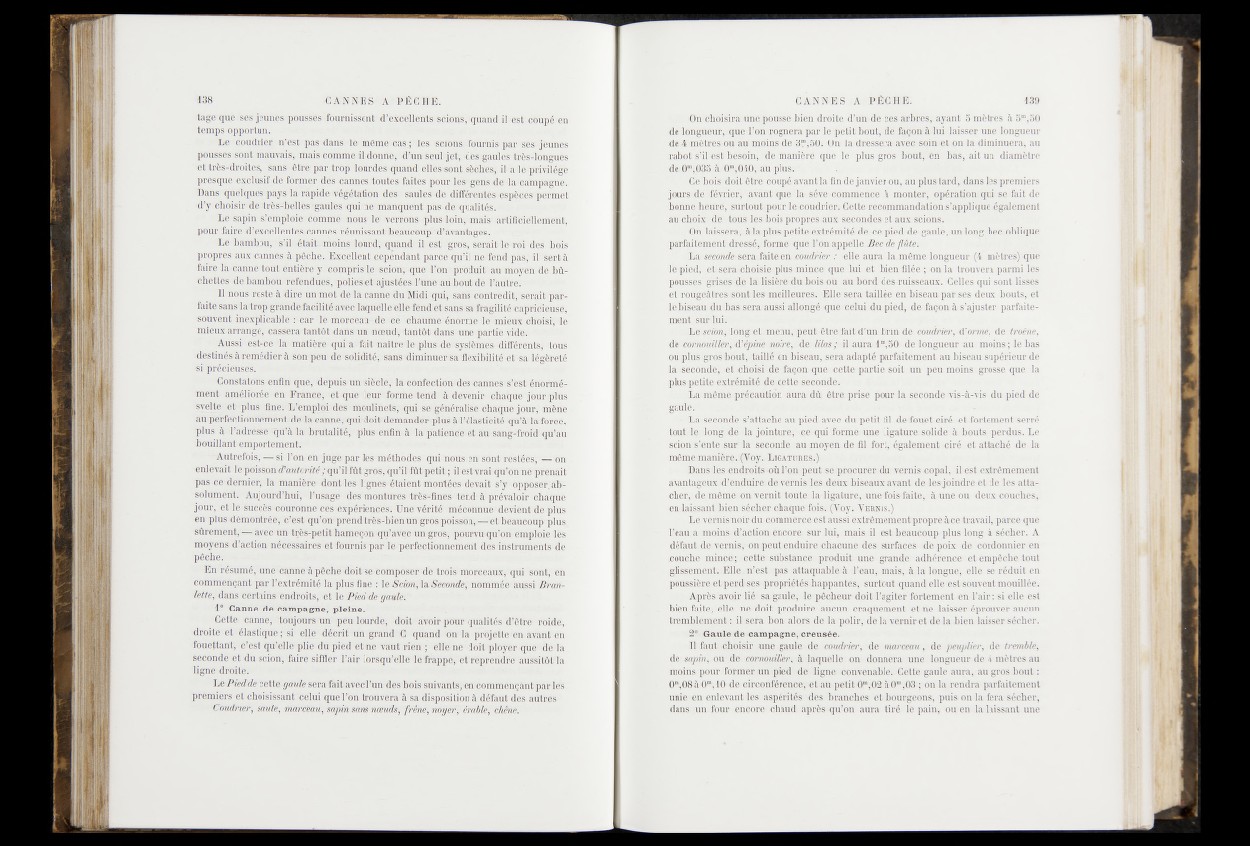
tage que sês jeunes’ pousses -fourbissent d’exeeiients scions, quand ©é»®*p^ wa
temps opportun.
• Le coudrier n’est pas dans le même casj «lires •seton&jfoumis par ses jeunes
pousses sont mauvais, mais comme ihcteune, d’un seul-jet, .des gaülés'teès-longues
' et très-droites, sans être par tro ^ is ^ iile - p p a É ^ le s ^ iitj^ ili^ J A lf li privilège
presque excljisîï de former ■J$%h'aifoYsJlbutéS' faîtes pour lèse gens rd^la eaînpagiîe.
Dans quelques pays la rapid&végét'ation d6S@ sàules de différentes esp^deS'ïpermet
d’y choisir de’-irès'-'belles-'gaules qui ne ÿnanqdent pas.de qualités. «?■
Le sapin sée m pl oieocomme nous- le’ verrons plus toin, mais artificiel eurent,
pour faire d ’ exeell entesr cannes' réunissantr-Leaucoup^d’ avantages. ’
Le bamhtiu^£&Kétait_-moîns,'lôufd; quand' îlpest gresj serait le-roi del b élis
propres aux cannes A pêçhe. Excellente qppjid'lnt parce qu*|[-ïïeiffend pàs^$§>seèt'à'
faire la •eamaêstout niïtîère'y'compris fc^scion; que l’on produit'au moyen de M -
' ©belles dtbamfiou refendues, -.polM-ret ajustées MpU au bcÈfit-I^Taufi®^®
Il no^Seste à cgséë un mot QFê la canne du Midi ;qüi, saàWi^jTÎtredit, serait par-
faite saasdaÿfrop grande facilrtÀævfecïlïqtigîïeSKfe’ferid est sêmsssa?fragüitêt;ap®iâëttsé,
Souvent îfex ^ î’e a b îlê ^ ^ r1-le morceaUSde --eè ’ GhauSe^éiïsrme le InÿiÉiiÉî '‘<5ll®i!iÇïife
mieux arrangé, ÇâSsêràrtantôt dans ufiTuGeudy tantôt dawnme
• Aôssi iæt^ceiîa"matière- qui‘forfait naître leqSfei'deisysfèfeidSi-différents^ tdë&
destiné^Aremedier à i soupeuMe -solid sanfeîdfeffitfôerïSa 'fléxIbâ$Mlft*fesCié^P®ïé
«si préciêuèife'Aîd
■Constatons enfin’ que, depïh&Jun’sièete,' lamèùfeetion)des?S^‘es^s%St^©rrfté-
ment amilfifo#^ en France«; -et que leur ' fcrme-tend à devenir c É a |te ^ f te ^ u s
svelte-etvv plus fi«e-i L’emplbi^dfèÉ* moulinets, ; q ^ s ^ ^ i é r S * i ^ iÀ # :|||lA,
#fr|MfecMonneinênt de’la'uamnevqurdôi#dfemandéi>plu§tà#éAidifcité qu’àsfedto1î!@e,
plus à ■l’adrèssê^qû'à la brutalité,- plus-enfe^à'î’fe%atidfide
~Autrefois, —^Ü^l’on en juge par 1 es:mêtbo d esv qui nous erê s ib f r r ^ ^ ë ^ ^ 'ô n
enlevait le poisson d’autorité ; qu’il fût gros, qu’il fût petit ; il”ès^|raijf^®’§fflk@j^renâit
pas-ee-ydênaeter, la manière dont lesdigdes^êtsieat monféesr#ê$âdfo s;y4tipp©sif(S!l3t:
S0lument.e«%ijourd’bui, l’usage 'des'montures très-Bteê&t^dFài prêtai dit châ'que
jour, ebfe*S6obëè*jCouroime Ces expériences. ’Une' vérité ;4t e S 0 t e ^ ’dré¥iéb-t'de?p3®s
en plusdémQntféèq’e’est qu’Oer prend très-dJïëntm gros poisson,4l^%!îMaWeoufefki«
sûrement, —âv#c utf-tfèB-petrt hameçon qu’avec un gros,"pourvu qû’dîÉ ’é'HÎpliSSi 1!&
moyens d’action BéeêSsafires èt fournis paûlfeperfeptfonnemerif ff^HEffuments-dfe
pêche; B
En résuMê, une canne àpêche deibee-cofcposer dè trois- rûoreéàtatëÿ' qui sont, en
commençant par l’extrémité la plus fine : Iè Scion, la Seconde, ntkùffiéë'fottssi Bran-
lette, dans certains endroits, et -le Pied de 'gatle.
1° Canne de campagne, pleine.
Cette eanne, toujours un peu lourde, doitiâvoirpoüï1' qualités d^êtfe- roide,
droite^et élastique; si elle décrit-üm grand C quand ùn^la projette*en avant en
fouettant, ‘iîfost qtfeîle plie du pied é tn e vautrien ; ’elfe: ne doit ployer que- de la.
seconde et du scion, faire siffler rair-lor&qu’dtlë^lefrappev et '^prendre
ligne, droite.
he Pied de celte gaule sera. feitaSBUSiÉ des bois suivantsffeÉ'doiiiBàôÉÇtint par les
premiers et choisissanfrcelui que l'on trouvera à sa disposition â défaut des autres
i j Coudrier, saule, marcfeau, sapin sans n(mds;'frêm;ra>geryérdble; chêne.
On choisira une pousse bien droite d’un de ces arbres, ayant 5 mètres à 8“,50
de longueur, que l’on rognera par le petit bout, de façon à lui laisser une longueur
d e 4 mètres ou au moins de 3“ ,50. Où la dressera avec soin et on la diminuera, au
.rabot s’il'est besoin, de manière que le plus gros bout, ên bas, ait un diamètre
Ée.0w,Q3S ÉvO^jOi®, au plus.
Ce bois 'doit être coupé avant la fin de janvier ou, au plus tard, dans les première
jours de février-, avant que la sève commence à monter, opération qui se fait de
bonne heure, surtoutpour le coudrier. Cette recommandation s’applique également
au eb@is .de tous les.<b@is propres aux secondes et aux scions.
On laissera, à la pins petite extrémité de ce pied de gaule, un long bec oblique
parfaitement dressé, forme que Fou appelle Jîec de flûte.
. La seconde sera faite en coudrier : elle aura la. même longueur (4 mètres) que
léipedj et r fini ipfclliîri phin à àw e que lui et bien filée ; on la trouvera parmi les
pousses g E Ë ^ || la lisière ébat bois ou au bord des ruisseaux. Celles qui sont lisses
et rougeâtres sont les meilleures. EUe sera taillée en biseau par ses deux bouts, et
le.biseauiidu bas sera aussi allongé que celui du pied, de façon à s’ajuster parfaitement
sur lui.
I Le sczori, long et menu, peut être fait d’un brin de coudrier, d’orme, de troène,
dfo eoewuülèeyÂ’épime noire, de lilas; il aura l m,o0 de longueur au moins; le bas
ou plus gros bout, taillé en biseau, sera adapté parfaitement au biseau supérieur de
la seconde, et choisLde façon que cette partie soit un peu moins grosse que la
p u s petite extrémité de cette seconde.
La même précaution aura dû être prise pour la seconde vis-à-vis du pied de
gaule. '
’ •«■ ‘Êaiggeoiïde' s’attache au pied avec du petit fil de fouet ciré et fortement serré
tout ler.long de la jointure, ce qui forme une ligature solide à bouts perdus. Le
scion s’ente sur la seconde, au moyen de fil fort, également ciré et attaché de la
même manière. (Yoy. Ligatures.) ;
Dans les endroits où l’on peut se procurer du vernis copal, il est extrêmement
avantageux d’enduire de vernis les deux biseaux avant de les joindre et de les attacher,
de même, on vernit toute la ligature, une fois faite, à une ou deux couches,
en laissant bien sécher chaque fois. (Yoy. Vernis.) i
Le vernis noir du commerce est aussi extrêmement propre à-ce travail, parce que
Feau a moins d’action encore sur lui, mais il est beaucoup plus long à sécher. A
défaut de vernis,-on peut enduire chacune des surfaces de poix de cordonnier en
couche mince; cette substance produit une grande adhérence et empêche tout
glissement. Elle, n’est pas attaquable à l’eau,- mais, à la longue, elle se réduit en
poussière et perd ses propriétés happantes, surtout quand elle est souvent mouillée.
;'f Après avoir lié sa gaule, le pêcheur doit l’agiter fortement en l’air : si elle est
bien faite, elle ne doit produire aucun craquement, et ne. laisser éprouver aucun
tremblement : il sera bon alors de la polir, de la vernir et de la bien laisser sécher.
2° Gaule de campagne, creusée.
Il faut choisir une gaule de coudrier, de marceau, de peuplier, de tremble,
de. sapin,, ou de cornouiller, à laquelle on donnera une longueur de 4 mètres au
moins pour former un pied de ligne' convenable. Cette gaule aura, au gros bout :
0m,08 à 0m,10 de circonférence, et au petit 0m,02 à0",03 ; on la rendra parfaitement
unie en enlevant, les aspérités des branches et bourgeons, puis on la fera sécher,
dans un four encore chaud après qu’on aura tiré le pain, ou en la laissant une