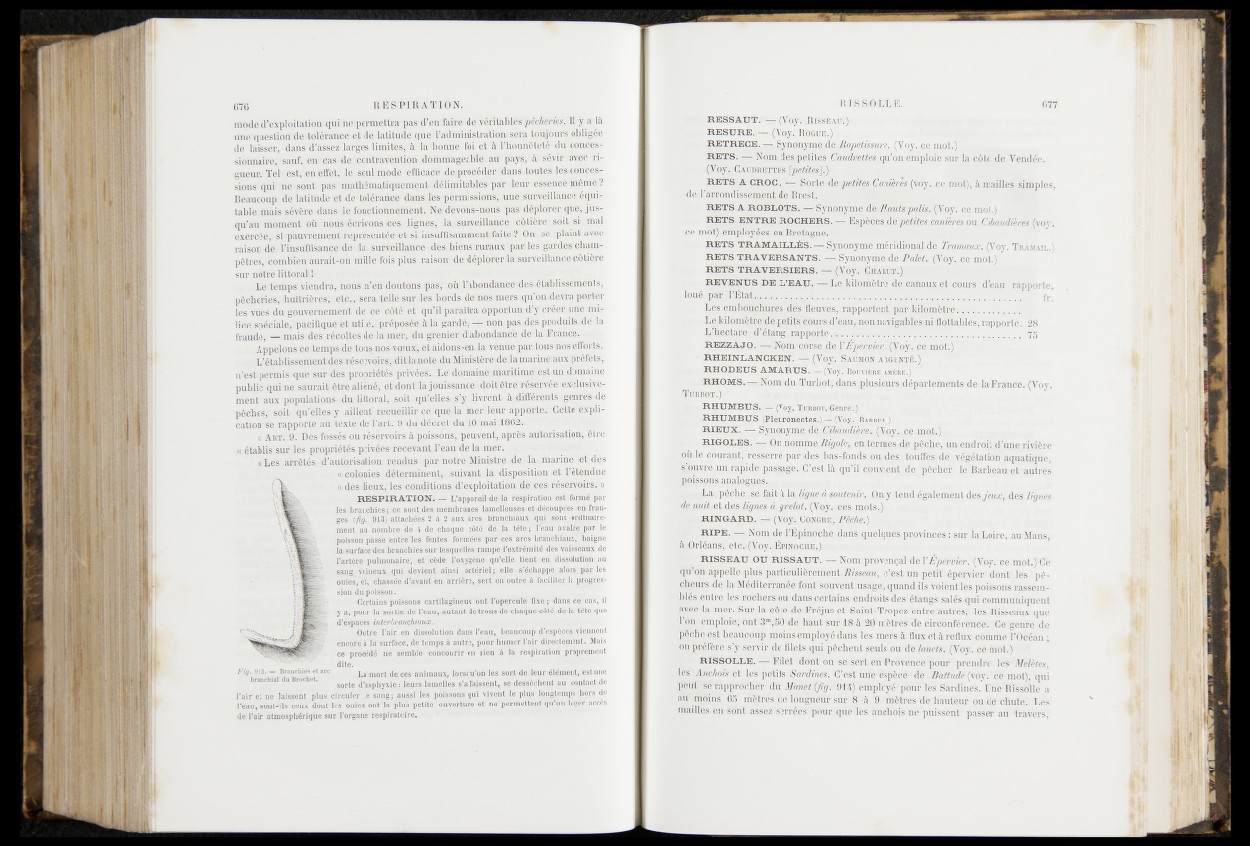
676 R E S P IR A T IO N .
mode d’exploitation qui ûe'permettra pas d’emfaire-'de véritables Il y a; là
une question de tolérance et de latitude que l’adnyaD.istra'ti-d&.s^a tosÈjiQïreS fiiflSgée
de laisser, dans d’assez large’s limitas! à la boîfne foi et à rFè^HMefé^'dd uûnees-
sionnaire, saufj en ièas decontraventiôred'Otomageable au1 paygLÀrséRânavÇC rigueur.
Tel ,est,,en effet, Te sèultmo€fe-’elficacetidôya®Q'iédt(indan9-toutes le^ooppea-
sions qui' üfe sont pas math-ématiquexmenWâéMmitabïesi paf dtéur dsfedeê'miême|?
BeaucGïtp de latitude .et de'tolérance dans des permis^ns, -unefSuRy^lk'iïeet équitable
m#Sîséyèrevddns leloaptionneinent. Ne>dçvonski®)is pas’déspàofef que, jusqu’au
moment od 'nous écrivons .ces-lignes, la surveilkaçeu cG.tièiie‘qs®ît sb^mal
exercée, 'si pauvrement représentée et; si insuf&sa'inrbtentf fai^èïsh QüH se?}pkiDilM.sfàÇ
raison de Iîinpufflsangetde.'la suryeillance*.desibièns ruraux paÿFtes gardes cha®**
pêtres, combien aurait-on mill#foiS'pms raison'de déplorer la surveilknceifiôtière
sur notre littoral J
,L6 tempsrsiendra, nous n’# d lU t p i s fas,’ o h
pêcheries, huîlrières, etc., sera telle sur les bords de nos mers qu’on devra porter
les vues du gouvernement de' ce côté et qu’il paraîtra' opportun, d^y créer Une milite
Spéciale, pacifique et utile, préposée à la gardé, — non pas des produits de la
frau d e ,— mais des récoltes de la du grenier d’abondancé;®||la France.
Appelons ce temps di tousnos voeux, et aidons-en la venue par tous nosefforls.
L’établissement des géservoirs, ditilanote du Ministère d e là marin eaux préfets,
n’est permis que sur des propriétés privées. Le d omaine;maritime|f|tuu domaine
public qui ne saurait être aliéné, et dont la jouissance doit être réservée exclusive-
mènt aux populations du littoral, soit qu’elles s ’y livrent à difl'ÔEents genres de
pêches, soit qu’elles y aillent recueillir ee/què la mer leur apporte.. Cette explication
se rapporte auTexte de l’art. 9 du d é c® du 10 mai 1862.
' « a h t .- 9; Des fossés ou réservoirs à poissons, peuventyaprès.autorjsétion, être
« établis sur les propriétés privées recevant l’eau de la mer.
« Les arrêtés d’autorisation rendus par notre Ministre de la marine et des
« colonies déterminent, suivant la disposition et l’étendue
« des lieux, les conditions d’exploitation de ces réservoirs. ®
RESPIRATION__L’aÿpa£eiMe^% M^ifa^ô'îglsst^lllltpa r
les branchies; ce sont des membranes lamelleuses et découpées en franges
(fig . 013) attachées 2 à 2 aux arcs branchiaux qui sont ordinairement
au nombre de 4 de chaque, côté de la tête ; l’eau avalée par le
poisson passe entre les fentes formées par- ces arcs branchiaux, baigne
la surface des branchies sur lesquelles rampe l’extrémité des vaisseaux do
l’artère pulmonaire,-et cède l’oxygène qu’elle Lient ;cn. dissolution au
sang.veineux qui devient ainsi artériel; elle s’échappe alors par les
ouïes, et, chassée d’avant en arrière, sert en outre,à faciliter Ja progres-
sion dupoisson.
Certains poissons cartilagineux ont l'opercule flxe; dans cc cas, il
y a, pour la sortie de l’eau, autant de trous de chaque côté de la Lctc que
d’espaces in le r b r a n û h ù iu x . ,
Outre Pair en dissolution dans l’eau, beaucoup tKespèces viennont
encore à la'surface, de temps à autre, pour humer l’air directement. Mais
ce procédé ne semble concourir en 'rien à la respiration proprement
1 - " ' g dite.
‘M » 913- T Branchies et arc La- mort de ces animaux; lorsqu’on les sort de leur éicment, esUrne
branchi uBroc . sorte d’asphyxie: leurs lamelles s’affaissent, se dessèchent au contact do
l’air et ne laissent plus circuler le sang; aussi les poissons qui vivent le plus longtemps hors de
Peau, sont-ils ceux dont lès ouïes ont la plus petite ouverture et ne permettent qu’un léger accès
de Pair atmosphérique sur l’organe respiratoire. •
R IS SO L L E . 077
■ -r e s s a u t , -
RESURE. — ^ o y . Rogue!)
r é t r è c e . —^ynonym^ûc,Bapetissure, (Yoy. ce mot.L
RETS. — Nom des peLifces Caudrettè's qu’on emploie sur la côte de Vendée,
tapaplfr» C^ftRBïTES .
RETS A CROC. Sorte de petites Canières (voy.. ce mot), à mailles- simples,
de l’arrondissement d e,.Brest.
RETS A ROBLOTS. — Synonyme derHauts palis. (Yoy. ce mot.)
RETS ENTRE ROCHERS. ^L sp è c e s de petites canières ou Cibaudières (voy.
i®,e .môtLa^^fpées en Bretagne.
RETS TRAMAILLÉS.—^Sy^onym'e’méridional de Tramaux. (Yoy. Tramail.)
RETS TRAVERSANTS. — Synonyrpg.de Palet. (Voy. ce mot.};
R e t s t r a v e r s i e r s . — (YoyC Eralht Mttj
REVENUS DE L’EAU. kilomètre de canaux et cours d’eau rapporte.
f |f e é |p a r U’Étæt, ................... ............................................................. yr .
- ' fee^-erabotu^iuie,'. '(les&teuyns^rap,porteioe|)xipyiômèire.........................
Le k d om lp e de petits cours df^^^onmavigables m flottables, rapporte 28
Lfbe&ta] è d (ty ig ...........................7g
R e z z a j o . ^.AfonliKfioî'se de 1 ’Êper^æf^ffoy. ce mot.)
' RHEINLANCKEN. SAUMON ARGtHrC) V
RHODEUS AMARtJS. —. ^voynïoevïùHy. amèke.)
RHOMS. —j|S |m ;du Turbot, dans.ptqs|eursidépàrteméhts de la France. (Yoy.
TaRBofe)#«1
RHUMRUS. .jü ($$y. TuipoT, G'ràarsÿi)'.
RHUMBUS (Plçnroneçtes.y-jj(yo^:i, Bapbüe ) ,
RIEUX. — B v^QnymeàdA Gpbaudière± mol. ).'■
RIGOLES. — On nomme Rigole, en termes de pêche, un endroit d ’une rivière
où le courant, resserré par des bas-fonds on des touffes de_ végétation aquatique,
;% iyre.,m r ^ d ^% s ^ à e i» .p ^ jM à ;q n ^ p S i e n t de pêcher le Barbeau et autres
poissons analogues.
La pêche s.e fait à la. ligne à soutenir. On y tend également des je?«;, des lignes
de nuit et des lignes à grelot. (Yoy. ces mots.) ..
RINGARD. —-Çÿ&yt ^ÉGREj Pêche.)
RIPE. — Nom de l’Épinoche dans quelques provinces ; sur la Loire, au Mans
A tQ s lé a n s 'jS k te ^Y o -y ..' É p in o c u e .)
RISSEAU o u RISSAUT. —• Nom provençal de YKpervier. (Voy. c e :m ô t) Ce
qu’on appelle plus particulièrement Risseau, c’est un petit épervier dont les pêcheurs
de la Méditerranée font souvent usage, quand ils voient les poissons rassemblés
entre- les rochers on dans certains endroits des étangs salés'qui communiquent
avec k mer. Sur la côte de Fréjus et Saint-Tropez entre autres, les Risseaux que
l’on emploie, ont 3” ,50 de haut sur 18 à 20 mètres de circonférence. Ce genre de
pêche esL beaucoup moins employé dans les mers à flux et à reflux comme l’Océan ;
0h çréfère.is’y .servir de" filets qui pêchent s e u k io i f # lanets. (Voy. ce mot.)
RISSOLLE. — Filet dont on se sert en Provence pour prendre les Melètes,
les Anchois et .es petits Sardines. C’est une espèce de Battude (voy. ce mot), qui
peut- se rap^EGiSiër du Manet (fig. 914) employé pour les Sardines. Une Rissolle a
a u moins 6'5 mèlrcs de longueur.sur 8 à ’9 mètres de hauteur ou de chute. Les'
mailles.iën sdht assez serrées pour quelles anchois ne puissent passer au travers