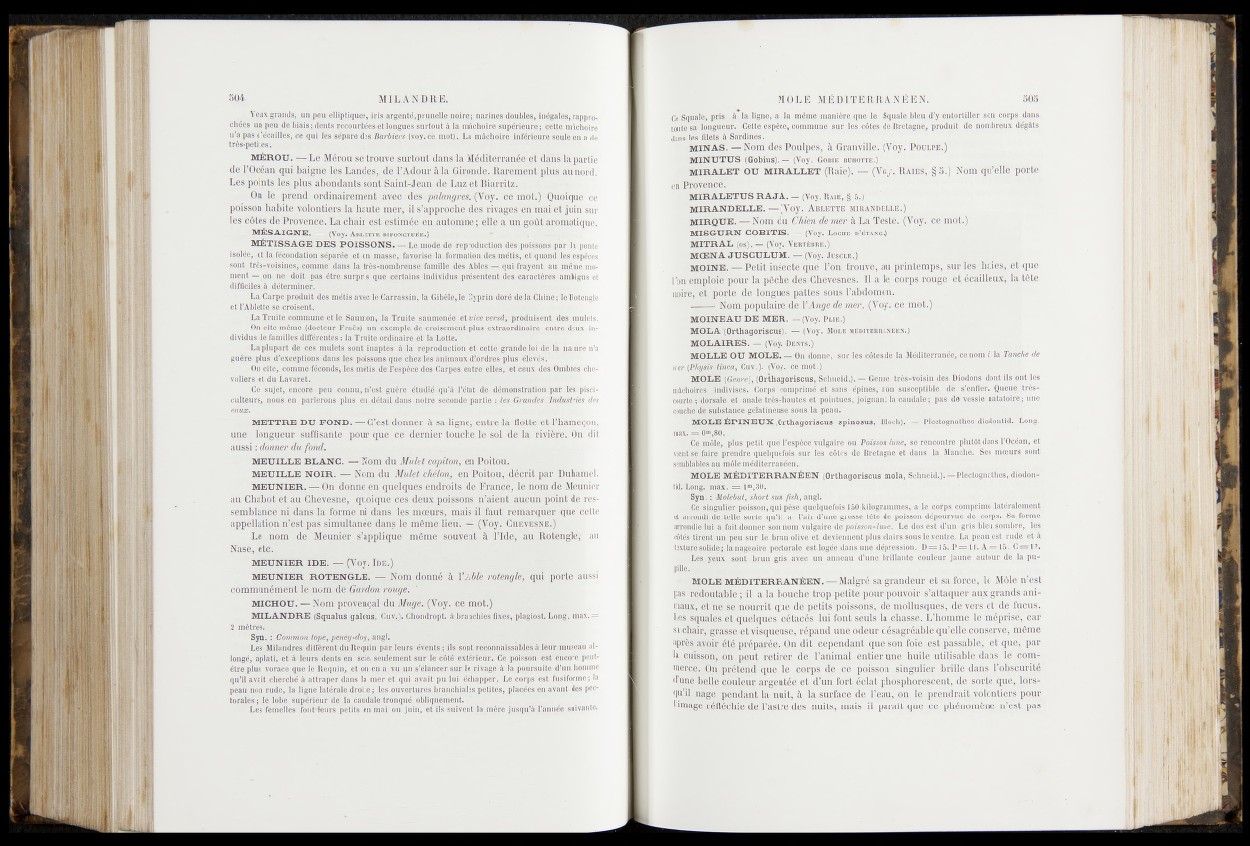
504 MIL A N DRE.
chées un peu déniais ; dents recourbées et longues surtout il la mâohcùre supétieure^s^s^ishoira*
n’àpas d’écailles, ce q’àtjfes sépare des ifarbiers (voy.ce mot)., tp^flHBA^teMrlenr^ v t p t a K p '
très-petites.
MÉROU^BR^MêbQffi se trouve surtout dans $ r t l r
de l’Océan <jui baigne les Lanrlgs, de l*Adguf rà la Gironde. Rarement/plusImffiorH
Lçs points les. plus abondan^^jnt SainirJearth^Ruz et Biarritz.
iUO* ôn*l|e-.prend ordinairement avec des palangres. ( Yoy.ïe6^mï)!?@#QÎqde ce
poisson habite volontiers la haute. mert41 -s’approobc*d|s.rivages en mai et juin sur
lé f côtes deRi-bvencé. La chair (gt bstilpèe en automne; elle a u^gOÛ^^^wAique.
J MÉSAIGNE. —|y|j!ny. à b l e t i e jppONexoÉE.) ;
MÉTISSAGE DES POISSONS, — Le modp.dQ.'Paprodu'ction des!poiSSonS par la .ponte
isolée, et la Jjépondajion séparée et en masse,-.faTorisoilarform^tioisdps>métis,jet 'quand ffi espèces
sontjj tr^sj,vQisiq.es, comme dans la.très-nombreuset'faïnille des. Ablas t—- qui frayent au, imAnjie rno-
ment— on ne, doit pas être surpris quejertasfsj jodivîdusSprésentenfede^MsjqtièîgbiEÉjçértgus et
difficiles; à détermineg..^-.
La Carpe produit des métis avec le Ckrrassin, la Gibèl.e,le C'Jpfibr'âor'é delà ChfnéîSIméngle
et l’Ablette se croiseflti |
La Truite communejeHè Saumon, la Truite gMmc^é^el; vice versd, produise^T^eg, raglets.
On cité même (docteur Fraësj un exemple de croisement jduAe^à^.majffi .uniittdeuy h*
dividus de familles différentes : la Truite ordinaire et la Lotfei
La plupart de oçs mulets sont’ inaptes à la reproduction et cette grande jwdc'la nature n’a
guère'ptes -d^xeeptions dans les poissons que chez les arjimaux diordres'pliB^KpIësl^Aî
On. cite, comme féconds, les métis^dpJiespèce.des Carpesientre-ollfs, et 'dêux ‘ d’ê^OnàWes chevaliers
et du Lavaret. " :
Ce sujet, encore peu connu, n'est guère étudié qu’a l ’é ta t de démonstration par les pisciculteurs,
nous en parlerons plus en-détail dans notre seconde partie : les Grandes Industries dps
eaux. u METTRE DU FOND. C!est donner' à «aligne, eifi^ito'fldtte
une longueur-suffisante pour'qudïee dernier tquëhUlIppihÆe la
aussi : donner du fond..
m eu il l e BLANC. -^Nom du Mvlet capiton, M S iii'.
meuille NOIR. — Nom du Mulet cKélontr®P Poitou, décrit p lÆ ^ ^S a e l,
MEUNIER.— On donne.en quelques Endroits de ljraffljS^t'S.iiniti dfMuiitpiiSg
au Chabot et au Chevesne, quoique des deux poissons n aiém .aüj/jjaVpôiiit dWi t —
semblance ni dans la forme ni daiïs lesjmoeurs, mais il faut, remarquer B *® IR
appellationln’est-pas simuitanée-dansrie même lieu. — (VCpjBoesNEr)
Le nom de Meunier s’applique même souvent W T y g /au ïtoleiurl^ à»
Nase, etc. '
MEUNIER IDE. — (YÔy. ÏDE.) -
meunier ROTENGLEr-rOSom. donné & YAble rotengle, q u iSE ^ eB Éi
communément le-nom de Gardon rôugè. '
MICHOU. — Nom provençal du Muge. (Voy. ce, mot.)
MILANDRE (Squalus galeus, Cuv.). Chondropt. à branchies fixes, plagiost. Long. max.p=
2 mètres. .'
Syn. : Commori,U>pé^èney-dog^_zx\$.
Les Milandres diffèrent duJRequiiî par leurs évents ; ils sont reconnaissables à lèTïrfquseau #
longé, aplati,'et à leurs dents en scie, seulement sur 'WéSt^éii'érïênTl Ce poisson e « asnoffre peut-
être plus vorace-que le Requin, et on ep a vu.un s’élanget-sur le.çivage à la poursuite'
qu’il avait cherché à attraper dans la mer et qui avait pu lui échapper. Le corps est fusiforme ;p
peau non rjjde, la ligne latérale droite ; les .ouvertures branchiales petites, placées en avant dM.pec-
torales; le lobe supérieur de la caudale tronqué obliquement.
J Les femelles fonWeurs petits ‘en maPoa jubi, et ils’suivênt laanère jusqu’à Tannée suBbo^
ÿ ^ O L D M É D IT E R R A N É E . ' S il
( i SquabOvBST'l J fypla-.rrir. m q p iisn utei^inu Je bqi^&JJleUjAj.o^iUl^^oiijjXCirps.^laijs.,
./SrlSnSlongiIi uoÆCitlLè-fiftPèrft. i cmni'i ie >ur les^ntes^-llit-tuene- nûbfflfih^-rbimbrpux dégâts.
MINAS, g? ili'ej pyojv? WrLrifffiffij
MINUTUS (C rO b l u s ' ' • (j.cÀÎïe e*ühOttP.)
MIRALET OU MIRALLET . 'HAiÉ^^Slf^jn qu'elM'1p^r®!
i r o M g 11
MIRALETUS RAJA. A' (Voy. r, jgNwSP
MIRANDELLE. —
MIRQUE. —^ m à ],a
misg u rn .cobïtis.
MITRAL •
MOENA JUSCULUM. o\ t RscQ.);
MOINE. Pêl i ’hô’n? front
tè tpi
nrMn l ^ i ^ ^ e d ‘.ous^rndij-jnen, .
populaire mer..a Vv-^ j^ ^ BWi.wSwj
MOINEAU DE MER. -^(vlijv
MOLAv(Orthagoriscus>. -^ftWy.-Moi.E MÉDiTEKRANiîEN.|^H
MOLAIRES. —
MOLLE OU MOÏÆ. — WiffirlniiM^vugÆ^ ^ l d i 11
1 j*, ‘Ci®s5^
MOLE (i^me|, OithacoTiscuSj-.Si linyid.;j,^^^^M tn'-i-Uÿjhçu
ma liuS t imli ‘■aiis eu 1 iiP^jMwa^Sp^OütfedfV^ on tu
:fflS B o K ilp e % i n ~ d b ' I pbintuSC'VnSrijiihfdjit nul éü.miiy i r o m W B i " ^
uiu j UiClni péau._ .
MOLE ÉPINEUX ,0rthagoriscus spinosus,^lijuPh;.f,’:^ ^ ^ ^ ^ n if f ^ v P ^ ^ t id . Long..
max. = 0m,80.
Ce môle, .i)Kj.s. lû bt^pÆl^pçftî vu 1 aairc^S iÿ".liETol i@ ML(RAçniLCt
' ieetse faire prendre cachiupdfe. sur les côtes de lirej a gu c e t Sa <-on r
-i-mluîrlaSjï&'u murojncdjti'rrâuci'u. A’
MOLE MÉDITERRANÉEN (îlrthagoriscus wla,^^itidij!®H^™BaT6<js: ulud^n-
!m S .‘
Syn : M:&e'àiit,^hoi:t sun fish, a6 gk‘M
Ce singulier poi s'pt;qpip(s( quelquefois 150 kilogrammes, a le corps comprimé latéralement
et arrondi de te lie sorteittuiil a Tair, d.’une grosse^ tête de poisson dépourvue de corps. Sa forme
drruiii&ittS^a- fuMopgKP,sson. u;.Q^sVqlgaire dé •p&isson-hmel Le dos est Mur gus’j b l e u s 1 j.
■ utu^ j ivrjtAiÿn pUiinsuj. ln.dirpTjfJ.lyajet.deyfan^ient plu.- {.laifs^njgffl^nhie Le [içami/jl.
texture solide; la nageoire pectorale e s^ o g é e . d a 1 ‘ C = 13.
i^ e s j^ u& J s o ^ J ià u ,g r is avec S Bm m o t t T■ 1 neJi'rjjÜgjn ^ ^ ul.eipi)
pille.
MOLE Tvrfrnr r TiyRTt akté f n . — Mnlgi o a 1 grandeur
PM 'f®^fflfibl%4!rh>M èoùGh'fe trop p’c® fê ^ k r^ ti# iiÈ ^ Ê 6oequfeiM®;â>girauds ani-
rhl^ ç 'CTmtfs#Ttdt]mt aüe^^betit^joî^^ramTOll^TOes, de ters
Lfes,.s(/jaa!I|s et quelques q^VceÇ,lui font sgc^, la clias.se. L.irôjntu.ff !<’ mépnf^ffAr
sa rhaiP.>*gr^sse et visqueuse, répand une odeur-Tléhri^qédb 1 ejqu’eiK cijnsiy .e^mêm.e
été .préparée. On diteepemjant aM to i foieû.^L^‘^m l(i..^af|ju1qw par
la .cdj^oTL^mLriünl |qtirér de, l’animal èniter uAéÆ^WamKRla'hhins'
ffler^ ^ pn' prétend que le cùrrs. (Æ/^pioisson , s i n g 11 ker .^b rl ^ t^ ^ ^ ru b s c u^é,
d’une belle couleur açgentée et /ÉumlnraÆlM.n^^nl ^ ^ eenf, V|~
liSikaage. pendantJâ.nS , j à la surfacftrdfeW{an -qnr^Iei|nrendraj|^m|ont)ers »uqut
l’image réflëctae'4 ç4 ’a:st^@^^ ^,binais il parait jru^ fe ÿ d^ u a néne-' Àe|t pa.s