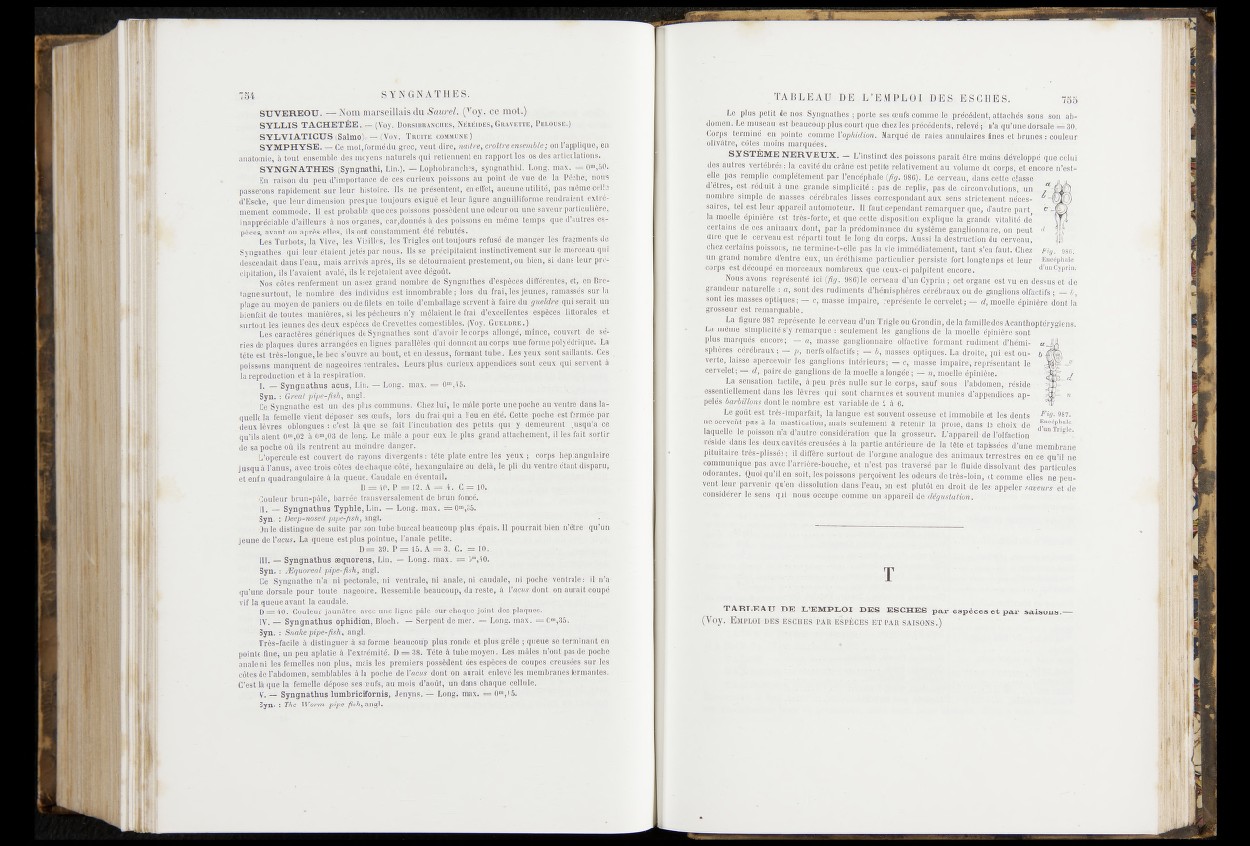
7^4
SUv e r e o u . — Nom marseillais du
SY L L IS TA C H E T É E ,
SY L V IA T IC U S iSalmo). —.( Vqy. 'IjRUip commune.)
SYM P H Y S E , — ffa wmf. forme da_gi Q C t - ensemble; onLaj®ligue^ea
anatomie, Omit ^ n s e a i b T e j i a r a r S s qu ? T ^ »aan?eii rappoitles. g& de-- a ^ ^ i t a o n ^
SYNGNATHES (Syngnathi, LiJ,).*— ffdpmghrenblres^^
i ^ m ? S ^ I ? d u ?^^d'împiûrtàSSê ifêfi&ès. ‘ <Éïîb u x ' p ’de viiè ’ÏÏè1 w^êcheymoli s
passerons rapidement sur ‘leur h'ilsto'lfé.^tl^ir-ïe.“priisefite’rit, en effet, aucune utilité, /pas même celte
d’Esclie, axigaè.àujj&dtojBrc anga-UliteÉi^^Mieflt .extref
w s s è d e u lurm odenHgmqû\savhi; p^lioulièîe.
inapj^MTOl^d'aliîü^ 1 nos orMWffijio iirfé s à,Vl^^ôl^DnTên ™ K"temps que d’autVes'p\ z
pècés, avant ou ?àprèk el fes^ ils Jonucon’Sfacoïnentréte rebutés.
Les TurbotsflH'Yï.vé, le^ tlitfêM îS ^ fftagle J onffe^joû¥si¥lfiïsè BèbSâhg^ÎHSs^ï^Sjmerits de
SVtign^ffes jaai'leur etaienLietés par iffias^ D^sejia^oibSaieBt instinctivement suptteïtftroeau qui
§ H S g [ h h S S h^ après^ils &§.'désignaient p r e s t e m e n t , l g , u r prtdégoût.
îv ^î§S^te%MnférmêWf ’ik^feé«fgf«§fii nombre’ de Syngnathes'’d’èspèbesJff^iffiMï^eèf |n Bretagne
siîrdini le!nooeKr&idës infltvt^^'sehinômBrab^?lors^SJffài^lêferjêiïnë§, ra ôÀssé s^S la
‘■ptep’bu moyen de ppnters/ou de filetei en toile d’emballage-serjî'sn^ài ifey-ei du gueldre qhMeîqlt un
Kirinfau ^ttni»to.g|r.tnaB;iares. shifes’^êsbetfrs .-n’y mêlaient leffraiyd^^ÿe^tfes espèces. Iijj^ïales, (jjl
surtouMes jeunes dendejux esnèces, s
" Les caractères genqrigkes de'SyfenMtms sonrdbmffl^MGps- iitlon^'^rt^{_convert sériés
de plaques dures arrangées en lignes parallèles qui ’donnent au corps Une forme polyédrique. La
tète est très-longue,le bec s’ouvre au bout, et en dessus, formant tube. Lesi’ÿdüM^^æîl.fiiîpISII^
poisstemanqaentid^nageqires.v^ralesvUjeiiiSTafis. curieux' appendices soàt,t t ^ M i É ^ g y
la reproduction et à la respiration.
I. — Syngnathus aous, Lin.' —^Lb'ng._ Max. Om,‘iSTfp
Syn. : G r é a i p ip e - f i s h , angl. ' “
Ce‘Svnguàthe est- un-dés-plus communsv-Chez lui, leinftldpôîte ufi&poclïe^ü yé®r1r d®8® i
quelle la femelle vient déposer ses oeufs, lors du frai qui a lieu en été. Cette poche estfermée par
deux lèvres oblongues : c’est là que se fait l ’incubation des petits qui y demeurent jusqu’à ce
qu’ils aient 0m,02 à (Jm,03 de long. Le mâle a pour eux le plus grand attachement; il les fait sortir
de sa poche où ils rentrent au moindre danger. '
L ’opercule est couvert de rayons rlivergenfs : tête plate entré'les yeux; corps lieptangulaire
jusqu’à l’anus, avec trois côtes de chaque côté, hexangulaire au delà, le pli du ventre étant disparu,
et enfin quadrangulaire à la queue. Caudale en ’éventail,
%=4P.
P*' Couleur brun-pâle, barrée transversalement debrülf,foncé.
II. — Syngnathus Typhle, Lin. —‘j/ong.-mâxi -<s= 0™j351
Syn- : Deép^ridSëd pipe^fish, angl. - -
’ fliilii ïttiMJ^jgfliTiferiniîit'iinôdfr wn tiïbe/imcctfl beadêoup plus épais. lijpquri-afitbî^ji^TOiq-iifnn
jeune de l’ucus. La queue estplus pointue, d’anale petite.
K g g p . 1*=^ 15. A-=^ 4.
HL — Syngnathus æquoreus, Lia, r- Long, mai. jMa&ift. :
Syn. : ifl&jfforWfpipë^fàli, ângL'
Ce'Syngnathe1 n’ârni péetdraîe; ni' ventrale, ni anale, ni -caud.al/^id'iiôbhe1 ventrale r il n’a-
qu’une dorsale pour toute nageoire. Ressemble beaucoup, du reste, à l’açaf dont.nn àuraiftc’ouipë
vif la queue avant la caudale.
D = 40. Couleur jaunâtre avec une ligne pâle sur chaque joint des plaques. •
IY .— Syngnathus ophidion, Blofeh. — Serpétltdemer. -2-Long. max. = 6 ” ,35.
- Syn. : Sftâkèpipe^ftsti, an gi.
r-v-%^-igepp,;#'iiSî»^^%sâ:if®iaipbiÉiaee|ip/,ptà«-vonde'®tfplûé'grête:^|^d^fl^«tiW!Pi^M;
pointe fine; un peu aplatie à ^extrémité. D = 3fi.iTétô â tqjjeimpyen.tLes mâleq n’oni; pas.dejpôche
anale ni fes femeÏÏês noiïjdus, mais les 'premiers possèdent des espèces de coupes creusées sur ^
côtes de Jabdomen, semblables à la poche de ljfftjr doôt on auraf^enleve les membrahêi férmâfltès.
C}ès't là que la femelle dépose ses oefcfSfwWois'il'âo'ôt, un dans chaque cellule..
, y. — Syngnathus lumbrrcifornis, fmgüfXA- Long. masji%= 0»,1S..
Syn- : The -Wgrm pipe-fk~h, ,angl. .
' T A B L E ^ p « ^ B ^ P L O I D ^ E S G H E |^ , Wê
. Le plus. le précédent, attachés sous son abmuse
®B»^nEreaaeo§^]®i'eouf 6 ^tîe Sbe^l^^p^cédéiili^ rëlèVé0- n’a qiÿune dorsale
^IJaLh- lC- j j j f iia’XL'■.de_inJa âiünulaiins fines et brunes : couleur
-olivafrSjSRxnioffi? muiqrfes^r^*
SY S T ÈM E N E R V E U X . — L’instmct des p o so n s parait êtie moinsm^ggloppé qqç celui
cLg^cjUtie-» vûiij^^.:)f.'davcdvdêJali‘c!àn*1 i^t'peilté iélTti^ment aixlinlmiirfiïl“(f^pV3,-ot emm gÉWv
ce^eau, SM'^êkîf^cSsleijl
d lè,tMs^est-réd.uit-àLuna_gKandé^j^Blmité(,C.pas-de,r,eplls, cas.d&Ièimîo.tLvoî.nfionti, q b ]
nomt)‘-e ^IP’idg i^ifflagÀ^rii^P.tiate.lisgfis. cftrxespondant,aûx sens stric te rn ém .-n S ^ ^ ]
" MaftBt.tghJ. a.BPt3yéfl r- ?Hf l ' à ? - i|i *<-r fflM^^d’autre .part.’ ]
c'il ej(MS q|tt'e.di®o,^ltion grande vitalité
certains de^ces ^ i^au^^TO^,pS™rm/dnffiillânêSW système gÿi'g^onnaire, ^ « )êu t -I
^ ® P ^ Ttr ’dh^eôpsi Aùss?lamlïtMicfîoh*(iù çterv§&,'|
^^prramEB.Qû’gims; H tawnliie;te| f t r «as. Vv?CT]^mQlïSftiri^nt: l ant^’wfeh1i.*^i«r
j^ t.g l’andmqm.bfe (Rentre’’eùx; un éréthisme n û‘i't 7 i J 1 r w iïejjo rt Iongîomps*7 t*ïî'iii f P
IjSflBi* r®|i^^^P^Àïftb3ie®®iPk miurtïrot®BTwfi^i paip.itr njT ........... •
Ci'*’!
Encéphale
NaWOTonaJgtf^bAéiic^§l^^5^ 6 !)le wvear^^^fgyfrm „ («'t*organe ■ôÀ- vu-oû 'de>«'iN et^lL:
d hémis'phéres ou- de gânglidhs olfactif^; -^ 'è
optiques?—t e; masse’impaire; r'epïé^nfe Lé’cervelet^ rfy moelte épjpièré dont’lk
"gï'0.ss eut" éspoeruàrq^Be-r- ;
c Laîfl^üre le‘cerceau d’ungtf^gléoij^ ^ m waelafamilledÉAéàntihbutérVMpfi«'
: :■âenlem'ejDtles"|^)grfôiis Je la ninôlb'' é p u ^ r ^ i iR î ^ ^ i i
|pj,bs marqu^^^æ^ïxi'q; ifiabse ganglionnaire’ oll^W^* ï^ ^ 4 ié ôidimenb- d’hemi- «_M- ”
B ^ (,1>!1ÿ ^ ^ lf f l i ^ f ^ ' ,'‘l'1P^~’ltl^<1^ s';^^^~?m%ss~eyÔptîqu‘^ÎLa;droi'te,,qiS^ébibu-
^ - | 6’ inférieurs ^ massé impai’re^&jif'és'é&tâ'&t1 le I ^
^Rveléf;#^-d.v.pair^deïganglio’nsciîêr’iSm6Mê%ilonÿ^è^'^S^^Velle'ép5iirpr(e . ' > : ^ ^ 7
^alSSBi^<î.11’ *;ao'Jî?’ 4 peiyprès nulle'sur. le^corps, sauf ^oUs^Labdoïnen, résidé - ?
da^ït^TBwaPÇn? Sw^afnüeb et’stfu^ent'miàiies d’appentoM;.aptw'j n
ipples friab le -de 8 à 6. . ' ' i f
bu L| gow%t très-imparfajl,’ f&lffiffi'&'exl souYèïiTosseuse ‘èl immobile et Ies-dents • ■T’ig; ?8’?D'
•nWerveStdpas à- fâ^mastic'attua\ mais -seulement à retenir la j|» ie , dans fe-cÉo* de ,^cépha]e
' 1 '-Fconsid:êralion',çpie;la’ grosseur.' t ’apjîareil'de ToIfacKon “nTrlg e;
Bide^tM-TOdeux cavffilsc^^éesîà la partie antérieure dé1 la tête>cfotcrpissées-d'tae membrane
Pituitaiï^oe^glfc^ée s’ai diffère surtout de l’organe analogue des;animgux terrestres* énf ce qu’il ne
communiÆe®pàs.a,vqc.Pàmère-bo'uehe, et n’est; pas traversé-ptikle fluide dissolvant'dés particules
’dalqi'ante^ftaô3tquiillfèn.‘*aOi.t,*lespoissons7yeroorveht les odeurs Je très-loin; et-comme elles ne peu-
^tie'uiïAv'vntP'îqa’en ckssfflatîonf dans'ïèah, on est plutôt eJ droit-de les appeler saveurs et de
»igfdéreJle seusiaqui»'nous-'oècàip^tdlflîrfé. nn'appareil'de dégustation.
T
TABLEAU DE L’EMPLOI DES ESCHES p a r espèces et p a r saisons
'(\oy. Emploi des'ésch’es'par espèces' et par saisons^