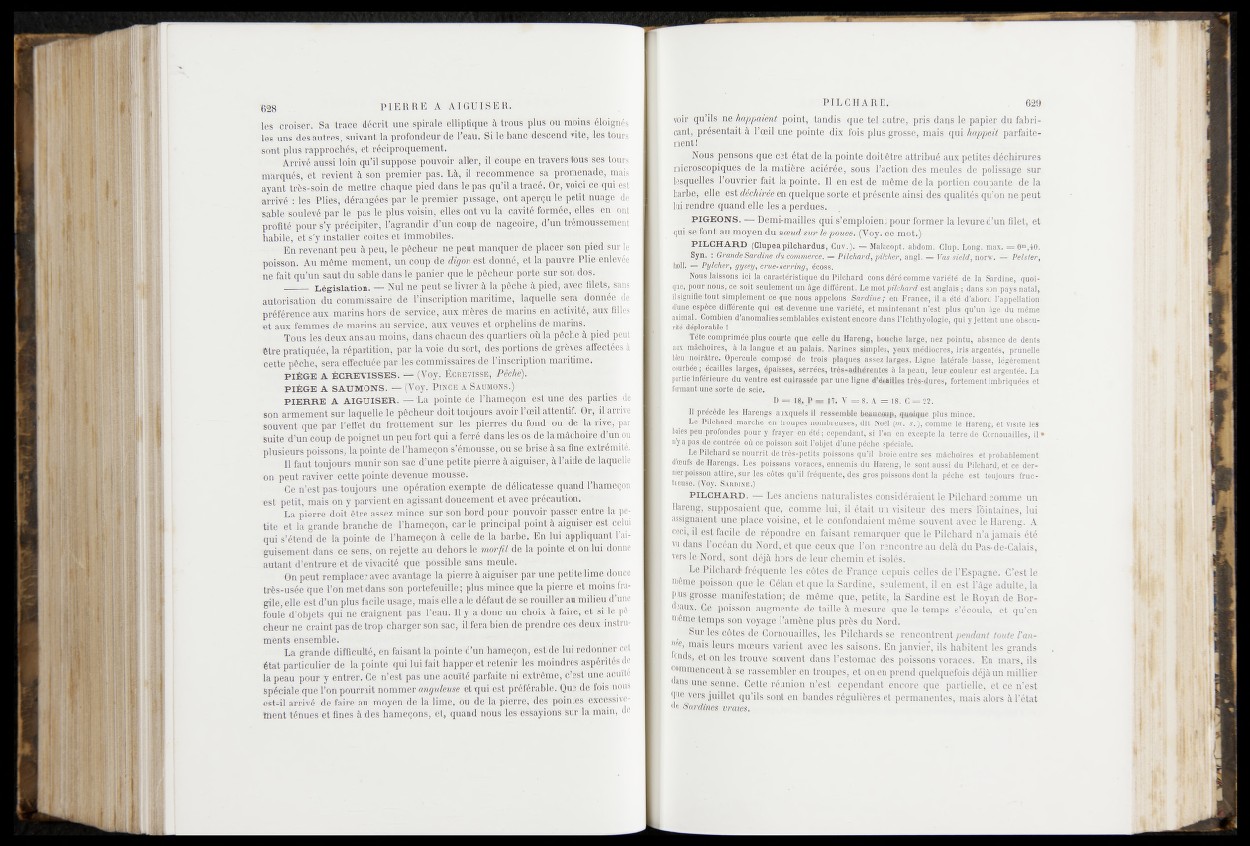
B28 PIERRE«A AIGUISER.
les -Bî'oisëT^ SalaraiSe à-trous pltæriK moins |l§ignés
les uns des autres, Suivant la-profondeUrde l’eaü. ;i®lebauG ‘descend Vite, les tours
sont plus rapprochés., 'et réciproquement.
Arrivé aussi loin qu’il sttppsfé pouvoir aller,^Éoupe. en trSfers tous ses tours
marqués, et revient à son premier pas. Là, il recommencé sâ promenade, mais
ayant très-soin de mettre chaque pied dans le-pas qu’il 'a tracé^G®, voici ce qui est
arrivé : ies Plies, dérangées*p&wèê premier passage, (M aperçù le petit Otage de
■sable soulevé par le pas le plus voisin; •èHés*'ont formée; elles en ont
profité pour s’y précipiter, l’agTandir d%tf%“o'up;'de nageoir-e, d’un trémoussement
hahilft, et. s’y i nstaller^oifesdgt? immobiles :■<' " 1 ” ” ■
En revenant peu à pga^le'pêoheur^ne peut m|iKCp3er:dê^ldSS,rJs®n pdMïiir le
poisson. Au même moment; u f i'c d l^ e digen esë*d%nn>é, et la paierie* Plié eii-evée
ne làit qu’un saut du sable dans-fejpanier que -]td3p#ebi®^'o«e-sufe Sténfes.
. Législation.^ g Nul nepèbé-sefl^rer -à' la pi&^avec 'filets,* sans
autorisation du commissaire ‘de rifi^lpigtion maritime,' - ifâcpîëM'é+sera âÔÉ®fe de
préférence aux marins %ors'rdeeservice ; aiÜHÉ&ffes dwfeârms’én a’etivïté^dxjples
et aux tommes de marins au service, afux vewyelT'&t orphëlfdltflfe mèrirîf. ' '
Tous les deux ans audMïife^dams ëÊdcunMés ffagMëri- p | l|g |# è ^ jp ffe d peut
être pratiquée, lâ répartition, par texfoie du sort, i
cettfc pêche, sera effectuée pan le^&Ommrssai^ld^I’àÉ’criptiO’n maritime.
PIÈGE A ÉCREVISSES.
PIÈGE A SAUMONS llp fT ^ y . ' PlN
PIERRE A AIGUISER. —'La pain t c ^ ^ ^ ï ’dU) eî î îdM^s^pgr - fei ^ #
son armement sur laquelléie pêcheur^i^iifOfe#^®î#|fei'Kttentif. 'GrlK trriŸe
souvent que par l’effet du foottemenWiïtej l s ^ 4 |^ e ^ S # t e d ^ » h ^ W 4 - p a r
feuitrd’t a coup de poignet un pêu f o r t - |^ a . f d ^ J d a ^ l '^ ^ ^ “ï § ^ t e # e jd m < r i
plusieurs poissons, la pointe de l’hamecdn s’émousSeS|ge M|ëpi%a fine eûffthité.
Il faut toujours munir son sac
oo- peut r a riv é c ^ tte pointe devenue -ÉàÔBpgë«
■ Ce n’estpas-toujours une opération exempte* de délïGâ?(fesse_ quand Ffflttçon
est petit, mais on y patvi ent en- agissant dOÛCement et-
La pierre doit être assez mince7 sür son bord p o p a s s e r ^flil=»Mpe-
tite et la grande branche de l’hameçon-,-car le prinmpaî'poiBt à aiguiser e s tf e li
qui s’étend de Ta pointe rÜ@ l'hameçon à Belle de la barbe, ®& M appliquant l’aiguisement
dans ce seüs, on rejette du dehors le 'morfêl'àQ la pointe ëtêm ip> |p n e
autant d’entrure et de vivacité que possible *sâPs meule. —
# a peut remplacer avec avantage la f ie » e à aiguiser parteaepètiteiiJpTOUce
très-usée que l ’on met-dans son portefeëiil^ plffis -mlae.ë,q®e 1® ptetete fragile,
elle est d’un plus faciiemsage) mais elle » te iéfàttt dêaeflteSi® au»iI%uPûne
foule d’objets qui ne craignent pas l’eau. Il y à do&c un choix à faire; et r i te pêcheur
ne craint pàsrie trop charger son sac, il fera bien de prendre ôès deux iùstru-
ments ensemble.
La grande difficulté; rii faisant la pôinte’d’uïi hameçon,-esWë lui redonner cet
état particulier de la pointe qui lui fait happer et retenir les moindres aspérités de
la peau pour y entrer. Ce n’est pas une acuité parfaite ni extrême, c'est une acuité
spéciale qtie l’on pourrait nommer anÿukuie fet qui est préférable. 'Quede foisrious
estril arrivé de faire an moyen de te lime, ou de-la pierre, dès pointes excessivement
ténues et fines à des hameçons, et, quand nous les essayions Sur la maih) de
PILCHARD. . 6 2 9
voir qu’ils np happaient point, tandis que tel autre, pris daqg le papier du fabricant,
présentait à l’cpil une pointe dix fois plus grosse, mais qui happait parfaitement,!.'.
Nous pensons .que cet état de la pointe doit être attribué aux petites déchirures
micr^s.cppiqües de, la matière aciérée, sous l’action des meules de polissage sur
lesquelles ^ouvrier fait la pointe. Il en est de même de la portion coupante de la
barbe; : elle eri^eoAàm-len quelque sorte et présente ainsi des qualités qu’on ne peut
lui/rfpiné. quand elle les a perdues.
PIGEONS. — DemirmaiUes quis’emploienl pour former la levure d’un filet, et
qui,sefont au moyen Axx'ncBud-ivm-le-pouce:-(Voy. ce mot.)
PILCHARD.((Jlupea pilchar dus, Maîaeôpt, abdom. Clnp. Long. max. ==0m,40.
Syn* : ^ande SàrdMè â\conittieree.‘— Pilchard, piïeher, angl, — Vas sield, norw. — Pelster,
v, gy^i/j, cr'Ue-hernfiÿ‘, écoss.
Nous laissons ici la caractéristique du Pilchard considéré comme variété de là Sardine, quoique,
pour nous, ce soit seulement un.âge différent. Le mot p ilc h a r d est anglais ; dans son pays natal,
ü signifie tout simplement ce que nous appelons Sardine; en France, il a été d’abord-l’appellation
d'une espèce différente qui est devenue une variété, et maintenant n’est plus qu’un âge du même
animal. Combien d’anomalies semblables existent encore dans l’Ichthyologie, qui y jettent une obscn-
■ 11 ffifeidorahli.1 ' '
Éjaite eeûrte qqq #elle du Hareng, bonçbe Igrge, nez pointu, absence de dents
« i ma^k0'ires, à la langne-et an palais. Na/incs simples, yeux médiocres, iris argentés, prunelle
MXo>râtrer.Opei^ule--ço3ppose de trqjg plgqjueg assez îargea. Ligne igférale basse, légèrement
c c ü î b » ^ lafge§t. ^gissgs,:4erree^ 'trèy>«diitfi$g{tf à îa p a u , leuf couleur est argentée. La
du «wfM est eqirgggée par une ligne # 4)»mag trlg-^gres, fortement imbriquées et
formaM ^ is o r te de-s.ci,e;.-•$.»
//6 |j||$ ,_ P „ t f . t — , 8 . A '=±'t». S » . .
II précède les Harengs auxquels il ressemble haauagnp-, quoique plus mince.
/i^H p ilo ffird .marche en troupes nombreuse* dir Noël (»?..#.), comme le Hareng, et visite les
bfflH^p^Qftmdes pour y, frayer fen^êté; cependant, si l’on en excepte la terre de Cornouailles, il»
il y a pas de contrée où ce poisson soit l’objet d’une pêche spéciale.
J tl|P i'chSr 8 se nourrit de très-petits poissons qu’il broie entre ses mâchoires et probablement
â’® | | | e Harengs. Les poissons voraees, ennemis du Hareng, le sont aussi du Pilchard, et ce der-
®P°te%ritira/^ îftîs& eètes qu’il fréquente, des gros poissons dont k pêche est toujours fruc-
tueuse. |Voy. Sardine .)
PILCHARD. —-Les anciens naturalistes considéraient le Pilchard comme un
Ha-F/^ ^ f e MOsaient. que, comme lui, il était un visiteur des mers^lointaines, lui
asggoqtefft une.place voisine, et te confondaient même souvent avec' le Hareng. A
facile dn répondre eq gisant remarquer que le Pilchard n’a jamais été
vu dansiilocéan d.usW.ord, et que ceux que l’on rencontre au delà du Pas-de-Calais,
vers^P®ï-d,, sont déjà hors de leur chemin et isolés.
Le Pilchard* fréquente les côtes de France depuis celles de l’Espagne. C’est le
mêmtj^@teson que1 le Célan et que la Sardine, seulement, il en est l’âge adulte, la
plu? grosse manifestation; de même que, petite, la Sardine est le Itoyaû de Bordeaux.
Ce poisson augmente de taillé à mesure que le temps s’écoule, et qu’en
même.temps son voyage l’amène plus près du Nord.
Sur les côtes de Cornouailles, les Pilchards se rencontrent pendant toute l’an-
m ’ m&is leurs moeurs varient avec les saisons. En janvier, ils habitent les grands
onds, et on les trouve souvent dans l’estomac des poissons voraces. En mars, ils
commencent à se rassembler en troupes, et on en prend quelquefois déjà un millier
dans une senne. Cette réunion n’est cependant encore que partielle, et ce n’est
qui vers juillet qu’ils sont en bandes régulières et permanentes, mais alors à l’état
u6, <Sar«àhes vraies.