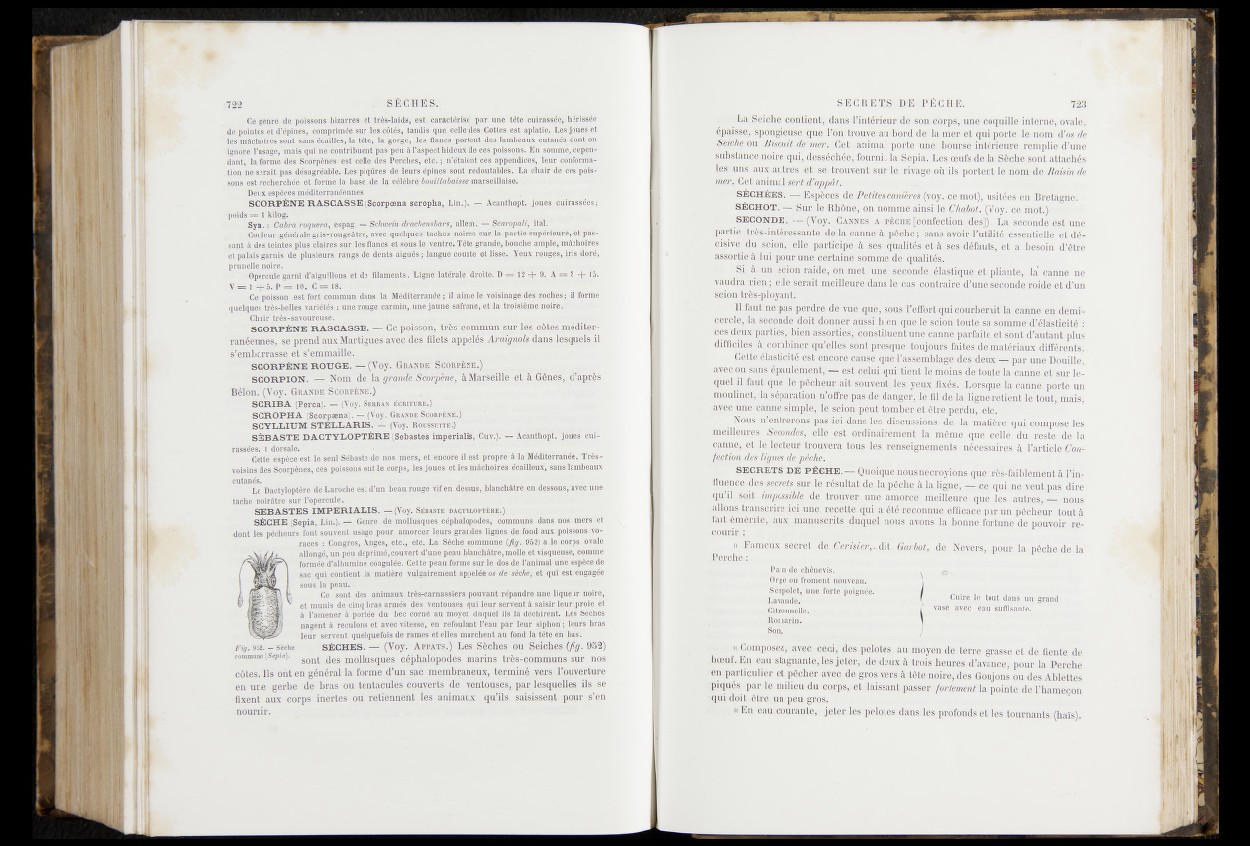
Ce genre WMEr'és et trèa-lal$ap.BBt. caMBtériBiL par une tête euir«8sé< ^h& « $ e
de pointes et d’épines, comprimée s,nr. lesyoôtég, tançy.s }<jua -cellefîes: Cottes est aplktlf^Les joues.et
les mâchoires sont "sans écailles, la tête, la gbrge, W fiancg .portent des, l^mhggux. putanéSjjjgg^n
ignore l’usage, maîsrqui ne confrihuent pas pVirÛ’àspeçXh'idëm?®'oès poissons.’Ën somm&xenj^“
dant, É&^BÜÿÜM*;est celle desPerches, etc. ; 'n’étatent’lîeï'appenâii^^OTrcol|R^OTtion
ne serait pas. désagréable. Les piqûres de leurs épines sonVîèdêntâldeli. l à .chair de c e s ^ S P
sons est recherchée, .et forme la hase de la célèbre b o u illa b a is s e marseillaise. ~
fieux! •espèces méditerranéennes.
S C O R P È N E R A S C A S S E (Scorpcena scpopha, Lin.). — Acanthopt. joues cuirassées;
poids = Ikitog.
Syn. : Cabra roquera, espag. — Sclnueindrachensbars, allem. — Scaropali, ‘itil.
Couleur générale gris-rougeâtre, asec quelques tachesurolres -sur la païtieisupérieure, :e£pas-
sant à des, teintes plus claires sur les flan«f absous le . veûtre,,Tête grande, bouqhé .ampïfiFmâûh'fe&s
et palais'garnis d ê 'p lum ffl^ ra n g s dé dents a'iguës ; langue cpurte, Yeux^ôg^ây Igjâ-dpjïé,
prunelle noire.
' *:©péfêhlegarni d’aigu ^Uhis’et de filaments. Ligne-latérale droite.'D = 12
V=5 h
Ce poisson est fort'commun dans l a MéditerranJe^àP w'mële voisinage. des Poches ; ûKEfâfiie
quelques très-belles variétés : une rouge carmin, une jaune safrane, et la troisième noires
Cl^iï'iiE-Siafeureiisé.
SCORPÈNE RASCAS SE. — Ge poîssoa-, tr%s-coiiimfi'n .s ty le s côtes m é d ite rran
é e n n e s , séq iïen d Icùk M artigueïave ç^de s m e ts ap p e lés dans-l^sgpiel^il
s’em b a rra sse e t s’em m a ille .
SCORPÈNE R O U G E . Y o y . XrRANDBT^ÔRPÈNE.V
SCORPION. —”fîô iû (le ^ grande ‘Scorpene, à Marseille e t
Bélon. (Yoy. Grande S corpène.) ;
SCRIBA {Perda]. — (Voyi Serran ècrjcture.)
SCROPHA [Scorpæna]. — (VofTGRÀNnç SeoRniNE.)
SC Y IX IUM S T E L L A R IS . — (Yoy. Roussette.)
SÉBA ST E DACTYLOPT ÈRE (Sebastes imperialîS, Cuy.) — Acanm^ruLjW™ cS ^
rassées. 1 dorsale." ^ I ,
Cette espèce est le seul Sébaste de nos mers, et encore il est propre à la Méditerranée. Très-
voisins des Scorpènes, çejs poissons ont le corps, les joues et les mâchoires écailleux, sans lambeaux
cutanés. . “ . ajjtaS • ___
L e Dactyloptère de Laroche est d’un beau rouge vif en. dessus, blanchâtre en dessous,'avec une
tache noirâtre sur l’opercule. ■■
SEBA ST ES IM P E R IA L IS . —(Yoy. S ébaste dactypoptère.)
S È C H E (Sepia, Lin.), —t Genre de mollusques céphalopodes, communs dans non mersjjpt- -
dont les pêcheurs font souvent usage pour amorcer leurs grandes lignes de fond aux poissons voraces
: Congres, Anges, etc., etc. La Sèche commune ( f ig . 952) a le corps ovale
allongé, un peu déprimé,couvert d’une peau blanchâtre, molle et visqueuse, comme
formée d’albuminé coagulée. Cette peau forme sur le dos de l'animal litre espècede
sac qui contient la matière vulgairement appelée os d e sèche, et qui est engagée
sous, là peau.
Ce sont des animaux très-carnassiers- pouvant répandre une liqueur noire,
et munis de*cinq bras armés des ventouses qui leur servent à saisir leur proie et
à l’amener à portée du bec corné au moyen duquel ils la déchirent. Lés Sèches
nagent à reculons et avec vitesse, en refoulant l’eau par leur siphon ; leurs bras
leur servent quelquefois de rîmes et elles marchent au fond la tête en "bas.
s è c h e s . — (Vi>y. A p pâ t s .) Les Sèôhlsjoü Seiches (fi'g. 952)
sont («tes mollusques céphalopodes matins ttès-çpaimuns, sur nos
F ig . 95Î. — Sèche
commune {Sepia). ■
côtes. Ils ont en {généra} la forme d’un sac membraneux, termmé%yera l’ouverture
en une gerbe de bras ou tentacules couverts de ventouses,, par lesquelles ils se
fixent aux corps inertes ou retiennent les animaux qu’ils, saisissent pour s’en
noumr.
■ La S|||^e©?OHtientj»da3is'>rintéBi|q^'(i(ÿv'son>èorps, unaseoquille interne, ovale,'1
épaisse, qui porte le nom d’os
une bQiïPSêtiâtérièure remplie d’une
subs|ane^iiQi.Re..qui,JiisMfei». foprnü^&epia. Les oeufs de lai^èofee gpnt attachés
ifrisjtaux- autels l e Y ,ni-v-agetr^i 1 s portent le nom d&■ R aisiné
® ©? .-> Qîetfâî^u ali seti^&ppTkt h n \
S É C H É E S . ,^Ël|Pe<|g d*èWefite&âwfoêpÆl&M'^Qe.motl.fîg&ééPm Bretagne.
Sé c h o t . — Sq#*|e Rhôné^bgfetdmé o.P mot.)
s e c o n d e . a PÊc%[confec«iqm.de^)>.#à s e c o n d e n t une.
ïpârtifi trèéAiitéî’ess.âjitéi def^ganhe.' Atpêehe’^ ^ ^ ^ v o ir'É ù tilité ^ ^ ^ fffie l^ ^ <$&■
"ciskeMu scion, PlaBarAfcrpe- à tÉp qualités et;‘A)‘;^Mîéfàuts, e t^B^pM' d’êtrè
a&sorjâ^lui p;our usiexifSjtkm'è Mimme de'lquplifes^l
p, Si a unHnon ^a^èjjôii met une/ s gsouifeb £ la s tiq l||e t pliante-^ia», canne, ne
y a u d ^ ^p ^ “^ ^ .s(iiPrti]:^^M.(hite daa^jjef( as contr tire dJnnesTConde roide et d’un
sg ion I. -
pàs perdre d'^g'ë que, sous ’^è|^^^i^êüT;berait IaJ'c'anne' en demi-
,V ,r c l|, ia ^qeoIVdôuio ^ ^ um ^^l^^bjën((p^û^Jr.Mq^)n>t(un(y^a4oTmn^ d’épsjkeité :
p a irt^ ^ ^m .-i^ f I ii^l S K Bl uc aiu^ p a-npe parfaite et sont d’autant plus
prdsgireï foujours’faites dématériaux différents.,
, i ^ P ^ ^ y i t é » tM^ o r ' ^ ^ sU'que l’^siemèlage des deux — par^nnÂ’u i l ^
^Éëe » s ^ ^ p a u le ^ f f ib ^ . est eefiai qui:tient le meinsiffu.toute la c a n n e l e -
j|bj|i£bri( uir&soii-vént) h s y^uv hx<te./B^'queia c a ^ lp ù rte i |
•m c ^ ^ S la ^ g ra tiçn n’offre pas de danger, le filfdfe Jadigne>êîient' le ^Out, mais,
^ te c unnîo^^simj11 cü lé s^m'p%ut tomber;èî^être perdu, etc.
n endropoffisppas iGt^aas Iosj discussions d,e la matière-, qui. compose les
rteeilIeg.^^^e<?ea^ ^ S P e 6 t ordinairement la même que celle du reste de la
■epsnnc, <’t ^ ^ p ^ fft|lio q y e ra tous les renseignements..nécessaires à l’àrticle Oon-
ifàeXiow, ç(ejn êche.
SECRETS DÉ PÊCHE. — Quoique housnëcroyions que très-faiblement à l’m-
f l , u f n c . e ^ e s , s u r l^ r ^ ^ J ^ td e la. péche_à la ligne, Tgï>ce qui^H^veutpas dire
*ïu’#P9ÿ')iTO0fs-z'^® 4 ^ trouver une amorce-, m^iljejÿcé que fI&s^-autres^ nous
recette qui a étéreçannue efficace par un pêcheur tout à
^%%|iéi3^paux manuscrits duquel nous, ayons,.la bonne fortune de pouvoir ré-
courir :
« Fameux secret de Cerisier,-, dit Garrot,, de.jMfevers, pour, la pêcbe de la*'
.PerchaB|jL
Pain d.e ohènévis. . . . ,
(i) Orge oo froment’ipmtiu. i
Sêrtlilttj'une forte poignée. / „- '
Lavande! î M M J tout dans un grand
.■ ..... ■ I vase avec eau suffisante.
Romarin. I
' Son.'
i^®^G®ïùposez, avec ced;ides pelotes au ngioyen de terre grasse e t de fiente de
bpeuf.En eau stagnante, les j,elèr, de deux à trois heures d’avance, pour la Perche
en particulier et pêcher avec de gros vers'à tète.noire, des Goujons ou des Ablettes
p y par le milieu du corps, e t laissant passer fortement la pointe de l’hameçon
qui-doit être un peu gros. '
courante:,: jeter les pelotes dans.les profonds et les tournants (haïs).