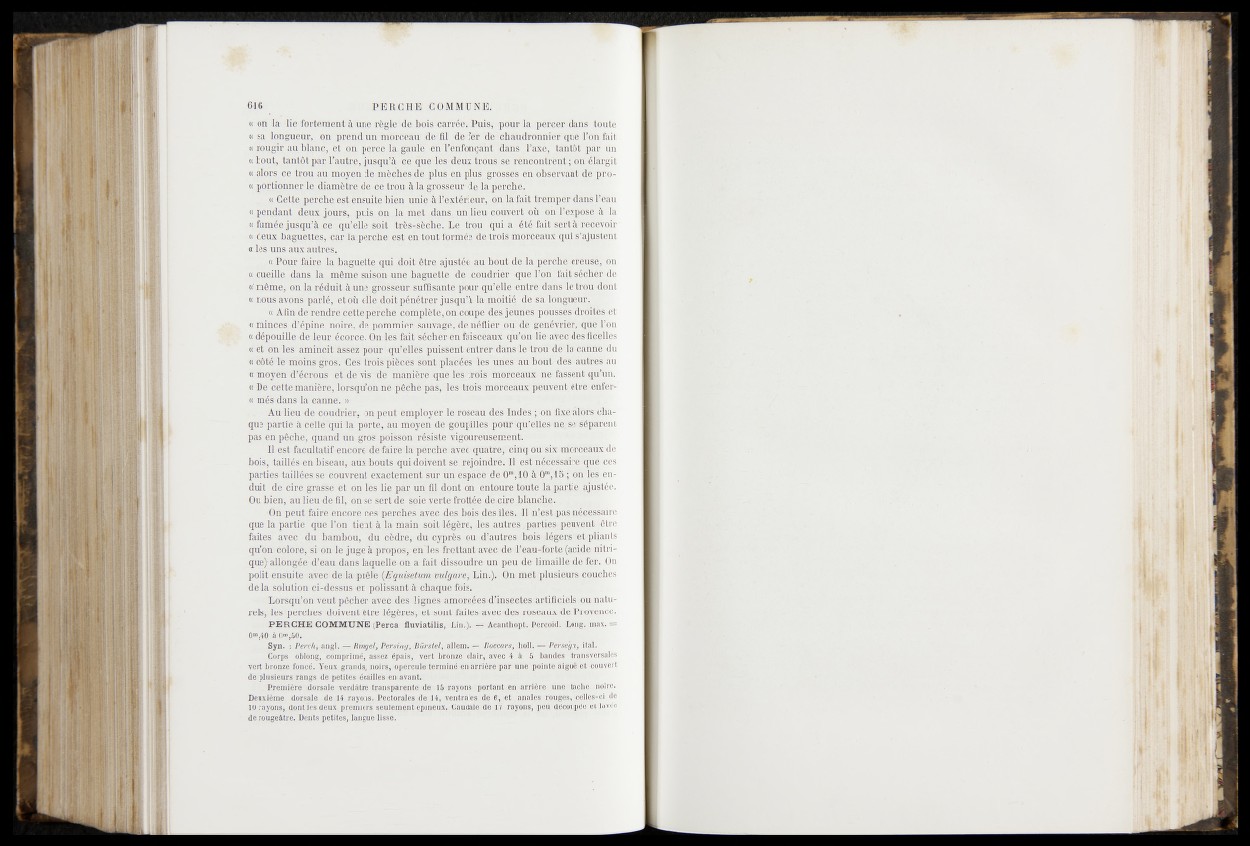
6i a PEEC HE 1 0 M M U E i
«: 0b la- die # p f y f / f > © 1 i r i a À p ÿ i f J ||! ^
a sa longueur, on- pÿéïiH^n^OTi^c^â|fjâfe1î;l‘ ^l^fer''dei'Oih^ftï|dSïifeSM^Mn fait
« rougir ,au hjanc,- et on, BCTçë 1^’gaulê'''! éfi VeSM^^nT^claris ,' l’axé, tantôt1 par un
« nou^, tantôt par l’autrg^uKOTlà^cé que Les d e u ^ lS te s e :‘rèn c ^ ^^ p n " s^Wargit
« alors ç eM ^ ^ u ^ q ^ e n Ju ê niectxte'Àfi'.WuOiSîP^^*i^rQsfe^ en onsejvam uC»dt0-
a portionher le diamètre de ce trouva I^ gH ^S g ^ uVlit perche?’ ■
- « i ^ te nerche.est, ensuite bien unie à l'e u éneur^ffli&iait trèmner"dansT’eau
« pendant deux la met .dam.-un heu. couy ert J(^ ^ n£F;e^.Q>?ft"- *8.
« fumée jqsqu’à très-'sàwÆly.e trou^mSUetê fâït sePt*à^æ^»oir
« deux baguettes, ,carla:perphe e§t en^fflt fermée'de trc^nmreeaiix qui’aàiiStent
«Lies uns al®%utres.
„y(rPour^ faire la .baguette nju^mlvetce .ani-ttée auA gu'kde la perch^Qjeu'Sjl A
«. çueille d,an| la^même sajgu|i^>neJ^'gwfAfe. de .'Coudrier æa ^Sm 'ïajt^sMm - cio
«‘même, onia,réduit àuiie-grôss&ùr^ufflsant^ffiufe{iÆelle*ontÆmaos^ujj^nraront
« nous avons na rm ^l^ ^ c ïïe c h ii nKnétrcr jusqu’à - s a lMmieurTV
« Afin de r ^ p æ cette p ^® e eomplèi i f t
« miqces d’éjM^^mrp,( de pommier’sauvagt^^^noflier obgu?^iaBnTq a ^ r*qH^]'■ gt
« dépouille de leur, éeft?of& Q^epfeâfWcineî1 u^lÿéi^ç'^u'g^mllès
« èt on les' ammoft^âé^z pour q û ^ ^ ^n^^nt^è nt m ffl (^lïtàJpHgc 111
«nèté'ïe'E&Ôms gros.®(l^' p l î ^ ^ f f t s uriés-'-'au’* u rR lr ^ P ^ P s au
6 moyen dJëcroùs et de'Vis Tte’mànièrovT(jdeÆ^jgrotg^ilmi‘éJij x fc-fMpS
« De cet le irhimn^^8^?«5piH‘ ptfchi^iaS^los-tif msî 3E®r#6î^^l&êfi^Wfeefe.fer-
« més dans là canne. -»
- - 'Àu'Keu’f e coudrier^ on peÆpmpl|&î|ftlafe^g^i des Indes ; on fixe alors chaque
partie^T|éîfçl^®porte,.'îS^ffiÉen^d^cf-upfllesip<iüi'',^^ffi^TL/'-SSÎfeit ut
pas éniggelïe^ quand un '^o^pcM§5m*:^^fe^f!ÔTar*fe%n,ôiîtf.
Il est facultatif eneere de faire!1£Çâcg]fetâvi't^fïS^(‘-f!lî'ni‘q (b1
bois, taillés en biseauj-aux bouts, qui doitent '■>
parties tailIéegse^ëbQvrenPêgaccèiiù'D^wTrmu^ n j^ ^ ü eïfTfQ.àiO1.11.1
duit de cife m®^e?et on' les/Ke p.âr un flj dqal^ ^ ' ^ aûr^TOÙtetlscMiiicJijÆé ■1 •
Ou. bien, aulieù'defil, on se'sert de soie vpiJ.c fro^ ü ft5gKQ)IJP^ijfe.>- • -;
■On peut faire/encore céi;%peEpiiesravec..|d<^&Q»des îlesuAfeâlfig^a^flSBg|aire
que M partie ^ ® .iÿ n tient à la main ^e&îautEeféPâFfe^PlW^lté^tre
faites’ avec du bambou, du cèdEê,- -du. cyprè§I®u,T;(lja'Utres»îb£|LSitl(égêrsS^ t pliants
qu’on colore, si'onde juge à'!i|fKq>ôS7'eiâlles-fr1o Itant ave.c^d'fe'#eau-foBta^fed!fc- gitri-
que)-allongée; d’eau,dans laquelle-on a-fàiï-dissoudre^fed^^e iimailiâérfer. On
polit ensuite wèeiiitelatqirêle {Equvsettmjmlgüt^, Lin-.-},- On mé^qïluSieurs,,Lâchés
dé la solution ci-dessus en polissant à chaqûê fois.- ;
Eorsqu'on veut pêpher avec des -lignes amod ies d’insectes artificiels.©s=pttu-
rekj les'percbes daiyeiirêlre légères-, et sont Jfeitefl'4^e®1i6fc^WS*d^w l t e ncé-
PERCHE COMMUNE (Perça fluviatilis, Ijin.]fei6& Acanthoi|t. Percoïd. Long. max. —
0m,40 à 0“>,5<).
Syn. : Perchfjmg].^JÎïnj/el, Persi/ig, Bürstel, allem. — Persega, ital.
Corps oblong, comprimé, assez épais', vert orôrize.' clair, avec 4 à 5 bandes trftnWôrsales
vert bronze foncé. Yehx grands, noirs, opercule terminé- en arrière par une pointe aiguë ét couvert
de plusieurs rangs de petites écailles en avant.
Première dorsale verdâtre transparente de lb-rayons portant en arrière une tache jjnoire.
Deuxième dorsale -de 14 rayons. Pectorales de: 14, ventrales de 6, e t. anales rouges, celles-ci de
10 rayons, do.ntles deux premiers seulement épineux, Caudale de 17 rayonsj peu découpée et lavée
de rougeâtre. Dents petites, langue lisse.