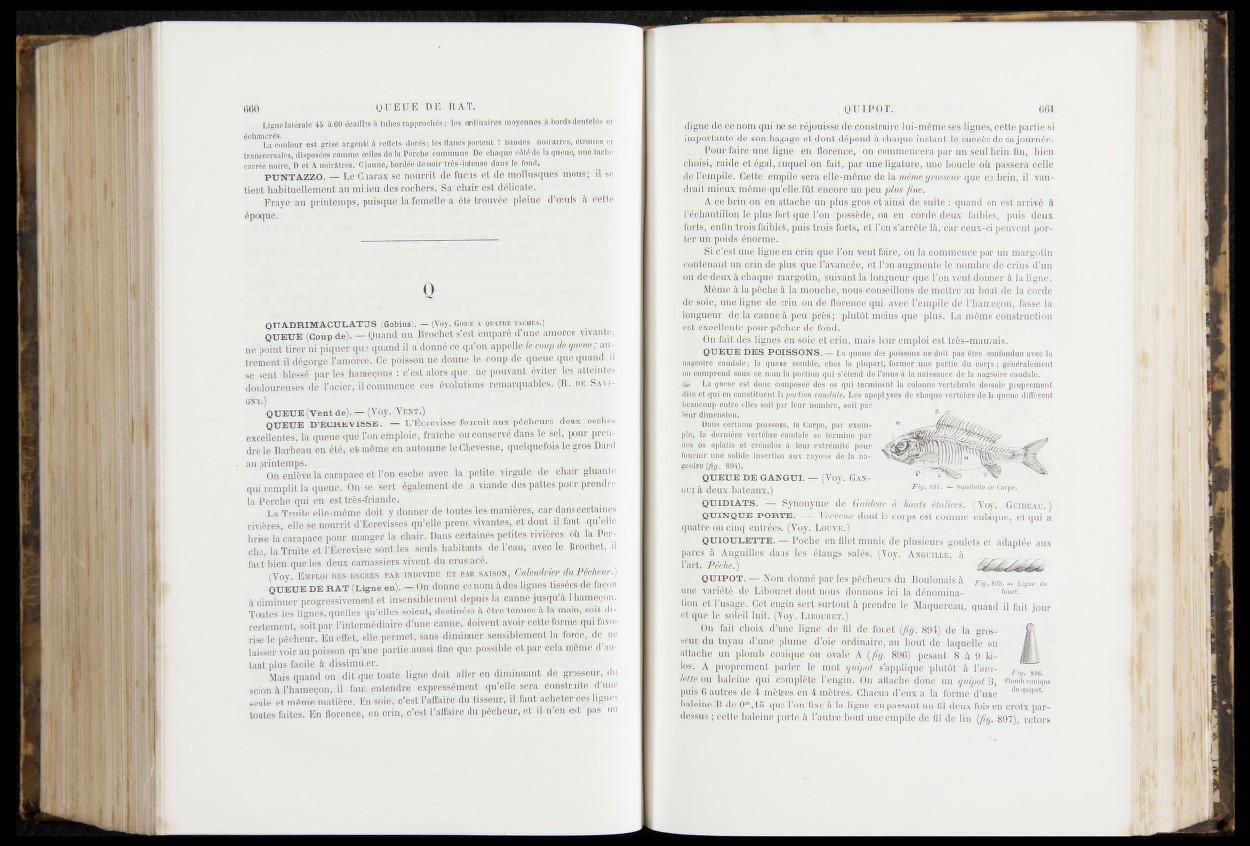
660 QUEUE DE RAT.
Ligne latérale 45 à.BQ éoalllqs à tufces rapprochés ; les ordinaires mqyetaesAbords-.dsàtélés et
échancrés.
La couleur est grise argenté à reflets dorés;'tes flancs portent 7 bandes _ noirâtres, étroites £t
transversales, disposées côHîïne celles de la Perche commune. De chaque cét4d§Ja queue, fifié tache
carrée noire, D et A noirâtres. Cqaune, bordée de'notr très-intense dans te fond.-
ptjntazzo. —'De Gharax se iibtirrit de ftietis- èi-
tient habituellement au milieu des rochers. Sa chair es# délicate. --
Fraye -au- printemps, puisque la femelle a été trouvée'' pleine d’oeufs à cette
époque.
Q
QUADRIMACULATUS (Gobius). — (Voÿ. Gobik i'fltTRE'fàâtES.)
QUETJE (Coup de). -— Quand un Brochet s’est emparé^d^uue,i^morce^i'|d.nte,
ne point tirer ni piquer que quand il a donné Q ^ q ^ ^ p p e ^ ^ w ^ autrement
il dégorge l’amorcei-Ge poisson né’donne le cOuplVqùeUe que q u p d gl
sè sent blessé par Les.hameçons^ ^e st a l o r s P Ü | E ailt' B h H h B B
douloureuses dè façiér, il commence ces; .Ayôlü^onÿ;^ ( f t r -
GNY.)
QUEUE (Vent de).J%(Yoy. Yent.)
QUEUE D’ÉCREVISSE. — L’Écrevisse fournit e j» |s .
excellentes, la queue quê l’on emploie, Miche oü‘e ô ^ j v l% ^ W e ^ ) m .prendre
le Barbeau eirété, efe même; en automne le GheVesne^fqjieL(|d'gS%iS^®8j ^ F
au printemps. ; . ■ .
On en lè v e la carapace et l’on eec&e; ay® la ^petite;. virgule de chair g.ïuan|e
qm remplit la queue. On se. sert également de la v ia n d e i,é ^ t# ^ ’PP&5:P^feJad| e
la Perche.qui eu esttrès-friande.-,,
La Truite elle-même doit y dpnner4d&,toutes-te§>maiéère_^ip|-5ld%fi#.^l®tI^ s
riyièFes, elle se nourrit d’Éerevisses qu’elle prend vivantes^ et doiîfe^l faut cp-’efie
brise la'carapace pour manger la chair. Dans certaines petites rivières où la Perche,
la Truite et rËcrevisse sont les seuls habitants de l’eau, avec le Brochet, il
faut bien que les deux carnassiers vivent du crustacé.
(Voy. Emploi des esches PAag&hiviDU et pas s u is O K , J 3 a t e n d r ie M d w & ç h e u i‘,)
QUEUE DE RAT (Ligne en). — On donne, cemom .àd&g.ligney tisséea-'dëmçûn
à diminuer progressivement et insensiblement depuis la canne jusqu’à l’hameçon.
Toutes les lignes, quelles qu’elles soient, destinées à être tenues à là main, soil directement,
soit par rintermé.didre d'une canûe, doivent avoir ëêité forriïé ^ui-îavO:
rise le pêcheur. En effet, elle permet, sans diminuer -sensiblement la force, de ne
laisser voir au poisson qu’une partie aussi fine que possible et par cela même d’autant
plus facile à dissimuler.
Mais quand on dit que toute, ligne doit aller en diminuant de .grosseur, du
scion à l’hameçon, i l faut entendre expressément qu’elle sera construite
seule ét même matière. En soie? #èst l’affaiiudu tisseur, il faut acheter tfes lignes
toutes faites. En florence, en crin, c’est l’affaire du pêcheur,, et il n’en est pas un
QUIPf iÉI 601
digne de:cenom qui.né se réjouisse de construire «Lui-même ses lignes, cette partie si
importante.'de sçn-bagàgetetjdont, dépend àoehaque instant le, succès de sa-journée.
«tm Rour fairemne -ligne; --em.floÿènce.æilm&Ommencera par un seul brin fin, bien
choisi, raide et'égal,-HUfU'ftl-on. fait, par, une ligatupe,:une boucle; oit -passera celle
de 11 empila', GetteLpmlp'ilésserar'èlfe-même.d'éAla ïB&Kie grosseur que ce.-brin, il vau-
dfifitjmieux mêm® q ^ |le ffilfes-dore un p - s ,
Aiêe-'Tfrjn.offl en «âtta’ch%ifoflW-,pli&gifsi ei? àinüMeJ*sùsite à quand on est arrivé à
l&giyutàUâÿletÿûsfgr^quedî®n îpossèdfe£(o® ’en "c^drfdeûi^faibles, puis ®épx
'#Hn'f®fis'faitteSvpuildrois fo»W,' tJelf^mis'’ai'rëte là, car ceux-ci peuvent porter
un pbi'dsrénorme. ^ -
* Si c’est une ligne en crin que Ton veut faire, on la commence par un ffiargotih
'ffigéJî’àntmàtcisinde.pluèïquef]ïavn«éet MSTongmt"n^*R^Mmbre^fecrins d’un
wldé deux à chaque’ 'S'i^o’tîn/'jptjvâ'nt la iJûgUeùr que Ü p v eq t donner à la ligne.
|p Môme à l^pHM*^ mù*’%ou(#î^nwwj^te^jllU®"(le meltre au bbut de la cordé
ifl^^iig/lupealtt^é'idejcrâfflydu? d ë i% > ro l^ 'q a j^ ^ g ^ imÆd^g-i’^mèpou, fasse la
■Igpueùc, îpeu^j^g*t|iL^tôt plus." ^pm*tme^c'onsfruction
est,excellente ^piiir'gécbè"r'd^^®3r^H)
fiu|pa.ais .leur /
QUEUE DES POISSONS. — La qu|tte'des poibsônsHa«l®j4 pas^SfeMjèfondae avee la
ipiëoîré' cafaS®?-' llvjq.üeue' fsgjibl^,-JçÏÏeffi (lafphij^t^wmfo»upe partie düattmps^ généralement
« ^Kpatpread' soiüSiai»^mn?!ta portion qui s’ét^a'd%fenus'à*Ia naSsànee dfe-la næfejjonîè caudale.
» «La* ÿuewe. est^d^^coinppsée des^os <rat terminent JgfcmiPfnhp Wili lirait dor-,JîliJJpi opmm nt
djSvft qyguaalÿ) stitiijWla portion c audùie. Les *ap,oph.y s es- ,de#®iaqge üye rtèbre de Ù Æjeue diffèrent
îrajpiup vonc iJW'-mtlpâj leur, nombre, soit par
leiyt.din&nsw^w’y
cor iri ms jiüi^ônsli J^(tof|roi*par
i iu6®> \ ei eanaal^jW. termide par
dJAda?1, ap I a la A(etj^4jJLp|,>‘- ' ■] am ( rtrémitë
lnuran ilflffttjln-pviirveiUpii ro* i/yjns do la na-
gtv.Ef/ i p
QUEUE DE GANGUI."^^^. I aNbateaux*)
' " Sgadette^Carpe.l
QUlNfQÙE PORTE. d ont -le^c^|ÿidsl|fdfaime cubique, et qui a
q u a t r e ( v o y . ljo6véi:)f2v-
QUIOULETTE. — Poéhe J l :filet mutin dep'hi|ieû‘rs ' p i l ^ et adaptée aux
jf f ip A ig u ille s 'd a n s ^ étangs' salis
-Quipot. — défilé par W^Sfeùrs du Boulonai^à: Ftg- -fle
Une .variété de 'Libuttï-ét dont%ous"ddmions la ^Bdmina- '' fouet-
I^Tèt l’usage., Get en gin | e|t .|y-|put Él^É|l^%acpîereau, .quand di fait jour
w p i l ’'V iOT®Juît( (Voy. ïnêbuRETC) R
On fait choix dîune ligne fil de foueU(/Cÿ; 894) de la^igros-
aek|rdu tuyau d’une ordinaire, au h o ^ d e - laquelle'mn’
attache un plomb conique ou ovale ’^ ( ^ .,,8 9 6 ) • pesant Æyk 9 ki-
D A proprement parler ^ m o t quipbt s’appliqua |)lutêt à l’aoa-' Fig_ 8#6;
lettë ou baleîhe qui complète T’éhgin.'lîlïï attache donc Un quipot B, rfomb'conique
Puis 6 autres de 4 mètres'én 4 ’mf®!); Chacun d’eux^a là forme d’unfe :I du<IBii>othaleine
B M 6“,1S qÙelmnTixé'à'k^ËgSé ëmpaâ^it un fil deux fois é^tk-oix pardessus
( cétte baleine porte à l’autre bout une empile de. fil de .lin (fig, 897), retors