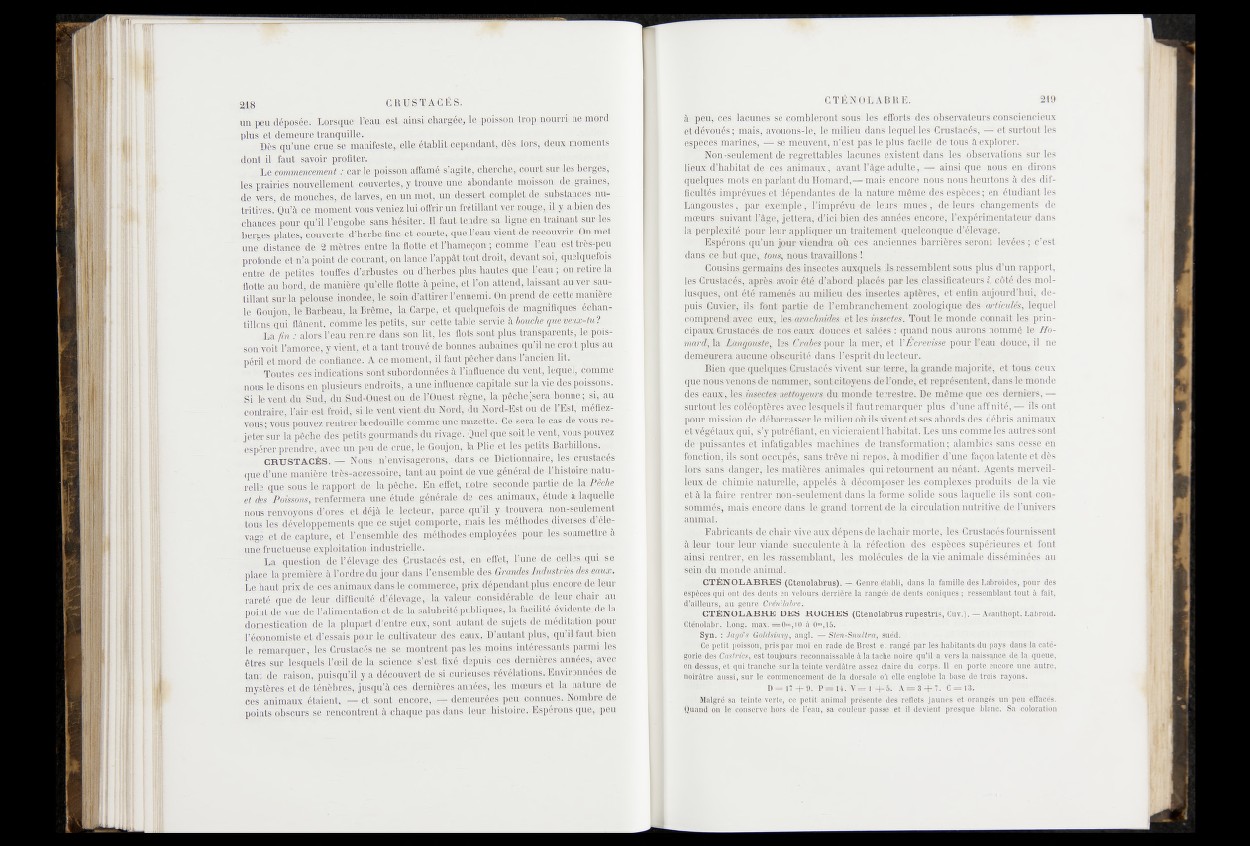
$18 CRU S T
^ p g ü .d é p s é a ; LaEMPi Kea^ésà ainsiÆterg^e,, l^^g#ssçg%|»ttofflrrii ^ : P » ^
ptas et^demmu-eti^qitife H -v^' <. -, (g
Qès. qu’uae ffi: Mftnifçsl&j-: eh® é1^Ui^!|^8^ft9î3âi>
(Jpnjt il faut savpir pacpflter,.
' Ire eommmcment :, car ^ ^oj,sspa affamé s’agite., QhetGh&irCOur tisuittes benges,
jh& prairies nouvei^eïüfiut QQuvsEtep^y trouve une abondante moisson* tte grades,
devyp®s, de mouches,, de k«rves, -eu un mqt, uu dessert qofwletitte sabsteufies nm
tritives. Qu’à ce momeùt vous veniez lui offrir un pétillant v ^ ^ q g ^ - ii 5 a htep. des
cban.ce® pour, qu^^engobe- saus-hésiter.; II faut terwfrq sa ligne,pn tm&Q&pt sur des
berges plates, couverte d’herbe fine e t courte, que l’eaU'Viântde recouvrir. .On met
une distance de 2 métrés entre la flotte et l’hameçon ; comme l'i^|u est'ftë^-peu
profonde.et n’a point de courant, çnJauufe l’appâttout drftâ%b|#§nt®qb
entre de petites touffes d^apbustes ou d’herbetvplus baqtp&q^e L’eau ;r«@Bk^ t i r e ü
Sotte %u bord, de manière qu’elfq flotte àfp e ip ^ e t ho® attend, laissant-jauiver .-sautillant
sur la pelouse inondééÿle- soin- d’attirer 1’ eriB,emi-^fflapgegdr' ^^bette rpamère
te Goujon, ÎABarbeau, la Brème, et qtEelqJteïoisite m^nifiiju*^ •$&>»-
tUlons_qui flânent, comnte bè''fèt®fsur cettem & m r m à HovcAe quev<am-M?
Là fin : alors l’eau rentre dans son lit, tes Jlqts,spçA plus, transpaf ent£,!-i4|>eis-
"sonvoit l’amorce, y vient, et a tanè^du^é de bonnes aubaines* cpibtoe;e®€fit>plwau
péril et mord de eonfla&ce. A eq momentjdWaut pêcher d au ^ ân c iM lit.
Thutes cë^indications^Sdînt subordonnées àd iq flu e r(^ ^ ^ 'v en ^ ^ p |^£ ^pçja,e
npusledi®®? en plusieurs endroits, a q f t l î ^ ^ ç e ^ p i t a i e .& u f t ^ ^ d ^ j ^ p n s .
le vent du Sud, du.Sud-ôqest o® de l’% e st règne, las pêcheqsemrbonne»; si, am
contraire, l’ais-est freid-, si le vent vientdu îtord, du JSorttiEsfc m.
vous? vous pouvez rentrerbredouilÛfeteômteejade m a z e t t e r ^ # s ê ? ^ ^ a ^ ( ^ ^ rejeter
sur la pêche dés’ jléttïs gôùrAandfs dfù nvag^Tf)îuprque
espérer prendre,^'ée ùn p eu d e crue;qe«fféigg&, l a j ^ f e f i éW s i J ^ b i t iW iS *,
CRUSTACÉS. — Nous- n’envisagerons,—dans o®^‘Bi©tion.nair% lessioriïste-cés
querd’une manière très^açcessoirfq- tant aq, point, d8,spef^en.émlîd©-dt,histoire."naturelle
que squsje rapport dp? la pêche. E® effet, notre #ép©de- paiftirnte: kuPêcke
et des Poissons, renfermera une étude générale de des animaux,,
nous.çpqyoyqnsd’ores etidéjà le tecteur,^pfqcq qu’il ^ t e ^ y e r a .pqrtespiipment
tous Iqs développements qpq.ee sujet çqmgorte, .jnais l^n^thode^diverses, âiéle-
vagè e.t dp .capture, et l’ensemble des méthodes employées.qtour./ les^soumettre à
que-fructueuse exploitetiQûrindustrielle.. |g , . -
La question de l’édeyage de® Qrustecé^e&t, en effet, ldpe R e p lie s quitte
place la première à l’ordre du. jour dans l’ensemble fies Grandes Industries, des eaux*
-Le haut prix de ces animaux dans le commerce, prix dépendanbpiftSf encore de teur
rareté que de leur,.difficulté d’élevage,* la valeur considérable de-leur chair au
ppint de ynq de l’alimentation et de la salubrité publiqqea^la faciljté.évidente.de la
domestication de la plupart d’entre eùx, sont autant de sujetsïde méditation pour
l’éconçipaiste-et d’essais pour le,cultivateur de# eaux, D’autant plus, qu’il faut bien
le remarquer, les Crustacés se montrent pas les ipoins intéressants parmi les
êtres sur lesquels l’oeil de la science s’est, fixé depuis ces dernières annéespavec
tant de raison,, puisqu’il y a découvert de si curieuses révélations,.Environnées de
my^tèçp^et de ténèbres, jusqu’à ees dernières-années, les moeurs ét la nature de
ées animaux étaient, — et sont, encore, — demeurées peu connues. Nombre de
points obscurs se rencontrent à chaque pas dans leur, histoire. Espérons que, peu
CT ÉN. ODA B RE. 219
à peu, ces lacunes se combleront sous les efforts des observateurs consciencieux
et dëvdués’f liS d ^ s ^M P s ^ ^ ^ ^ f f lilie u dans lequel les* Crustacés, surtout feè
espèces marrp.es, ^Sbfemeuvent. n ’est pas!ï^%lus facifé' de tous à explorât. ’
Non-seulement de regrettables lacunes existent dans les observations sur les
lieux d’habitat' de.’ces animaux, • avant l’âge adulte , — ainsi que nous en dirons
quelques mots en parlant du Homard,— mais encore nous nous heurtons à des difficultés
imprévues et dépendantes de la nature même des espèces ; en étudiant les
Langoustes', par exemple, l’imprévu de leurs mu e s, de leurs changements de
moeurs suivant l’âge, jettera, d’ici bien des années encore,-Héxpérimentatfeuj' éans
la perplexité pour l<MTsa»glimiftr a n traitement, çpïelconçpie d’flfevhÿéi
Espérons qu’un jq u r vtendra qh, c ês'-aioe ^n ^ ^b â rriê 're s seront levées -;pi’est
dans ce but que,, tous, nous travaillons !.
Cousins germains des insectes auxquels ilspiessemblent sous plus d’un rapport,
les Crustacés,- après avoir été d’abord placés? par les classificateurs à côté des mollusques,
ont été rannenés au milieu des. insecféÉ apLères,"et enfin aujourd’hui, depuis
Cuvier, ils font partie de l’embranchement zoologique des -articulés, lequel
t comprend; avec eux, %^ ar,achrdetks et \esinsectes. Tout te monde connaît Bepi priu-
cipauTa Crustecés dte- nos eæax dojæeés eL salées : quand nous aurons nommé te £fo-
mardjfi\k M,mgomte,, f e Ê5?^es pôür. fi?Écrevisse poîîr f eàu douce, il ne
demeurera aucune obscurité dans-l’espritdû lecteur^;.“ -
Bien §ue:qajelques-.Ç|nçtacés vivent sur terre, la grande m ajorité, cl tous ceux
que nous-venons de niWmtev, sontciÿM^Éide l’ondlvrs t représentent, dans te monde
mondé De mémo qpe e e s dernp®,s, —
surloirt les coléoptères avée^lesquels il faut remarquer plus d’üne affinité, — ils ont
pour mission de débarrasser le m ilieu où ils vivent et ses abords des débris animaux
et végétaux qui, s’y putréfiant, en vicieraient l ’habitat.. Les uns comme les autres sont
de puissantes et infatigables machines de transformation ; alambics sains cesse en
fonction, ils sont occupés, sans trêve ni repos, à modifier d’une façon latente et dès
lors sans danger, les matières, animales qui retournent au néant. Agents merveilleux
de chimie naturelle, appelés à décomposer les complexes produits de la vie
et à la faire rentrer non-seulement dans la forme solide sous laquelle ils sont consommés,
mais encore dans le grand torrent de la circulation nutritive de l’univers
àpimal.
iF a b r i c a n t s de chair vive aux dépens de la chair m orte, les Crustacés fournissent
à leur tour leur viande succulente à la réfection des' espèces supérieures et font
ainsi rentrer,. enteSç rassemblant, les molécules : de la vie animale disséminées au
sein duqapùde animal. .
C T É N O L A B R E S (Ctenolabrus). — Genre établi, dans la famille des Labroïdes, pour des
espèces qui ont des dents en velours derrière la rangée de dents coniques ; ressemblant tout à fait,
d’ailleurs, au genre G r é n ila b r e .
C T É N O L A B R E R U S R O C H E S (Ctenolabrus rupestris, Cuv ). — Acanthopt. Labroîd.
Cténolabr. Long. max. =ê>«,HU> à 0m,15. ..
Syn. : Jago's G o ld s in n y , angl. — S l e n - S n u l t r a , suéd.
-Ce petit poissonj pris par moi en rade de,Brest e t.rangé par les habitants.du pays dans la catégorie
des Cas tries, est toujours reconnaissable à la tache noire qu’il a vers la naissance de la queue,
en dessus, et qui tranche sur la leinLe.verdâtre assez claire du corps. Il en porte encore une autre,
noirâtre aussi, sur le commencement de la dorsale où elle englobe la base de trois rayons.
D = n + 9. P = H . Y = 1 + 5 . A = 3 + 7. C = 13.
Malgré sa teinte verte, ce petit animal présente des reflets jaunes et orangés un peu effacés.
Quand on le conserve hors de l’eau, sa couleur passe et il devient, presque blanc. Sa coloration