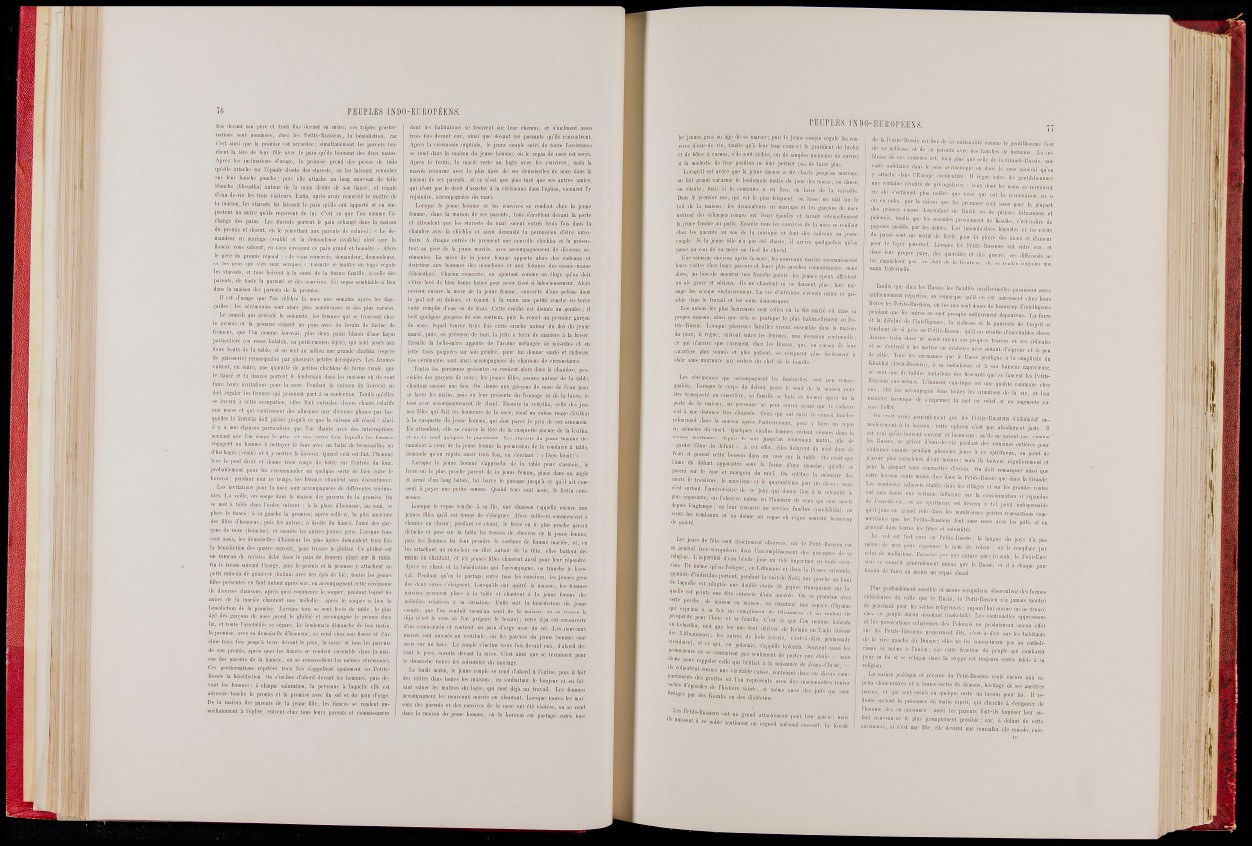
r 11
f :
I f'I
76 PBÜPLES INDO-EUROrÉENS.
fois ciovaiit soil pòre et trois fois devant sa mère; ces trijilcs prostern
a t i o n s sont noniiiiócs, eliez les Petits-Riissicns, la bencdictioii, car
c ' e s t ainsi que la promise est accordée; siiaiilianéinent les parents toiH
c l i e n t la tCte de lenr fille avec le pain qu'ils tiennent des deux mains.
A p r i ' s les inclinations d'nsage, la promise prend des pièces de toile
q u ' e l l e attache snr l'ciiaule droite des starosts, en les laissant retomber
s u r leur liaiielie ganelie ; puis elle attache un long morceau de toile
lilnnclie (tlioiistka) autour de la main droite de son flanee, et rigale
d ' c a u - ( l e - v i e les trois visiteurs. Knfiii, après avoir remercié le maitre de
la maison, les starosts lui laissent le pain qu'ils ont apporté et en emp
o r t e n t 1111 a n t r e qu'ils reçoivent de lui. C'est ce que l'on nomme l'ée
l i a n g e des pains. Les starosts portent le pain ccliangé dans la maison
d u jiromis et disent, en le remettant aux pai'ents de celui-ci : . Le dem
a n d e u r en mariage (svaldi) et la demandeuse (svakha) ainsi que la
fiancée vous saluent, en vous envoyant ce pain grand et honnête. . Alore
l e père du promis répond : < J e vous remercie, demaiulenr, denmiuleuse,
e t les gens qui s'en sont occupés.» Hnsiiite le maitre dn logis régale
l e s starosts, et tous boivent h la sanlé de la future famille, il eolie des
p a r e n t s , de toute la parenté et des convives. Un repas semblable a lien
d a n s la maison des parents de la promise.
11 est d'usage que l'on célèbre la noce niic semaine après les fianç
a i l l e s ; les cérémonies sont alors plus nombreuses et des plus variées.
I . e samedi qui précède la solennité, les femmes qni se trouvent chez
le promis et la promise cuisent nii pain avec du levain de farine de
IVomeiit, que l'on nomme korovaï, plus deux pains blancs d'une façon
p a r t i c u l i è r e (en russe kalatch, en petit-riissien léjèn), qui sont posés aux
d e u x bouts de la table, et on met an milieu une grande cliichka (espèce
d e pâtisserie) remarquable p.w plusienrs petites déconpnres. Les femmes
e u i s e n t , en outre, un« quantité de petites cllichkas de forme ronde, que
le fiancé et la fiancée jiortent le lendemain dans les maisons oii ils vont
f a i r e leurs invitations pour la noce. Pendant la cuisson du korovaï on
d o i t régaler les femmes qui prennent part h sa confection. Tandis qu'elles
s e livrent à cette occupation, elles font entendre divers chants relatifs
a n s noces et qui contiennent des allusions anx diverses phases par lesq
u e l l e s le korovaï doit passer jusqu' à ce que la caisson ait réussi : ainsi
il y a ane chanson particulière que l'on chante avec des interruptions
p e n d a n t qne l'on coupe la pâte, et nne antre dans laquelle les femmes
e n g . i g e n t un homme il nettoyer le four avec un balai de broussailles ou
d ' h e r b a g e s (vénik) et à y met tre le korovaï. Quand cela est fait, riiomme
l è v e le pied droit et donne trois coups do botte sur l'entrée du four,
p r o b a b l e m e n t pour lui recommander en quelque sorte de bien cuire le
k o r o v a ï ; pendant tout ce temps, les femmes chantent sans discontinuer.
L e s invitations pour la noce sont accompagnées de dilféreuics eérémonics.
f.a veille, on soupe dans la maison des parents de la promise. On
se met 1 table dans l'ordre suivant : à la place d'honneur, au coin, se
p l a c e le flaneé; à sa gauche la promise; a|irès eelle-ci, la plus ancienne
des filles d'honneur, puis les autres; i droite dn flaneé, l'ainé des garçons
Ile noce (boïarinc), et ensuite les antres jeunes gens. Lorsque tous
s o n t assis, les demoiselles d'honneur les plus âgées demandent trois fois
l a bénédiction des quatre starosts, pour tres,scr le ghiltsé. Ce gbiltsé est
u n ramean de cerisier fiché dans le pain de froment placé .sur la table.
On le tresse suivant l'usage, |iuis le promis et la promise y attachent un
p e t i t rameau de genièvre (kalina) avec des é|iis de blé; toutes les jeunes
fllles présentes en font autant après eux, en accompagnant cette cérémonie
d e diverses cliansons, après quoi commence le souper, pendant lequel les
a m i e s de la mariée chantent une mélodie ; après le souper a lien la
b é n é d i c t i o n de la promise. Lorsque tous se sont levés de table, le ]ihis
â g é des garçons de noce prend le ghiltsé et accompagne le jiromis chez
l u i , et tonte l'a.ssemblée se sépare. l,c lendemain dinianclic de bon malin,
la promise, avec sa demoiselle d'honneur, se rend chez sou fiancé et s'inc
l i n e trois fois jusqu' à terre devant le père, la mère et tous les parents
d e son promis, après quoi les fiancés se rendent ensemble dans la maisou
des parents de la fiancée, où se renouvellent les mêmes cérémonies.
Ces prosternations répétées trois fois s'ap]iellcnt également en Petitel
i u s s i e la bénédiction. On s'incline d'abord devant les liommes, puis dev
a n t les femmes; à chaque salutation, la personne à laquelle elle est
a d r e s s é e touche le promis et la promise avec du sel et du ]iaiu d'orge.
D e la maison des jiareiits de la jeune fille, les fiancés se rendent imm
é d i a t e m e n t fi l'église, entrent chez tous leurs jiarents et connai,ssanccs
d o n t les habitations se trouvent snr lenr chemin, et s'inelinciit aussi
t r o i s fois devant eux, ainsi que devant les passants qu'ils rencontrent.
A p r è s la cérémonie nuptiale, le jeune eou])le suivi de toute l'assistance
se rend daus la maison dn jeune homme, ofi le repas de noce est servi.
A p r è s le festin, le marié reste an logis avec les convives; mais la
m a r i é e retonrue avec la plus âgée de ses demoiselles de noce dans la
m a i s on de ses parents, et ec n'est que phis tard que ses autres amies,
qui n'ont pas le droit d'assister à la cérénionic dans l'église, viennent l'y
r e j o i n d r e , accompagnées dn mari.
L o r s q u e le jeune homme et les convives se rendent chez la jeune
f e m m e , dans la maison de ses parents, tous s'arrêtent devant la porte
e t altendent que les starosts dn mari soient entrés trois fois dans la
c h a m b r e avec la ehichka et aient demandé la permission d'être introd
u i t s . A chaque entrée ils prennent une nouvelle cliichka et la présent
e n t au père de la jeune mariée, avec aecompagnement de diverses cér
é m o n i e s . La mère de la jeune femme apporte alors des cadeaux et
d i s t r i b n e aux hommes des mouchoirs et aux femmes des essuie-mains
( k h o u s t k a s ) . Chacun remercie, eu ajoutant comme un éloge qu'on doit
s ' ê t r e levé de bien bonue heure pour avoir tissé si laborieusement. Alors
r e v i e n t encore la mère de la jeune femme, couverte d'une pelisse dont
l e poil est eu dehors, et tenant à la main une petite ernche en terre
c u i t e remjilie d'eau ou de kvas. Cette cruche est donnée an gendre ; il
b o i t quelques gorgées de son contenu, puis la remet an premier garçon
d e noce, lequel tourne trois fois cette cruche autour du dos du jeune
m a r i e , puis, en présence de tons, la jet t e à terre de manière à la briser.
K n s u i t e la belle-mère apporte de l'avoine mélangée de noisettes et en
j e t t e trois poignées sur son gendre, pour lui donner santé et riehesse.
Ces cérémonies sont aussi accompagnées de chansons de circonstanee.
T o u t e s les personnes présentes se rendent alors dans la chambre, préc
é d é e s des garçons de noce ; les jeunes filles, assises autour de la table,
c h a n t e n t encore une fois. On donne aux garçons do noce de l'eau pour
s e laver les malus, puis on leur présente dn fromage et de la bière, le
l o n t avec accompagnement de chant. Ensuite la svitylka, celle des jeunes
filles qui fait les honneurs de la noce, coud nu ruban ronge (kvitka)
à la casquette dn jeune homme, qui doit payer le prix de eet ornement.
E n attendant, elle se couvre la tête de la casquette garnie de la kvitka,
e t ne la rend qu'après le payement. Les starosts du jeune homme dem
a n d e n t ,à ceux de la jeune femme la permission de la conduire à table,
d e m a n d e qu'on répète aussi trois fois, en s'écriant : < D i e u bénit l >
L o r s q u e le jeune homme s'approche de la table pour s'asseoir, le
f r è r e ou le plus proche parent de la jeune femme, placé dans un angle
e t armé d'un long bâton, lui barre le passage jusqu' à ce qu'il ait cons
e n t i à payer nne petite somme. Quand tous sont assis, le festin comm
e n c e .
L o r s q u e le repas touche à .sa fin, nue chanson rappelle encore anx
j e u n e s filles qu'il est temps do s'éloigner. Alors celles-ci commencent h
c h a u l e r en cliouir; |)endant ce chant, le frère ou le |ilns proche parent
d é t a c h e et pose sur la talde les tre.sses de elicveux de la jeune femme, '
p u i s ll^s femmes lui font prendre le costume de femme mariée, et en
lui attachant un mmichoir on filet autour de la tête, elles battent des
m a i n s eu cllanlant, et les jcnnes filles chantent au.ssi pour leur ré|ioiidre.
A ] i r è s ce chant et la bénédiction qui l'accompagne, on tranche le korovaï.
Pendant qu'on le ]iartage entre tous les convives, les jeunes gens
des deux sexes s'éloignent. Lorsqu'ils ont quitté la maison, les femmes
m a r i é e s prennent place ii la lable et chanlent à la jeune femme des
m é l o d i e s relatives à sa silnalion. Enfin suit la héiiédiction du jeune
c o n i i l e , que l'on conduit jusqu'au seuil de la maison, oii se trouve la
d i j a (c'est le vase oii l'o éparc le levain); celle dija est reconveite
il'ini essuie-main et contient un pain d'orge avec du sel. Les nouveaux
m a r i é s sont amenés au vestibule, oil les parenis du jeune liominc soul
a.ssis sur un banc. Le s' i n c l i n e Irois fois devant eux, d'abord dev
a n t le père, ensuite devant la mère. C'est ainsi que se Ici mi pour
le dimanclic toutes les solennités du mariage.
L e lundi matin, le jeune cou|de se rend d'abord à l'église, |mis il fait
d e s visites dans toutes les maisons, en souhaitant le bonjour et eu fais
a n t saluer les maîtres du logis, qui sont déjà au travail. Les feninies
a e e o n i i i a g n e n t les nouveaux mariés en clianlant. Lorsque toules les maid
e s parents et de;
! la maison du jeili
ives de la nocc ont été visitées, on se rei
i m e , où le korovaï est ¡larlagé entre to
PEUPLES INnO-EUROPÉENS.
les jeunes gens en âge de se marier; puis le jei
vives d'eaii-dc-vie, tandis qu'à leur tour ceuxe
t de bêtes à cornes, s'ils sont riclies, ou de
1 1.1 o d e s t i e d e le • p o s i t i f
L o r s q u ' i l est avéré que la je
1 fait grmid •
a r m e le lendem
on chante ; ma
le contraire
Dans le premici
0 couple régale les con-
- c î le gratifient de brebis
mples monnaies de cuivre,
! leur permet pjuî de faire plus.
: éiioiise a été chaste jusqu'au mariage,
d u matin du jour des noces, on danse,
a eu lien, on brise do la vaisselle,
c a s , qui est le pins fréquent, on hi.sse un mât sur le
t o i t de la maison ; les demandeurs en mariage et les garçons de noce
m e t t e n t des écharpcs rouges sur leurs épaules et lavent solennellement
l a jeune femme an puits. Ensuite tous les convives de la noce se rendent
chez les parents au son de la musique et font des cadeaux au jeune
couple. Si la jeune fille n'a pas élé chaste, il arrive quelquefois qu'on
passe au cou de sa mère un licol de cheval.
Une semaine environ après la noce, les nouveaux mariés recommencent
l e u r s visites chez lenrs parents et leurs pins ]iroches connaissances; mais
a l o r s , au lieu do montrer une franche gaieté, les jeunes époux afl'ectent
n u air graye et sérieux. Ils ne ehanteut ni ne dansent plus; leur ménage
les occupe exclusivement. La vie d'intérieur s'écoule calme et paisible
daus le travail et les soins domestiques.
L e s unions les plus henreuses sont celles oii le flis marié vit dans sa
p r o p r e maison, ainsi que cela se pratique le plus habituellement en Pet
i t c - R u s s i e . l.orsque plusienrs famille
a i t ensemide dans la maiso:
du père, il
ï i i e , surfont entre les femmes, une désunion continuelle
ce qui n'arr
; que rarement chez les linsses, qni, en raison de leu
c a r a c t è r e |ihis soumis et plus iiatlent, se résignent plus facilement à
obéir sans murmure aux ordres du chef de la famille.
Les cérémonies qui accompagnent les funérailles sont peu remarquables.
Lorsque le corps du défunt passe le seuil de la maison pour
ê t r e transporté au cimetière, sa famille se Inile de fermer après lui la
p o r t e de la maison, oii personne ne peut entrer avant qne le cadavre
soit à une distance frès-éloignée. Ceux qui ont suivi le convoi funèbre
r e t o u r n e n t d.ans la maison après l'enterrement, pour y fa
m é n •e du mort. Quelques vieilles fei
o r t u a i r e . depuis le soir jnsqu'-
r e s t e n t
n d e m a i n i
ni repas
d a n s la
l a t i i
niel daus de
« g a r d e r l'âme du défunt.. A cet effet, elles dél
l'eau et posent cette boisson dans un vase sur la table On
l ' â m e du défaut apparaîtra sous la forme d'une monehe, q
p o s e r a sur le rase et mangera du miel. On célèbre la niéinoi
morts le troisième, le neuvième et le quarantième jour dn décès • mais
c ' e s t surfont l'anniversaire de ce jour qui donne lien à la solennité'la
1 us iniposautc, on l'observe même eu l'honnenr de ceux qui sont morts
depuis longtemps; on leur consacre nu service funèbre (panikliida), ou
~ t „ u i b e a u x et ou donne nu repas oti règne souvent beaucoup
roit que
' e l l e se
i r e des
Les jours ,1c fête sont strielement observés, car le Petit-Rnssien est
Cl. general très-scrupuleux dans l'accomplissement dos préceptes de sa
'•«lisioii. L'aspersion d'eau bénite joue un rôle importan, en toute occasion.
Do même qu'en Pologne, en Lilliuanie et dans la Prusse orientale
l - . - i u t i t é d'individus portent, pendant la nuit de Noid, nne percho ,n Inni
'!<= laquelle est adaptée nne double étoile de papiei' Ira,,!,nient
« • " o lici lie, do maison on .naison, en ebantrrut une espèce d'hvmne
" j p r n u c à l a b n s un eoniplimeiit de lélieitation et nu s o i j t I
I- I u k a , met que les uns bmt dciàve,. do Kolado ou I.ado {déesse
« L,h amen.,); les antres ,1e kolo (cercle, c'est-â-,lire promenade
- 'I-' ™ »• a p p e l l e koleinia. Sonvenl au.ssi t
n e se cmle.itent pas seuleineiit de porter une étoile - sans
M « m , rappeler celle qui Indllait â h. naissance de J.isns-Christ ^
« .ortcit e,ieo,.e une véritable caisse, eontenant ,la,is ses d ivel^ln-
M f m e n t s des grottir, oîi l'on rcproisente avec d,
»' « depisoiles ,1e l',iis,„ire sainte, et uiêiue au
l i ' x ' i S i s pai- lies ICozaks ou des illablotins
n i a i ' i o i i n e t t e s toules
,Ies juifs qui sont
l'Cs Potits-Ru,
ils unissent à ce
l o b l e I
1 gl'aïul allai e u t p,u,r leu,- patrie; mais
l a t i i u i a l excessif. Le lûizak
P e t i t e ; liiissio est fier ,1e sa nationalité eoiuine le gentillio.nme l'est
. noblesse et de sa nareiitê avec ,les familles de hetnmns. La nom
b l e s s e d
t r é c s est, bi us qir
c a s t e nobiliaire dans le sens germanique
y attache dans l'Europe occidentale. Il
n n e cei-tainc rivalité de prérogatives : ,
en .ski s'estiment plus nobles que ceu;
c e l l e de la Orande-liussie,
o n dans le seus généi'al q
r è g n e entre les gentilsbom
IIX dont les noms s
i n e n t
qui ont la tc,i,iinais<ni en o
ou en enko, par la raison que les p,-emiers sont issus |,ou,' la ,il„part
d e s princes russes descraida,it de Rurik ou de princes lilhi,aniens et
p o l o n a i s , taudis que les secondes pi'oviennent de Kozaks, c'est-à-dire de
p a y s a n s anoblis pai- les armes. Les innombrables légendes et les récits
d u passé sont un motif ,1e ñerté pour la gloire des aïeux et d'amour
p o u r le foyer paternel. Loi'sque les Petits-flnssiens ont ent,e eux, et
d a n s leu,- jiropi-e pays, des quc-elles et des procès, ces diltërends' ne
l e s empêchent pas, au delà de la frontière, de se tend,-e tonioui-s une
m a i n fratenielle.
T a n d i s que chez les Busses les facultés intclleetuelles pa,-alssent assez
u n i f o r m é m e n t répa,-t!es, on ,-ema,-qne qu'il en est aut,eme„t chez leurs
f r è r e s les Pct i ts-Russiens, oi, les uns sont donés de beaucoup d'intelllgenec
p e n d a n t que les autres en sont presque entièrement dépourvus. La force
e t la déliilité de l'intelligence, la richesse et la paav,-eté de l'esp,it se
t o u c h e n t de si près en Petite-Russie, qu'il en résulte d'inévitables chocs
A u e u i i e t,-ib„ slave ne saisit mieux ses propres travers et ses ridicules
e t ne s'entend à les mettre en évidencc avec autant d'aigreur et si peu
d e ]„tié- Tous les sarcasmes que le Russe prodigne à la simplicité dn
I v h a k h o l (Petit-Russien), à sa maladresse ' e t son humeur capricieuse,
u e sont que de faibles imitations des b,-oeards que se lancent les Petits-
K n s s i e n s eux-,némes- L'humeur caustique est nne qualité commune chez
e u x ; elle les accompagne dans toutes les situations de la vie, et leur
m a n i è r e laconique de s'exj,rimer la met en ,-elief et en augmente enc
o l e l'efiet.
On c,-oit assez généralement que les Petits-Russlens s'adonnent imm
o d é r é m e n t à la boisson ; cette opinion n'est pas absolument juste II
e s t vrai qu'ils boivent souvent et beaucoup ; qu'ils ne savent pas, comme
les linsses, se priver d'ean-dc-vie pemlant ,lcs semaines entières pour
s ' a d o n n e r ensuite pendant plusieu,-s jours à ce spiritueux, an point de
n ' a v o i r plus conscience ,1'eux-mêmes ; ,nais ils boivent régulièrement et
p o u r la plupart sans commettre d'excès. On doit .-emarqner aussi que
c e t t e boisson coûte moins cher dans la Petite-Russie qne dans la Grande
Les nombreux cabarets établis dans les villages el sur les glandes ,-ontes
ont sans doute une certaine influence snr la eonsouimation si répandue
d e l'ean-de-vie, et ce spi,-ituenx est devenu à tel point indispensable
q u i l joue un grand rôle dans les nombreuses petites t,-a„sactions comn
i c - c i a l e s que les Petits-Russlens font sans cesse avec les juifs, et en
g é n c , ' a l dans tontes les fêtes et solennités.
L e vol est fort rare en Petite-Russie ; la langue du pays n'a pas
m e n i e de mot ponr exprimer le nom de voleur : on le remplace jiar
c e l u i ,1e uialfaiteu,-. Favorisé par nne nature plus féconde, le Petit-Riis-
Sien se nourrit généraleineiit mieux que le Russe, et il a ch.iqne jour
b e s o i n de faire au moins un ,-epas chand.
P l u s profondément sensible et moins .scrupuleux observateur des foi-mcs
e x t é r i e u r e s ,ln culte que le Russe, le Petit-Russien n'a jamais montré
d e iienehant ponr les sectes religieuses ; aujourd'hui encore on no trouve
c h e z ce peuple aucun dlssidaiit (raskolnik). Les continuelles opp,-essions
e t les iiersccntions religieuses des Polonais ne proiluisirent aucun elTct
su,- les P.-tits-Bu.ssicns propiement dits, c'est-à-dire snr les habitants
,1e la rive gauche ,ln Dniepr; elles ne les convertirent pas au eatholic
i s n i e ni n,cme à l'uuion ; ea,- cette fracti,m du peuple qni combattit
pou,- sa foi et se ,-éfugia dans la steppe est toujours restée fidèle à sa
r e l l g i o n -
L a natu,-e poétique et rêveuse du Petit-Ilnsslcn croit encore anx esp
r i t s élémentaires et à toutes sortes de démons, héritage de ses ancêtres
p a ï e n s , et ipii sont i-estés en quelque -sorte m, besoin ponr hii. 11 re-
( l o u l e surtout la puissance ,lu ,nalin esprit, qni cherche ,1 s'cnipa,-er de
l ' h o m m e di-s sa uaissauee : aussi les parents font-ils baptiser leur enf
a n t iioiiveau-né le jdns p,-oniptmnent possible ; car, à défaut de cette
e c r é m o n i e , si c'est nne fille, elle devient une roussalka (de roiisslo ruisl
i\
Í
rji.
iji
t ;