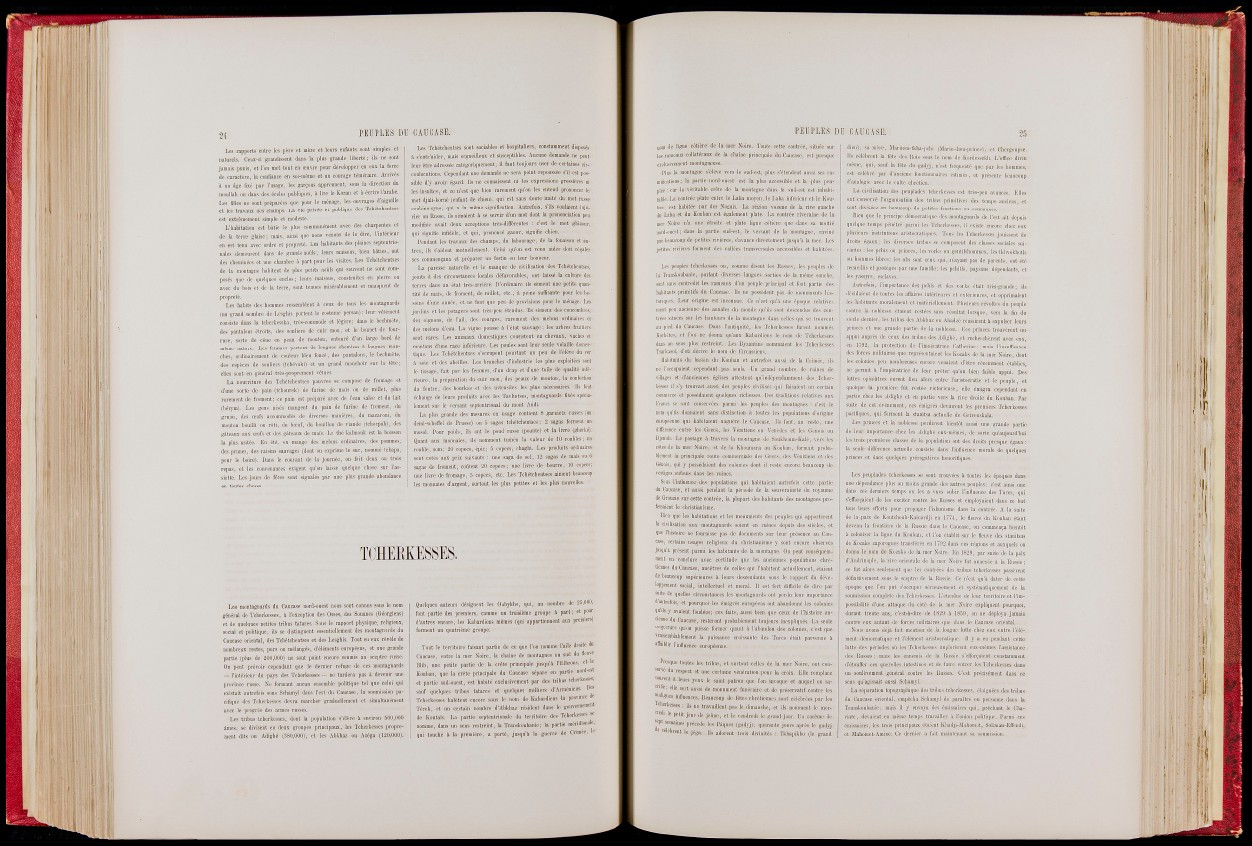
í ! f
24 F B Ü P L E S DU OAÜOASB. P E U P L E S DU CiVUG.-VSE. 25
» I li
I p I
Les rapports entre les père et mère et leurs enfants sont simples et
naturels. Ceux-ci grandissent dans la plus gramle liberté; ils ne sont
jamais puiiis, et l'on met tent en oenvro pour ilevelopper en eux la force
de caractère, la conliance en soi-même et un courage téméraire. Arrivés
il un jige fixé par l'usage, les garçons apprennent, sous la direction dn
moullali ou dans des écoles publiques, il lire le Koran et il écrire l'arabe.
Les filles ne sont préparées que pour le ménage, les ouvrages d'aiguille
et les travaux des cl.amps. La vie privée et publique des Tcbétclientses
est extrêmement simple et modeste.
L'habitation est bâtie le plus communément avec des charpentes et
de la terre glaise ; mais, ainsi que nous venons (le le dire, l'intérienr
en est terni avec ordre et propreté. Les habitants des plaines septentrionales
demeurent dans de grands aoùls; leurs maisons, bien bâties, ont
des cheminées et nue chambre à part pour les visites. Les Tcbétcbentses
de la montagne habitent de plus petits aoûls qui souvent ne sont composés
que de quelques enclos; leurs maisons, constniitcs en picn-c on
avec du bois et de la terre, sont tenues misérablement et manquent de
propreté.
Les habits des hommes ressemblent il ceux de tons les montagnards
(un grand nombre de Lcsghis portent le costume persan); leur vêlement
consiste dans la tcherkesska, très-commode et légère; dans le becbmète,
des pantalons étroits, des sonliers de cuir mou, et le bonnet de fourr
u r e , sorte de cône en peau de mouton, entouré d'un large bord de
même nature. Les femmes portent de longnes chemises à longues manches,
ordinairement de couleur bien foncé, des pantalons, le beclimète,
des espèces de souliers (tchévald) et un grand mouchoir sur la tête;
elles sont en général très-proprement vêtues.
L a nourriture des ïchétchentses pauvres se compose de fromage et
d'une sorte de pain (tchoureli) de farine de maïs ou de millet, plus
raiement de froment; ce pain est préparé avec de l'eau salée et du lait
(bérym). Les gens aisés mangent du pain de farine de froment, du
g r u a u , dos oeufs accommodés de diverses manières, du macaroni, du
monlon bonilli ou roti, du boeuf, du bouillon de viande (tchorpab), des
gâteaux anx oeufs et dos gâteaux de maïs. Le thé kalmouk est la boisson
la plus usitée. En été, on mange des melons ordinaires, des pommes,
dos prunes, des raisius sauvages (dont on exprime le suc, nommé tchapa,
pour le boire). Dans le courant de la journée, on fait deux ou trois
repas, et les convenances exigent qu'on laisse quelque chose sur l'assiette.
Les jours de fêtes sont signalés par une plus grande abondance
en toutes choses.
Les Tchétchentscs sont sociables et hospitaliers, constamment disposés
il s'entr'aider, mais orgueilleux et susceptibles. Aucune demande ne peut
leur être adressée catégoriquement, il faut toujours user de certaines circonlocutions.
Cependant une demande ne sera point repoussée s'il est possible
d'y avoir égard. Ils ne connaissent ni les expressions grossières ni
les insultes, et ce n'est que bien rarement qu'on les entend prononcer le
mot djali-korné (entant de chien), qui est sans doute imité du mot russe
soukine-sjne, qui a la mémo signiflcation. Autrefois, s'ils voulaient injur
i e r un Russe, ils aimaient à se servir d'un mot dont la prononciation peu
modiaée avait deux acceptions très-différentes ; c'est le mot ghiaour,
qui signiae infidèle, et qui, prononcé gaour, signiSe chien.
Tendant les travaux des champs, du labourage, de la fenaison et aut
r e s , ils s'aident mutuellement. Celui qu'on est venu aider doit régaler
ses commençaux et préparer un festin en leur hunueur.
L a paresse naturelle et le manque de civilisation des Tcbétclientses,
joints il des circenstaiices locales défavorables, ont laissé la culture des
t e r r e s dans un état très-arriéré. D'ordinaire ils sèment une petite quant
i t é de maïs, de froment, de millet, etc., ii peine suffisante pour les besoins
d'une année, et ne fout que peu de provisions pour le ménage. Les
jardins et les potagers sont très-peu étendus. Us sèmeni dos concombres,
des oignons, de l'ail, des courges, rarement des melons ordinaires et
des melons d'eau. La vigne pousse il l'état sauvage ; les arbres fruitiers
sont rares. Les animaux domestiques consistent en chevaux, vaches et
montons d'une race inférieure. Les ponies sont leur seule volaille domestique.
Les Tchétchentses s'occupent pourtant un peu de l'élève du ver
il soie et des abeilles. I.es branches d'industrie les plus exploitées sont
le tissage, fait par les femmes, d'un drap et d'une toile de qualité intér
i e u r e , la préparation du cuir mon, des peaux de mouton, la confection
du feutre, des bourkas et des ustensiles les plus nécessaires, lis tout
échange de leurs produits avec les Tavliutses, montagnards fixés spécialement
sur le versant septentrional du mont Audi.
L a plus grande des mesures en usage contient 8 garnietz russes (un
demi-sclieffel de Prusse) ou 5 sagas tchétchentses ; 2 sagas fenuent un
mosol. Pour poids, ils ont le poud russe (pounte) et la livre (gherkiS).
Quant aux monnaies, ils nomment tumèn la valeur de 10 roubles; nn
rouble, som ; 20 copecs, épiz ; 5 copecs, chaghi. Les produits ortiinaircs
sont cotés aux prix suivants : une saga de sel, 12 sagas de maïs ou G
sagas de froment, coiitent 20 copecs; une livre de beurre, 10 copecs;
une livre de fromage, 5 copecs, etc. Les Tchétchentses aiment beaucoup
les monnaies d'argent, surtout les plus petites et les plus nouvelles.
TCHEEKESSES.
Les montagnards du Caucase uorcl-ouest nous sont connus sous le nom
général de Tcherkesses, à l'exception des Osses, des Souanes (Géorgiens)
et de quelques petites tribus tatares. Sous le rapport physique, religieux,
social et politique, ils se distinguent essentiolleraent des montagnards du
Caucase oriental, des Tchétclientscs et des Lesghis. Tout en eux révèle de
nombreux restes, purs ou mélangés, d'éléments européens, et une grande
p a r t i e (plus de 200,000) ne sont point encore soumis au sceptre russe.
On peut prévoir cependant que le dernier refuge de ces montagnards
— l'intérieur du pays des Tcherkesses — ne tardera pas à devenir une
province russe. Xe formant aucun ensemble politique tel que celui qui
existait autrefois sous Schamyl dans l'est du Caucase, la soumission pacifique
dos ïcherkesses devra marcher graduellement et simultanément
avec le progrès des armes russes.
Les tribus tcherkesses, dont la population s'élève à environ 500,000
âmes, se divisent en deux groupes principaux, les Tcherkesses proprement
dits ou Adighé (380,000), et les Abkhaz ou Azéga (120,000).
Quelques auteurs désignent les Oubykhs, qui, au nombre de 25,000,
font partie des premiers, comme un troisième groupe fi part; et pour
d ' a u t r es encore, les Kabardiens mêmes (qui appartiennent aux premiers)
forment un quatrième groupe.
Tout le territoire faisant partie de ce que l'on nomme l'aile droite du
Caucase, entre la mer Noire, la chaîne de montagnes au sud du fleuve
Blib, une petite partie de la ci'ôte principale jusqu'à l'Klbrous, et c
Kouban, que la crête principale du Caucase sépare en partie nor<l-est
e t partie sud-ouest, est habité exclusivement par des tribus tclierkcsscs,
sauf quelques tribus tatares et quelques milliers d'Arméniens. Des
Tcherkesses habitent encore sous le nom de Kabai'diens la province te
T é r c k , et un certain nombre d'Aljkhan résident dans le gouvernement
de Koutaïs. La partie septentrionale du territoire des Tcherkesses se
nomme, dans un sens restreint, la Transkoubanie ; la partie méi'idionale,
qui touche à la première, a porté, jusqu'à la gueri'C de Criinee, l
uom (le ligne côtière de la mer Nuire. Toute cette conti'ée, située sur |
les rameaux collatéraux de la cliaine principale du Caucase, est presque
exclusivement montagneuse.
Plus la montagne s'élève vei's le sud-est, plus s'étendent aussi ses ramifications
; la partie nord-ouest est la plus accessible et la plus peuplée
; car la véritable crête de la montagne dans le sud-est est inhabitable.
La contrée plate entre le Laba moyen, le Laba inféi'ieur et le Kou-
1)81), est habitée par des Nogaïs. La région voisine de la rive gauclie
(In Laba et du Kouban est également plate. La conti'ée riveraine de la
inci' Noire n'a une étroite et plate ligne côtière que dans sa moitié
iiord-ouest; dans la pai'tie sud-est, le versant de la montagne, i-aviné
par bcauconp de petites rivières, s'avance directement jusqu'à la mer. Les
petites l'ivières forment des vallées transvei'salos accessible.s et habitoes.
Les peuples tcherkesses ou, comme disent les Russe.s, les jieuples de
lii Ti'anskoubanie, parlant diverses langues soi'ties de la môme souclie,
sont sans contredit les rameaux d'un peuple princijial et font pai-tic des
habitants ])rimitifs du Caucase. Ils ne possèdent pas de monuments IKStoriqucs.
Leur origine est inconnue. Ce n'est qu'à une époque relativement
])en ancieiuie des annales du monde qu'ils sont descendus des contrées
situées sur les hauteurs de la montagne dans celles qui se trouvent
au pied du Caucase. Dans l'antiquité, les Tcherkesses furent nommés
Korkùte^;, et l'on ne donna qu'aux Kabordiens le nom de Tcheikesses
(liins un sens plus restreint. Les Byzantins nommaient les Tcheikesses
Tsai'kasoï, d'où dérive le nom de Circassiens.
Habitants du bassin du Kouban et autrefois aussi de la Crimée, ils
ne l'occupaient cepeiulant pas seuls. Un grand nombie de ruines de
villages et d'anciennes églises attestent qu'indépendamment des Tcherkesses
il s'y trouvait aussi des peuples civilisés qui faisaient un certain
commerce et possédaient quelques ricliosscs. Des traditions relatives aux
Francs se sont conservées parmi les peuples des montagnes : c'est le
nom qu'ils donnaient sans distinction à toutes les populations d'oi-igine
européenne qui habitaient naguère le Caucase. Ils font, au reste, une
diû'érence entre les Grecs, les Vénitiens ou Vonèdes et les Génois ou
Djenidi. Le passage à travers la montagne de Soukboum-Kalé, vers les
côtes de la mer Noire, et de la Khoumara au Koubnn, formait probablement
la principale route commei'ciale des Grecs, des Vénitiens et des
Génois, qui y possédaient des colonies dont il reste encore beaucoup de
vestiges enfouis dans les ruines.
Sous l'influence des populations qui habitaient autrefois cette partie
du Caucase, et aussi pendant la péi'iode de la souveraineté dn royaume
de Grouzie sur cette contrée, la plupart des habitants des montagnes professaient
le christianisme.
Bien que les habitations et les monuments des peuples qui apportèrent
la civilisation aux montagnards soient en ruines depuis dos siècles, et
que l'histoire ne fournisse pas de documents sur leur présence au Caucase,
certains usages religieux du christianisme y sont encore observés
jusqu'à présent parmi les habitants de la montagne. On peut conséquemnicnt
eu conclure avec certitude que les anciennes populations chrétiennes
du Caucase, ancêtres de celles qui l'habitent actuellement, étaient
•le beaucoup supérieures à leurs descendants sous le l'apport du développement
social, intellectuel et moral. Il est foi't difficile de dire par
suite de quelles circonstances les montagnards ont perdu leur importance
d'autrefois, et pourquoi les émigrés eui'opéens ont abandonné les colonies
qu'ils y avaient fondées; ces faits, aussi bien que ceux de l'histoire ancienne
du Caucase, resteront probablemont toujours inexjjliqués. La seule
conjecture qu'on puisse former ([uant à l'abandon des colonies, c'est que
vraisemblablement la puissance croissante des Turcs était parvenue à
affaiblir l'iullucnce européenne.
I^i'csque toutes les tribus, et surtout celles de la mer Noire, ont conserve
du respect et une certaine vénération pour la croix. Elle remplace
souvent à leurs yeux le saint patron que l'on invoque et auquel on sal
i f i e ; elle sert aussi de monnmeut funéraii'c et de préservatif contre les
maligues iniluences. Beaucoup do fêtes chrétiennes sont célébrées par les
^iiherlicsses : ils jie ti'availlent pas le dimanclie, et ils nomment le mer-
'^'•eili le petit jour do jeûne, et le voiulredi le grand joui-. Un carême de
sept semaines précède les Pâques (gadyj); quarante jours après le gadyj
'S célèbrent le jéga. Ils adorent trois divinités : Tkhapildio (le grajul
dieu), sa mère, Mariiem-tkha-pchi (Marie-dieu-prince), et Cliergoupse.
Ils célèbrent la fête des llois sous le nom do Kordessekh, L'office divin
mémo, qui, snuf la fête du gadyj, n'est fréquenté que par les hommes,
est célébré par d'anciens fonctionnaires estimés, et présente beaucoup
d'analogie avec le culte chrétien.
La civilisation des ¡¡euplades tcherkesses est très-peu avancée. Llles
ont conservé l'organisation des tribus primitives des temps anciens, et
sont divisées en beaucoup de petites tractions ou communes.
Bien que le principe démocratique des montagnards de l'est ait depuis
quelque temps pénétré parmi les Tclierlcesses, il existe encore chez eux
plusieui-s institutions aristocratiques. Tous les Tcherkesses jouissent de
di'oits égaux ; les diverses tribus se composent des classes sociales suivantes
: les pchis ou princes, les voi'ks ou gentilshommes, les tklivokhotls
ou hommes libres; les obs sont ceux qui, n'ayant pas de pai'ents, ont été
recueillis et protégés par une famille; les pchitls, ])aysans dépendants, eL
les yassyrs, esclaves.
Autrefois, l'importance des ])chis et des vorks était très-grande; ils
décidaient de toutes les affaires intérieures et extérieures, et opprimaient
les habitants moralement et matériellement. Plusieurs révoltes du peuple
contre la noblesse étaient restées sans résultat lorsque, vers la fin du
siècle dernier, les tribus des Abkhaz ou Abad^.é l'éussirent à expulser leurs
¡¡rinces et une grande partie de la noblesse. Ces princes trouvèi'ent un
apijui auprès de ceux des tribus desAdighé, et recherchèrent avec eux,
en 1792, la protection de l'impératrice Catherine; mais l'insuffisance
des forces militaires que représentaient les Kozalcs de la mer Noire, dont
les colonies peu nombreuses cjicore venaient d'être récemment établies,
ne permit à l'impératrice de leur prêter qu'un bien faible appui. Des
luttes opiniâtres eurent lieu alors entre l'aristocratie et le peuple, et
quoique la premièi'c fut i-estée victorieuse, elle émigra cependant en
p a r t i e chez les Adighé et en partie vers la rive droite du Kouban. Par
suite de cet événement, ces émigrés devini-ent les premiers Tcherkesses
pacifiques, qui forment la stanitsa actuelle de Grivenskaïa,
Les princes et la noblesse perdirent bientôt aussi une grande ])artic
de leur importance cJiez les Adiglié eux-mêmes, de sorte qu'aujourd'hui
les trois premières classes de la i)opulation ont des droits presque égaux :
la seule différence actuelle consiste dans l'influence morale de quelques
princes et dans quelques prérogatives honorifiques.
Les peuplades tcherkesses se sont trouvées à toutes les époques dans
une dépendance plus ou moins grande des autres peuples ; c'est ainsi que
dans ces derniers temjis ou les a vues subir l'iniluence des Turcs, qui
s'efforçaient de les excitei' contre les Russes et employaient dans ce but
tous leurs efforts pour ])ropagcr l'islamisme dans la contrée. A la suite
de la paix de Koutchouk-Kaïnardji en 1774, le fleuve du Kouban étant
devenu la frontière de la Russie dans le Caucase, on commença bientôt
à coloniser la ligne du Kouban, et l'on établit sur le fleuve des stauitsas
de Kozaks zaporogues transférés en 1792 dans ces régions et auxquels on
donna le nom de Kozoks de la mer Noire. En 1829, par suite de la paix
d'Audrinople, la rive orientale de la mer Noire fut annexée à la Russie;
ce fut alors seulement que les contrées des tribus tcherkesses passèrent
définitivement sous le sceptre de la Russie. Ce n'e.st qu'à dater de cette
époque que l'on ¡¡ut s'occuper sérieusement et systématiquement de la
soumission complète îles Tcherkesses. L'étendue de leur territoire et l'impossibilité
d'une attaque du côté de la mer Noire expliquent pourquoi,
durant trente ans, c'est-à-dire de 1829 à 1859, on ne déploya jamais
Contre eux autant de forces militaires que dans le Caucase oriental.
Nous avons déjà fait mention de la longue lutte chez eux entre l'élément
démocratique et l'élément aristocratique. Il y a eu pendant cette
lutte dos périodes où les Tcherkcsses implorèrent eux-mêmes l'assistance
des Russes; mais les ennemis do la Russie s'efforçaient constamment
d'étouffer ces querelles intestines et de faire entrer les Tcherkesses dans
nu soulèvement général contre les Russes. C'est précisément dans ce
sens qu'agissait aussi Schamyl.
La séparation topographique des tribus tcherkesses, éloignées des tribus
du Caucase oriental, empêcha Schamyl de paraître en personne dans la
Transkoubanie; mais il y envoya des émissaires qui, prêchant le Char
i a t e , devaient en môme temps travailler à l'union politique. Pai'mi ces
émissaires, les trois principaux étaient Khadji-.Mahomet, Soliman-Kfîendi,
e t Mahomct-Amine. Ce dernier a fait maintenant sa soumission.
Il,