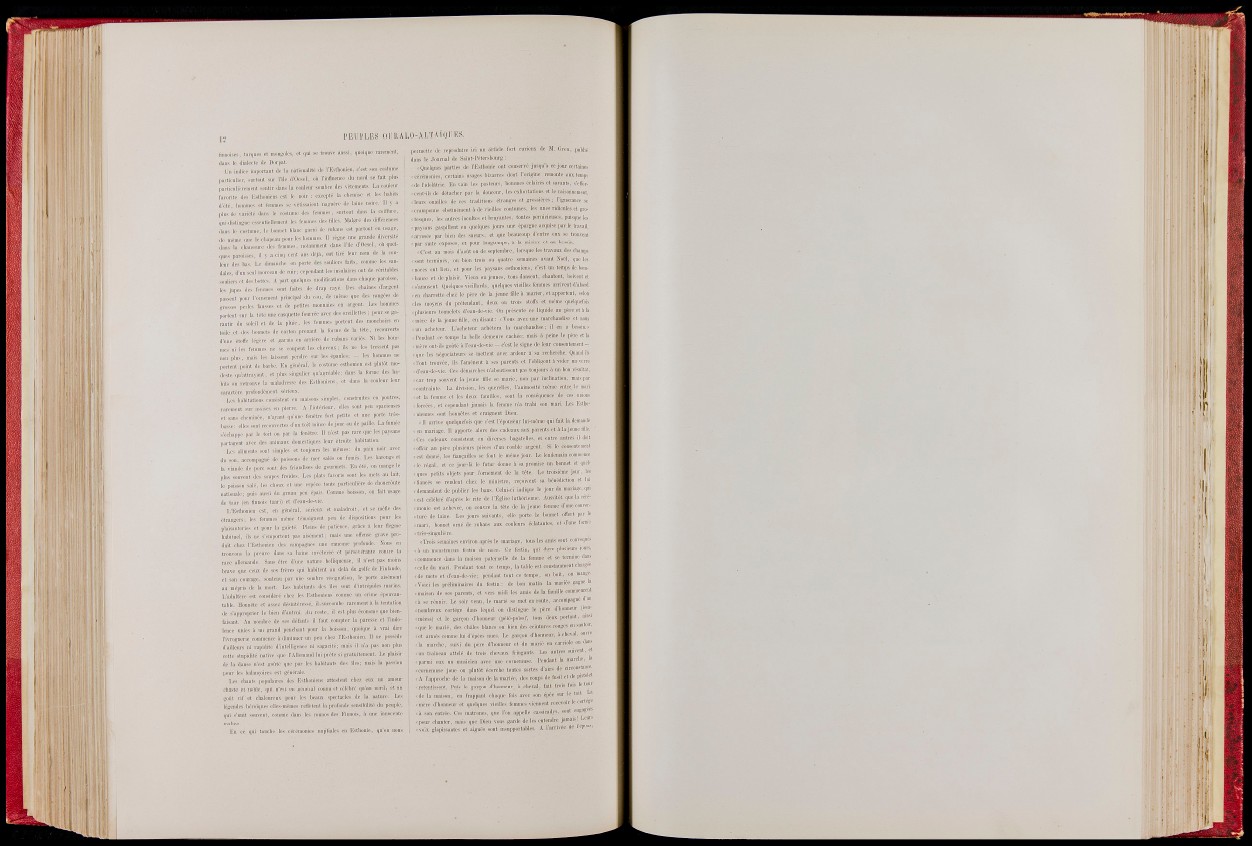
l'IÎU r LES ou HA LÜ-A LTAÍIH! RS.
ri
1-2
f i n n o i s e s , liiniiics pt mongoles, et ilui se tronve aussi, quoiqne lareinent,
dans le dialecte (le ])eri)ii.t, j
Un indicc important de la nationalité de l'Ustlloiiicn, c'est son costume
l i a r t i c n l i e r , siii toiit sur l'Ile d'Desel, nii l'inllnence da nord se fait idus (
p a r l i c a l i é r e m e n l sentii' dans la cealeai- sombre des vêtements. La couleur
f a v o r i t e des Ustlionieus est le noir : excepté lu cliemlse ct^ les liabits
i l ' È l i , iKiUimes et femmes se vttissaicnt uliguère de laine noire. 11 Y a
pins lie varicti dans le cosinme des femmes, surtout dans la coilTure.
ipii dislingue essenliellement les femmes des filles. S'falgré des dlITéienees
dans le costume, le lnnnn>t blanc garni de rubans est partout en usage,
de même .|nc le cliapeaa pour les hommes. Il règue nue grande diversité
dans la cbaussure des femmes, notamment dans l'ile d'Oesel, oîiqneV
„nés paroisses, il ,v a cinq cent ans déjà, ont tiré leur nom de la cou- .
l(un> des bas. Le diuuiuche en porte des souliers faits, comme les sand
a l e s , d'ini seul mcn'ceiin de cinr; ce|OTulant les insulaires ont de Yéritables
s o u l i e rs et des boites. A part quelques modifications dans chaque paroisse,
les japes des feuunes sont faites de ilra], rayé. Des chaînes d'argent
pa.sscnt liour l'oinement principal du cm, de même que des rangées de
grosses perles fausses et de petites momuaies en argent. Les hommes
poi teul sur la léte une casquette fourrée avec des oreillettes ; pour se gar
a n t i r du soleil et de la iiluie, les femmes portent des mouclloirs eu
telle et des bonnets de carton prenant la foime de la tête, recouverts
d ' u n e ételt'e légère et garnis en arriére de rubans variés. Ni les bomuics
ni les femmes ne se coupent les clicTcux ; ils no les tressent pas
mm iilus, mais les laissent pendre sur les épaulés: - - les hommes ne
porteni |K.iut de barbe. Eu général, le costame esthonieu est plutôt mod
e s t e iiu'atirayant, et plus singulier i|u'agréable: dans la forme des hab
i t s on retrouve la maladresse des Estlnmlens, et dans la couleur leur
c a r a c t è r e profmidément sérieux.
Les habitations consisteut ou maisons simples, construites en poutres,
r a r e u u m t sur assises en pierre. A l'intérieur, elles sont peu spacieuses
e t sans cheuiinée, n'ayant qn'nm- fenêtre fort petite et une porte trèsb
a s s e : elles sontreconvertes il'un toit mince de jenc ou de paille. La fumée
s'cclm|,]ie par le toit ou par la fenêtre, fl n'est pas i-are que les paysans
l i a r l a g e n t arec de,s animaux dinncstiques leur étroite liabitotion.
Les aliuieuts so:it simples et tou,jours les mêmes: du pain noir avec
du son, accompagné de iioissons de mer salés ou fumés. Les harengs et
la viande de pore sont des fiiandises de gennuets. En été, on mange le
plus souvent des soupes froides. Les plats favoris sont les mets au lait,
le poisson salé, les choux et une espèce toute particulière de choucroute
u a t i e u a l e ; puis aussi du grnan peu épais. Comme boisson, on fait usage
d e taar {en finnois taari) et d'cau-de-vie.
L ' E s t l i o n i e n est, en général, sérieux et maladroit, et se méfie des
c t r a u g e r s ; les femmes" même témoignent peu de dispositions pour les
p l a i s a n t e r i e s et pour In g.aieté. Pleins de patience, griice il leur flegme
h a b i t u e l , ils ne s'emportent ]ias aisément: mais une offense grave produit
chez l'Esthonieu des campagnes une j-ancune profonde. Nous en
t r o u v o n s la preuve d.ms sa haine iuvétéi'ée et persévérante contre la
r a c e allemande. Sans être d'une nature belliqueuse, il n'est pas luolns
b r a v e que ceux de ses frères qui habitent au delii du golfe de Finlande,
e t son conr.lge, soutenu par une sonitire résignation, le porte aisémeut
a u mépris de la mort. Les habitants des Iles sont d'intrépides marins.
L ' a d u l t è r e est considéré chez les Esthoniens comme un crime épouvant
a b l e . Honnête et assez désintéressé, il.suecombc r.arcment il la teut.ition
de s'approprier le bien d'antrui. Au reste, il est plus économe que bienf
a i s a n t . An nombre de ses défauts il faut compter la )jarcssc et l'indolence
unies il nu grand pcuclmnt pinir la, boisson . quoique il vrai dire
l ' i v r o g n e r i e conimenrc il diminuer un peu cliéz rKsIhonicn. Il ne possède
d ' a i l l e u r s ni rapidité dintelllgence ni sagacité; mais il n'a jjas non plus
c e t t e stupidité native que l'Allemand lui pi été si gratui tement . Le iilaisir
. de la danse n'est goiité que par les habitants des ilos; mais la jjassion
pour les balançoires est générale.
Les chants populaires des Esthoniens attestent chez eux un amour
c h a s t e et noble, qui n'est eu général connu et célébré qu'au nord, et un
goiit vif et chaleureux pour les beaux spectacles de la iiiituie. Les
légendes héroïques elles-mêmes retlètent la iirofondc sensibilité du itcuple,
qui s'unit souvent, comme dans les rounos des finnois, il une innocente
malice.
E n ce qui touche les cérémonies nuptiales eu Estlionie, qu'on nous
p e i n i e t t c de icprodnire ici un article fort curieux de J\L Grcn, publié
dans le Journal do Saint-Pétersbourg :
. «tjluelqnes parties de rEsthonie ont conservé jusqu'il ce jour certaines
c é r é m o n i e s , certains usages bizarres dont l'origine remonte aux temps
c d e l'idoliitrie. Kn vain les pasteurs, hoiuuies éclnirés et savants, s'elfor-
•iccut-ils de détacher pur la douceur, les exhortations et le raisoimemeut,
i l e u i s ouailles de ces traditions étranges et grossières; l'Ignorance se
cramponne obstinément il de vieilles coutumes, les unes ridicules et grui
t e s q u e s , les antres incultes et bruyantes, toutes pernicieuses, ])ulsquo les
'< p a y s a n s gaspillent en quelques jours une épargne acquise par le travail,
« a i ' r o s é e ])ar bien des sueurs, et que beaucoup d'entre eux se troiivcut
•¡par suite exposés, et pour longtemps, à la misèi-e et an besoin.
• C'est au mois d'août ou de septembre, lorsque les ti-avaux des cliamps
•csonl terminés, ou bien trois ou quatre semaines avant Noël, que les
< noces ont lieu, et pour les paysans esthoniens, c'est un temps de beni-
• b a n c c et de iilaisir. Vieux on jeunes, tous dansent, cliairtent, boivent et
v-s'amusent. tjuelqucs vieillards, quelques vieilles femmes arrivent d'abord
<en charrette rbcz le père de la jeune ftile à marier, et apportent, scion
«les moyens du prétendant, deux ou trois stoffs et même quelquefois
, plusieurs tonnelets d'eau-de-vie. On présente ce liquide au père et .Ma
. mère de la jeune lille, en disant: «Vous avez une marchandise et nous
, nu acbeteur. L'aclicteur acbetcra la marchandise ; il en a besoin. >
. Pendant ce temps la belle demeure cachée; mais ii. peine le père et la
, lucre ont-ils goûté il l 'ean-de-vi e — c'est le signe de lenr consentement —
< q u e les négociateurs se mettent avec ardeur à sa recherche. Qa-md ils
l ' o n t Ironvee, ils l'amènent il ses parents et l'obligent il vider un verre
d ' e a n - d e - v i e . Ces démarclies n'aboutissent pas toujours il un bon résultat,
î c a r trop souvent la jeune fille se marie, non par inclination, mais par
. - c o n t r a i n l e . La division, les querelles, l'animosité luême cntiie le mari
: e t ia fcmuie et les deux familles, sont la conséqucnce de ces unions
f o r c é e s , et cependant j,aniais la femme n'a tr.alii son mari. Les Estho-
^ i i i e n n e s sont honnêtes et craignent Dieu.
^•11 .arrive quelquefois que c'est i'c])ouseur Inl-même qui fait la demande
Í en mariage, il apporte alors des cadeaux aux parents et à la jeune tille.
«Ces cadeaux consistent en diverses bagatelles, et entre antres il doit
< o f f r i r .au père plusieurs pièces d'un rouble argent. Si le conseutenicut
« e s t donné, les ti.ançailles se font le même jour. Le lendemain commence
: le rég.al, et ce jonr-lii le futur donne sa promise un bonnet et quel-
<ques petits objets pour roriiemeut de la tête. Le troisième jour, les
«fiancés se rendent chez le ministre, reçoivent sa béoédiction et hu
. demandent de publier les b.ans. Celui-ci indique le jour du mariage, qui
. est célébré d'après le rite de l'Église luthérienne. Aussitôt que la cére-
: moul e est .achevée, on couvre la tête de la jemie femme d'une couvei-
. t u r c de laine. Les jours suivants, elle porte le bonnet offert par le
< m a r l , bonnet orné de rub.ans aux couleurs éclatantes, et d'une forme
' très-singulière.
« T r o i s semaines environ après le mariage, tous les .amis sont convoques
i il un monstrueux festin de noce. Ce festin, qui dure plusieurs jours,
. commence dans la maison p.aternelle de la femme et se termine dans
« c e l l e du mari, fendant tout ce temps, la table est constamment ehargcc
« d e mets et d'ean-de-vie; |>endant font ce temps, on boit, on mange.
«Voici les préliralnaircs du festin : de bon matin la mariée giigne la
«maison de ses parents, et vers midi les amis de la famille commencent
«il se réunir. Le soir venu, le marié se met en route, accompagne d un
« n o m b r e u x cortège dans lequel on distingue le père d'honneur (issa-
«mêcss) et le garçon d'honneur (pélé-poi'ss)', tous deux portant, ainsi
« ( | u e ! e marié, des chilles blancs ou bien des ceintures ronges en sautoir,
« e t .armés coniine lui d'épécs nues. Le garçon d'honneiir, ii cheval, ouvre
« l a marche, suivi du pèle d'honneur et du niurié en carriole ou llans
«un traîneau attelé de trois chevaux frinB.ants. Los autres suivent, cl
i l i a r m i eux un musicieii avec une cornemuse. Pendant la inarehe, .1
«cornemuse joue ou ]ilutôt écorche tontes sortes d'uirs de circonstance.
«A l'a|i]iroche de la maison de lu mariée, des coups de fusil et de pistolet
« r e t e n t i s s e n t . Puis le garçon (riioiincur, il chovnl, fait trois fois le tour
« d e l;i inaisoii, eu fraiqiant cli<i,que fois avec son é¡)ée sur le toit-
« m è r e d'honneur et quelques vieilles femmes vienuciit recevoir le cortege
< à sou entrée. Ces matrones, iiue l'on a|i|ielle ca.ssicadys, sont eugage»»
« p o u r chanter, mais ([ue Dieu vous garde de les entendre .¡amais 1 Leius
« voix glapissantes et aiguës sont insupportables. «V l'arrivée de l éjioux,